Le Blog des DVDpasChériens
Catégorie: Dossier
08.07.13
Compte rendu du festival Hallucinations collectives (Lyon, 22 mars – 1er avril)
Il y en a qui choisissent pour Pâques de partir à la recherche des oeufs dans le jardin familial. Quand on aime le cinéma, il y a de biens meilleurs plans. En l’occurrence, la meilleure destination à cette époque est Le cinéma Comoedia à Lyon.
Pourquoi ? Parce que les membres de Zonebis investissent le cinéma Le Comoedia à Lyon en proposant aux spectateurs curieux les films “les plus rares, décalés et joyeusement foutraques produits à travers le monde” (édito qui figure sur le site Hallucinations collectives).
Pour ma part, j'ai eu le plaisir de visionner durant 3 jours la bagatelle de 13 films.
constitués d'avant-premières ou de films rares. Tous ont fait l'objet de présentations qui augmentaient l'envie de regarder ces films.
Le plaisir de participer à Hallucinations collectives a été décuplé par le fait de pouvoir discuter aussi bien avec les membres de Zonebis qu'avec des spectateurs ravis par le programme du festival.
Il est toujours appréciable de pouvoir discuter de cinéma avec des gens qui apprécient toutes sortes de films
Avant de procéder à la critique de chaque film visionné, un rapide bilan s'impose. A cet effet, il convient de noter la grande qualité globale de ce festival.
Au niveau des avant-premières, Berberian sound studio s'est révélé particulièrement original dans son approche en laissant le spectateur s'imaginer beaucoup de choses. C'est d'ailleurs ce film qui a remporté le grand prix du long métrage 2013. Je lui ai cependant préféré Modus anomali, un film horrifique transgenre qui se plaît à jouer avec le spectateur. La seule déception des avant-premières est le film The collection, un film qui cumule les défauts, au point d'être proche d'un film Z. Cela dit, le film en devient involontairement drôle, à tel point qu'il mérite qu'on le regarde, au moins pour se marrer.
Au niveau des rétrospectives, le festival a mis du lourd, car ce ne sont ni plus ni moins que de véritables chefs-d'oeuvre qui m'ont été donnés de voir : entre le film schizophrénique Possessions de Zulawski, le splendide film sur l'enfance avec L'enfant miroir de Philip Ridley ou encore Requiem pour un massacre, film définitif sur la guerre, les émotions ont été fortes et le plaisir n'en a été que plus grand.
Le cru 2013 du festival Hallucinations collectives a donc été très bon, comme le prouvent les critiques des différents films visionnés, qui figurent ci-dessous.
On attend désormais qu'une chose : revenir sur ce festival pour l'année 2014.
Nul doute que de nouvelles expériences extraordinaires sur le plan cinématographique nous attendront dans la belle ville de la fête des Lumières !
Vivement l'année prochaine !
Les séances du vendredi 29 mars 2013
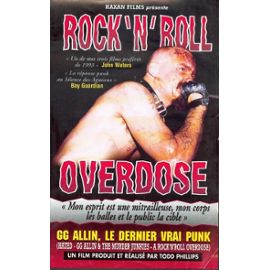
Rock'n roll overdose (1993, Etats-Unis) de Todd Philips
La critique du film :
Todd Philips est surtout connu pour ses comédies bien lourdingues mais franchement marrantes telles que Retour à la fac et le désormais culte Very bad trip. En 1993, il a réalisé son premier long métrage, un film documentaire sur le punk rocker, GG Allin, dont il était fan.
Ce film narre les dernières années de GG Allin, à un moment où il était au creux de la vague sur le plan musical et pas au mieux sur le plan personnel. C'est le moins que l'on puisse dire. Car Rock'n roll overdose est un documentaire hallucinant qui montre un homme, GG Allin, qui se livre aux pires folies. Dès le départ, on est mis dans l'ambiance avec notre fameux punk rocker qui est nu sur scène et qui frappe des spectateurs. Ce n'est qu'un avant-goût car le reste est impressionnant.
Lors d'une autre scène, on le verra s'enfoncer une banane dans le cul devant des universitaires et inviter les participants à ôter leurs vêtements. Lors d'une autre séquence, on le voit déféquer sur scène, manger sa merde et chanter en même temps.A un autre moment, l'espace d'un instant, on aperçoit une photo où un fan suce le sexe de GG Allin. Le plus étonnant a certainement lieu lorsqu'une fille lui pisse dans la bouche et que GG Allin vomit ensuite tout ce qu'il avait précédemment mangé. La scène est très crade. Elle n'a pas été filmée par Todd Philips mais par le frère de GG Allin, Merle. Pour le bon goût, évidemment, on repassera.
GG Allin fait dans la provocation, c'est une certitude. On ne sait pas jusqu'où peut aller sa folie. En tout cas, elle l'amène à rendre visite en prison au serial-killer Gacy. Aux dires d'un des fans de GG, leur sujet de conversation aurait été d'attacher des filles.
Mais GG Allin n'est pas seul à être très perturbé et incontrôlable dans ses faits et gestes. Son bassiste, Dino, joue aussi à poil sur scène et déclare : “Je suis paix et amour au milieu de la violence.” Pourtant, l'ami Dino est loin d'être un saint. Il a fait de la prison pour exhibitionnismme après avoir montré son sexe à une petite fille.
Ce documentaire prouve que GG Allin se trouve dans un environnement de gens dégénérés qui ne sont pas là pour le sortir du mauvais pas dans lequel il se situe. Conclusion : GG Allin est révolté contre tout. Il n'aime pas les gens et il le clame ouvertement en disant : “Je vous hais bande d'enculés”, alors qu'il est défoncé et boit une bière. Un fan de GG Allin, que l'on voit à plusieurs reprises dans le documentaire, confirme les dires de sa star : “Je crois que GG hait tout le monde.” Le film est d'ailleurs émaillé de plusieurs interviews : membres et ex membres du groupe ; frère de GG Allin (“GG n'a pas de place dans la société”) ; ex professeur, qui chacun à leur façon évoquent la personnalité très dérangé de GG Allin. Mais de manière plus générale, on peut aussi comprendre en partie les agissements de ce dernier, puisqu'il a vécu avec des gens vraiment pas très nets.
Rock'n roll overdose comporte notamment des extraits de concerts qui ont été tournés dans des conditions rudimentaires, avec une image très granuleuse ce qui accroît le côté foutraque de l'ensemble.
Au final, que penser de ce film. D'abord, c'est un documentaire unique. On imagine clairement qu'il est quasiment impensable dans notre société actuelle de pouvoir voir un tel film. Déjà, il faut avoir l'idée et le courage de le tourner. Ensuite, Rock'n roll overdose donne l'occasion au spectateur d'assister aux frasques d'un personnage hors-du-commun. On est abasourdi par les attitudes déviantes de GG Allin qui agit clairement comme un électron libre, en dehors du système. Le public de GG Allin a tout à la fois une relation d'attirance et de répulsion pour sa star. Car GG Allin peut être considéré d'une certaine façon comme le représentant d'une Amérique autre. Il est bon parfois de se rappeler que les Etats-Unis ne se limitent pas à Hollywood et à des jolies filles qui jouent les gravures de mode. C'est aussi un pays où des gens n'arrivent pas à s'intégrer dans le système et se retrouvent complètement en perdition.
A défaut d'être un grand film, Rock'n'roll overdose est une sorte OFNI (objet filmique non identifié) qui ne peut être regardé que par un public très averti. Car la plupart des scènes risquent de choquer, voire même d'écoeurer un public lambda. Il faut tout de même être conscient du spectacle pour le moins incroyable que l'on est amené à voir.

The land of hope (2012, Japon) de Sono Sion
La critique du film :
Remarqué avec le film Suicide club (2002), le cinéaste Sono Sion est devenu depuis une coqueluche des festivals de cinéma. Adepte du tournage guerilla (sans autorisations), il a été récompensé à Berlin pour Love exposure.
Il s'est senti investi d'une mission après le drame de Fukushima. Voilà la raison qui explique pourquoi il a tourné ce Land of hope.
Le film commence en nous montrant ce qu'est la vie avant que ne survienne la catastrophe de la centrale nucléaire.
Sono Sion a fait un film très sérieux, où il ne manque pas d'esprit critique. La gestion de la crise le laisse circonspect, à l'image du père de famille dans le film qui déclare : “Peut-on croire les informations officielles ?” La question mérite d'être posée car certains éléments tendent à prendre les habitants pour des imbéciles. On songe par exemple à cette scène où des personnes en combinaisons tracent une ligne à partir de laquelle cela ne serait pas dangereux de circuler. A l'instar du drame de Tchernobyl, on se doute bien que l'air pollué ne va pas s'arrêter devant cette frontière fictive.
De manière générale, c'est l'absence d'informations qui fait l'objet de critiques. Il y a bien eu une demande d'évacuation de la population, mais on ne dit rien aux gens. Ce qui fait dire à la famille qui décide de rester malgré l'ordre d'évacuation, que le gouvernement “se tait toujours quand c'est important.” L'Etat en prend pour son grade, et c'est loin d'être fini. En mêlant tout à la fois une forme de dépit et un cri de rage, le père de famille déclare que “l'Etat, la préfecture, la ville […] personne n'est de notre côté.”
De manière générale, le film s'interroge sur ce que génère un tel incident. Certaines personnes sont placées dans des abris de fortune. Des gens vivent serrés, dans des cartons. On comprend aisément que la vie est devenue très difficile. Certains font le choix (par amour) de se donner la mort ensemble.
Cela étant, la fin apporte un message d'espoir lorsqu'une femme enlève son masque, comme si elle avait foi en l'avenir. Pour autant, la radioactivité est toujours présente. Mais il faut garder espoir en notre terre (d'où le titre du film) : “on s'aime, alors on s'en sortira”.
Il va sans dire que The land of hope est un film coup de poing où son réalisateur a souhaité une prise de conscience de la population pour que de tels drames ne se reproduisent pas et pour que la gestion de la crise soit plus efficace. Le film est assez aride et épuré, destiné à un public averti. Les thématiques développées sont loin d'être réjouissantes, renforcées au passage par des notes au piano qui suscitent l'inquiétude. Le film est donc réservé à un public conscient du film qu'il va regarder.

Henry, portrait d'un serial killer (1986, Etats-Unis) de John Mac-Naughton :
La critique du film :
A l'origine, Henry portrait d'un serial killer est une simple commande. Le but est de faire un film d'horreur sanglant. John McNaughton ne voit alloué un budget très faible de 110 000 € dollars.
Le cinéaste va apporter sa touche personnelle en décidant de centrer son film sur le personnage d'Henry Lucas. Ce denier est un tueur en série célèbre, accusé de onze meurtres et qui se serait déclaré l'auteur de trois cent meurtres.
Pour contourner le problème inhérent à son faible budget, John McNaughton décide de tourner son film dans un style documentaire. Par ailleurs, son film se veut minimaliste. Ce qui aurait pu paraître comme un défaut renforce au contraire la puissance des scènes du film.
Henry portrait d'un serial killer est un film glauque et on ne tarde pas à s'en rendre compte. La première image du film est celle d'une femme assassinée. Ensuite on passe directement à une seconde victime et puis il y a une prostituée qui est tuée. En l'espace de quelques minutes, les personnes mortes sont nombreuses. Mais ici, pas de surenchère comme on peut le voir dans les films d'horreur actuels, à la Saw. Il n'y a pas un tueur pervers qui s'amuse à jouer avec ses victimes. Pas de geysers de sang et autres plans gore. Non, John McNaughton nous montre dès le départ la finalité, à savoir la personne morte. Et il a l'idée pour le moins audacieuse de raconter en voix of ce qui s'est passé lors du meurtre. Il y a ainsi une distorsion entre l'image (on voit le mort) et le son (on entend l'agression de la victime par le psychopathe). John McNaughton a sans doute pris cette direction car il disposait d'un budget limité. Pour autant, cette façon de filmer et de raconter son histoire se révèle une excellente idée. En effet, le spectateur est pris dans l'action et comme le sait chacun, une chose est encore plus horrible quand on l'imagine.
Henry portrait d'un serial killer est un film clinique, froid, avec cette succession de personnes tuées, et cette insistance avec un son prenant et stressant.
Le film ne se limite pas à une succession de meurtres qui ont lieu hors champ. Il nous amène surtout dans le quotidien d'Henry Lucas. Il vit dans un appartement misérable, crasseux, avec un pervers sexuel, dénommé Otis. Ce dernier ramène à la maison sa soeur, Becky, qui semble s'entendre avec Henry Lucas. Cela étant, on apprend que chacun des personnages a vécu dans un contexte familial pour le moins particulier. Becky raconte qu'elle s'est fait violer plusieurs fois par son père et que sa mère n'a jamais rien fait. On ne saura jamais si Becky raconte cela pour impressionner Henry et si ses dires sont véridiques. De son côté, Henry Lucas lui déclare qu'il a tué sa mère quand il avait quatorze ans. Les rares moments d'explications sur la vie familiale des uns et des autres donnent lieu à des révélations bien particulières.
Cela étant, la majeure partie du quotidien d'Henry Lucas et d'Otis consiste à tuer des gens. Sur ce point, on notera qu'Henry dit à un moment donné à Otis : “J'ai envie de tuer quelqu'un. Allons faire un tour Otis.” On constatera qu'à partir du meurtre de deux prostituées, les décès ne se déroulent plus hors champ. Bien au contraire. Nos deux protagonistes en vont même jusqu'à filmer une de leurs victimes. Tout cela accroît le côté documentaire de l'ensemble. Et cela prouve l'esprit pervers de ces tueurs qui prennent un malin plaisir à consulter ensuite leurs méfaits en vidéo, notamment Otis.
Ce dernier n'hésite pas à se repasser la vidéo. Et il ne peut s'empêcher d'avoir une attirance pour tout type de personne. Il laisse aller toutes ses envies. Ainsi, il “branche” un jeune homme qui lui fournit de la drogue. Et puis il regarde toujours avec envie sa soeur Becky, n'ayant aucune considération morale qui pourrait éventuellement le retenir.
Il faut dire que la morale est bien loin d'être respectée dans une telle oeuvre : d'un côté, on a un Henry Lucas qui ne contient jamais ses pulsions meurtrières ; de l'autre, on a le pervers Otis qui cherche à assouvir ses pulsions sexuelles. Le style documentaire du film est clairement un très bon choix. Il donne un côté voyeur et presque malsain à un spectateur qui assiste médusé aux actions répréhensibles des personnages principaux.
Evidemment, le film doit notamment sa grande réussite à l'interprétation parfaite de Michael Rooker. Il campe à merveille un Henry Lucas qui paraît doux comme un agneau, presque timide, mais qui n'a aucun amour pour son prochain. Personne n'a grâce à ses yeux et il ne souhaite qu'assouvir sa passion du meurtre.
Ce long métrage peut même apparaître comme perturbant pour certains spectateurs, car il ne cherche jamais à expliquer. On a affaire à un malade, un point c'est tout.
Au final, Henry, portrait d'un serial killer est sans conteste un film inoubliable, l'un des meilleurs films qui rentre dans le quotidien le plus banal d'un de ces tueurs. Avec un Maniac qui date de la même époque, c'est un incontournable qui continue de faire son effet, encore aujourd'hui.
Les séances du samedi 30 mars 2013

La compagnie des loups (1984, Angleterre) de Neil Jordan
La critique du film :
L'organisation d'Hallucinations collectives a mis les petits plats dans les grands en permettant de voir le film La compagnie des loups dans une copie 35 mm en version originale sous-titrée français.
A l'origine, ce long métrage est une nouvelle qui a été adaptée à la radio avant que le cinéaste Neil Jordan (Entretien avec un vampire, Crying game) n'en fasse un film en 1984.
Le film peut être vu comme une sorte de conte horrifique, avec de manière sous-jacente le passage de l'enfance à l'adolescence.
Les références à la littérature et aux mythes sont nombreuses. La plus évidente est celle du petit chaperon rouge. Il faut dire que le loup est omniprésent dans différentes histoires qui jalonnent le récit.
La compagnie des loups est par essence un film à voir sur grand écran. En effet, sa photographie est superbe. On a vraiment l'impression de regarder un conte s'animer sous nos yeux. Le travail effectué au niveau des décors et de la lumière est impressionnant. Tout comme la mise en scène qui est fort réussie : on pense ainsi notamment au monde étrange qui fait l'objet des rêveries d'une jeune fille. On aperçoit des champignons géants, des loups dont les yeux rouges font peur, etc.
Ce long métrage très pictural se déroule à une époque moyen-âgeuse. Pusieurs histoires se succèdent avec comme thème commun le loup. Ce dernier se révèle très dangereux. Or, un loup sommeille en certaines personnes. On a droit à des maquillages de grande qualité, qui sont le résultat du travail du maquilleur Christopher Tucker.
Le film peut être vu aussi comme une expression du désir sexuel avec tous ces hommes qui gravitent autour d'une jeune fille au visage enfantin et qui n'ont de cesse de tenter de la fréquenter. Il faut dire que la principale protagoniste évolue et qu'elle n'est plus la jeune fille qu'elle était au début du film, comme lors de cette scène où elle monte dans un arbre et se met du rouge sur les lèvres. Elle attise la convoitise. Comme lui dit sa grand-mère, “tu ne resteras plus petite fille très longtemps.” Mais notre héroïne ne se laisse bien évidemment pas fair et la fin réserve des surprises. Bref, le film est étonnant et même haletant de bout en bout.
La compagnie des loups est un film très subtil qui joue constamment entre rêve et réalité (Rosaleen est-elle en fin de compte un loup ?), entre monde de l'enfance et dureté de la vie des hommes. Ce long métrage joue aussi tout à la fois sur l'aspect du merveilleux que sur une tension, qui est rehaussée par une musique symphonique.
Ce second film de Neil Jordan, qui peut faire l'objet de moults interprétations, est une grande réussite du cinéma fantastique.
Berberian sound studio (2012, Angleterre) de Peter Strickland
La critique du film :
Berberian sound studio est un film d'horreur mis en scène par Peter Strickland. Ce cinéaste britannique, fan de cinéma populaire italien, est connu pour faire de la musique expérimentale. Et dans ce long métrage, il reste bien dans le style de ses travaux précédents.
En effet, il a pris le parti de ne rien montrer. Dans Berberian sound studio, on suit le personnage de Gilderoy, un homme qui est venu procéder à la création et au montage du son d'un film.
Dès le début, le spectateur constate qu'il va assister à un spectacle très original et ô combien étonnant. Il est clair qu'il est souhaitable de rentrer dans le “trip” du film, sinon on risque de passer à côté. Dans le détail, on a droit dans ce long métrage à l'envers du décor avec des gens qui jouent avec tout ce qui est possible pour produire le son voulu. Ainsi, des hommes coupent des radis pour ensuite montrer à l'écran quelqu'un qui se fait agresser. Notre principal protagoniste découpe de la salade pour signifier que quelqu'un se prend un coup de couteau.
A chaque instant, on imagine les scènes mais on ne voit rien. C'est tout à la fois original et décalé. Le réalisateur Peter Strickland n'est manifestement beaucoup amusé à faire ce film. Et surtout il n'est pas si loin de ses concerts musicaux qui sont pour moins très étonnants.
Car on a beau se situer dans un film d'horreur, le cinéaste n'a pas hésité à faire preuve d'un maximum d'humour. Il filme en gros plans des salades qui vont se faire exploser. A un autre moment, il met de la salade dans un aquarium pour représenter une sorcière noyée dans un tonneau.
L'humour ne s'arrête pas au parti pris très particulier du film. Peter Strickland s'amuse également à se moquer des producteurs du film qui ne sont là que pour faire de l'argent et coucher avec les actrices. Ils n'ont aucune conscience artistique. Quand le producteur du film déclare que “Personne n'a jamais vu ce genre d'horreur”, il n'est pas là pour flatter Gilderoy. Il est plutôt en train de se dire que tout cela va lui permettre de se faire un maximum d'argent.
Peter Strickland se moque également de la qualité très relative du jeu des actrices (“même un hamster jouerait mieux”), qui se borne bien souvent à hurler dans tous les sens.
Cela étant, le film ne se contente pas d'amuser le spectateur. Il le mène vers des contrées étranges, avec une pellicule qui finit par griller. La fin du film se termine de manière particulièrement ouverte avec notre principal personnage.
Au final, si Berberian sound studio est très original, il n'en demeure pas moins un film très déstabilisant et difficile à regarder, si l'on n'est pas en phase avec celui-ci. Pour ma part, même si certaines scènes m'ont semblé amusantes et d'autres assez troublantes, je n'ai pas été très réceptif à cette oeuvre.

Dellamorte dellamore (1994, Italie) de Michele Soavi :
La critique du film :
Pour des raisons professionnelles, Michele Soavi, à qui une rétrospective était dédiée lors de ce festival, n'a pu être présent pour évoquer ses films. Pour autant, le plaisir de voir un chef d'oeuvre tel que Dellamorte dellamore sur grand écran est énorme. On assiste à une oeuvre hors-norme, qui surpasse largement le pourtant très sympathique Bloody Bird du même Michele Soavi.
Dans ce film qui date de 1994, le cinéaste transalpin adapte avec brio la bande dessinée Dylan Dog.
La grande réussite tient notamment à son casting. Rupert Everett incarne à merveille le rôle de Francesco Dellamorte, un gardien de cimetière, qui vit seul avec son assistant (joué par un des anciens Garçons Bouchers) et qui doit tuer des morts qui reviennent à la vie. Son personnage décalé nous offre des moments inoubliables. Véritable conte macabre où Eros et Thanatos sont plus que jamais présents, Dellamorte dellamore bénéficie aussi de la présence de la magnifique Anna Falchi qui rend la pareille au personnage de Francesco Dellamorte, en jouant plusieurs rôles dans le film.
Déroutant, magnétique, humoristique, fantastique, Dellamorte dellamore est tout cela à la fois. Mais c'est aussi et surtout une très belle histoire d'amour, narrée à sa façon par un auteur transalpin qui a été fortement influencé par son maître, le grand Dario Argento mais aussi par Mario Bava. Il faut dire que le travail rendu sur la photographie est impressionnant. Le film est d'ailleurs d'autant plus marquant quand on a la possibilité, comme lors de ce festival, de le voir sur grand écran.
Certaines scènes sont sublimes, à l'image de cette séquence d'amour qui a lieu dans le cimetière, avec les lucioles qui entourent les deux amants. Et puis le film comporte plusieurs degrés de lecture, notamment par les apparitions très différentes jouées par Anna Falchi. Si l'amour est toujours présent, la mort rôde également, ce qui prouve bien que l'on a affaire à un auteur passionné par ces thématiques.
Avant de mettre en scène l'excellent Arrivederci amore ciao, Michele Soavi aura donc durablement marqué les esprits avec ce fabuleux Dellamorte Dellamore, film inclassable et pour autant génial.

The collection (2012, Etats-Unis) de Marcus Dunstan :
La critique du film :
Scénariste de la franchise Saw depuis le quatrième épisode (autant dire les plus mauvais épisodes...), Marcus Dunstan est un jeune cinéaste qui a connu une ascension rapide. En 2009, il met en scène de manière efficace – à défaut d'être original – The collector.
Avec The collection, Marcus Dunstan signe la suite de The collector, un film où un psychopathe prenait un plaisir certain à séquestrer ses victimes de manière très méthodique.
De son côté, The collection parvient haut la main à intégrer la catégorie “nanar” car il cumule à un tel niveau les fautes de goût qu'il en devient un film d'horreur involontairement drôle.
Tout y passe dans ce long métrage : la mise en scène est hachée, la distribution joue comme un pied, le scénario est totalement prévisible et surtout les scènes sont irréalistes et s'enchaînent de façon abracadabrantesques.
Commençons par la mise en scène. L'ami Marcus Dunstan a pris le parti de nous livrer un ersatz de Saw. C'est bien simple, du début à la fin de The collection, on a l'impression d'assister à un clip géant qui dure plus d'une heure trente minutes. Du coup, à notre grand désarroi, à force de contempler des scènes “cut”, on ne voit pas grand chose et les plans deviennent quasi illisibles.
Si la mise en scène est pathétique, le scénario est du même niveau. Et là, il y a franchement matière à rigoler. Pour donner un exemple savoureux, au début du film, un homme parvient à échapper aux griffes du fameux tueur en série. Etant gravement blessé, il fait logiquement un passage par la case hôpital. Pourtant, son état de santé ne l'empêche pas de prêter main forte à une équipe de mercenaires chargée de retrouver la fille d'un homme riche, qui a été kidnappée par le collector. Cet homme a une faculté de récupération qui force le respect.
Pour que le spectacle soit total, il est nécessaire d'avoir un casting de troisième zone. Et là non plus on n'est pas déçu, tant les acteurs jouent tous plus faux les uns que les autres.
Au final, que dire de The collection ? Film impersonnel, qui souffre cruellement d'un manque d'originalité et d'une mise en scène trop hachée, ce long métrage n'en demeure pas moins une pépite pour les amateurs de nanar. En effet, le film bénéficie d'un rythme alerte et surtout les scènes sont tellement ratées qu'elles en deviennent hilarantes.
8) Requiem pour un massacre (1987, URSS) de Elem Klimov
La critique du film :
Réalisé en 1985 par le grand et rare cinéaste russe Elem Klimov, auteur notamment de L’agonie, extraordinaire biographie de Raspoutine, Requiem pour un massacre est un véritable choc émotionnel.
Se déroulant durant la seconde guerre mondiale dans la campagne biélorusse, le film suit le parcours d’un jeune garçon qui décide de s’engager chez les partisans anti-nazis et qui va être confronté aux horreurs de la guerre.
Rappelant la trame du chef d’œuvre de Tarkovski, L’enfance d’Ivan, Klimov s’éloigne pourtant du traitement poétique du célèbre cinéaste russe pour une approche ultra-réaliste.
Suivant pas à pas son héros, Klimov entraîne avec lui le spectateur qui découvre avec les yeux du garçon la folie humaine. Véritable cauchemar sur pellicule, Requiem pour un massacre est un film incroyablement physique, où le spectateur semble ressentir tout ce que ressent le jeune garçon.
Le film est une errance terrifiante dans la campagne, où le héros va d’atrocités en atrocités, entraînant parfois avec lui une pure jeune fille. Klimov ne décrit ni exploits héroïques, ni scènes de bravoure, ni discours didactiques, il se focalise uniquement sur la violence inhérente à la guerre et la mort. Seul survivre importe dans ce chaos qui semble ne jamais finir et qui débouche sur la fin de l’innocence.
Ponctué de scènes toutes plus impressionnantes les unes que les autres (celle où le spectateur découvre les cadavres des membres de la famille du garçon entassés derrière une ferme ; celle où le garçon et la fille sont contraints de traverser un enfer de boue pour échapper à la mort ; la séquence du massacre du village, d’un réalisme quasi-insoutenable ou encore la tétanisante scène finale où le garçon tire comme un forcené dans une flaque d’eau), Requiem pour un massacre est une expérience traumatisante, où le spectateur a l’impression permanente d’être avec les protagonistes au cœur de la guerre.
Klimov a ici réalisé l’un des films de guerre les plus intenses et les plus remarquables de l’histoire du cinéma. Il montre la guerre telle qu’elle est vraiment, sale, dégueulasse, transformant les hommes (alliés ou ennemis) en bêtes féroces et ne faisant que des victimes. D’une rare cruauté, Requiem pour un massacre constitue une sorte de point de non-retour dans la description de la barbarie humaine et hante encore longtemps le spectateur après ces visions apocalyptiques.
Ce film a sans aucun doute été l'un des moments forts de ce festival car il est particulièrement marquant. Certains spectateurs sont ressortis sonnés à l'issue de la séance.
Les séances du dimanche 31 mars 2013
9) L'enfant miroir (1990, Angleterre) de Philip Ridley
La critique du film :
Philip Ridley est un auteur rare. Il faut dire que le cinéma constitue la partie la plus infime de son oeuvre. Dès lors, avoir la possibilité de voir sur grand écran L'enfant miroir – film inédit en salles – en version originale sous-titrée français est un véritable plaisir.
L'enfant miroir a comme principal protagoniste Seth Dove, un garçon âgé de neuf ans. Il vit dans un petit village des Etats-Unis, après la deuxième guerre mondiale.
Ce long métrage s'intéresse à la période de l'enfance. Le jeune Seth doit composer avec deux problèmes : l'un inhérent à sa famille, l'autre concernant un contexte particulier. La famille de Seth est loin d'être un cadeau : sa mère, qui paraît folle, a des tocs. Quant à son père, c'est une personne lâche et stressée en permanence. Il se fait même taper par sa femme.
L'enfant miroir est très maîtrisé sur le plan technique. On a droit à de très beaux cadrages qui sont filmés à hauteur du jeune personnage principal. On ressent dès lors son stress, son spleen et sa frustration.
Le film ne se contente pas d'avoir comme thématique l'enfance, et notamment sur l'enfance volée. C'est aussi une oeuvre qui traite des conséquences de la guerre. Une jeune femme, Dolphin, considérée comme une sorcière aux yeux des enfants, vit recluse dans une maison isolée. Elle n'arrive pas à se remettre du décès de son époux qui est mort à la guerre : “Le matin je me lève et la moitié de moi reste dans mon lit.” La guerre a également fait des dégâts sur ceux qui y ont participé et en sont revenu. C'est le cas de Cameron Dove, le grand frère de Seth, qui a été traumatisé par la guerre dans le Pacifique et dont il ne veut pas parler.
L'enfant miroir est un film subtil qui joue sur plusieurs niveaux : c'est d'abord un film sur l'enfance sacrifiée (y compris avec ces kidnappings), c'est aussi un film sur une Amérique meurtrie ; c'est enfin un film proche du fantastique avec par exemple cette voiture étrange qui rôde qui représente la mort ou encore l'anglaise Dolphin qui est prise par les enfants pour une sorcière et un vampire.
Bien que se déroulant dans un environnement très lumineux et doté d'une mise en scène quasi atmosphérique, le film L'enfant miroir est un pur drame.
Au niveau de la distribution, le jeune acteur qui interprète Seth Dove est parfait dans le rôle de ce garçon isolé qui se sent désespérément seul, n'ayant aucun soutien familial et voyant disparaître autour de lui ses jeunes copains. Le rôle de son grand frère échoit à un jeune et beau Viggo Mortensen, qui ne parle pas beaucoup mais laisse transparaître beaucoup d'émotion.
Au final, L'enfant miroir est un film très fin, riche sur le plan thématique et doté de sublimes paysages naturels. Toutefois, c'est un film assez exigeant qui demande un minimum de concentration au spectateur.
10) Gods and monsters (1998, Angleterre) de Bill Condon
La critique du film :
James Whale est connu pour la majeure partie des gens comme étant l'auteur de films d'horreur classiques tels que Frankenstein et La fiancée de Frankenstein. Pourtant ce réalisateur britannique a mis en scène des films dans des genres très différents.
Le film Gods and monsters s'intéresse à la fin de la vie de James Whale, connu pour avoir une vie dissolue. Il est notable que ce film n'est pas une biographie mais l'adaptation du roman.
Ce film n'est jamais sorti en France et c'est donc une exclusivité de premier choix que de pouvoir le regarder dans une salle de cinéma.
Le réalisateur de ce long métrage est Bill Condon, pas franchement reconnu du grand public, si ce n'est récemment après avoir mis en scène les deux derniers Twilight.
Dans Gods and monsters, on suit deux principaux personnages : il y a bien entendu Jimmy (James) Whale et un jardinier, Clay Boone, qui plaît beaucoup à Jimmy.
Le film ne manque pas d'humour, en montrant par exemple que Jimmy Whale prêt à tout pour voir la nudité de certains hommes. Ainsi, lorsqu'un jeune homme vient dans la demeure de James Whale pour l'interviewer, celui-ci n'accepte de répondre à ses questions que s'il ôte un habit à chaque question posée. L'intervieweur termine en slip ! Plus tard, lorsque le réalisateur de Frankenstein rencontre Clay Boone, il décide de le peindre en tant que modèle pour arriver à ses fins. A un autre moment, James Whale fait état à Clay Boone des jeunes gens qui sont passés dans sa demeure pour poser nus : il y repense en souriant et on a droit alors à un flashback d'hommes nus dans une piscine.
Cela étant, on constatera que le film devient de plus en plus dramatique. Car James Whale, qui a participé à la première guerre mondiale, ne s'est pas remis de cette période sombre de l'histoire. Le masque à gaz qu'il a conservé chez lui est là pour lui rappeler la première guerre mondiale. Surtout qu'à cette époque il aimait l'un de ses camarades d'infortune, Barnett. A de nombreuses reprises dans le film, James Whale se rappelle la guerre et son amour qui est décédé à cette époque. Ses souvenirs sur cette période pénible sont toujours vivaces. Comme il le dit à un moment donné, “les seuls vrais monstres sont ici”. Il évoque les souvenirs qu'il a toujours dans sa tête.
La relation entre Jimmy Whale et Clay Boone est très bien étudiée. Comme le second refuse les avances du premier, il s'établit en fin de compte une sorte de relation d'amitié. Dans une très belle scène rêvée par Clay Boone, il voit James Whale retrouver son amant mort à la guerre et s'allonger à ses côtés. Une façon de boucler la boucle et de mettre le célèbre metteur en scène en paix.
Gods and monsters ne se résume nullement à la carrière horrifique de James Whale ni à son penchant pour les hommes. C'est au contraire une fiction qui évoque tendrement et avec humour la fin de vie d'un vieil homme qui se rappellera à jamais son amour de toujours. C'est aussi une belle histoire d'amitié entre deux hommes, Jimmy Whale et Clay Boone, qui n'ont à la base rien en commun. L'acteur Ian Mc Kellen (le Gandalf du Seigneur des anneaux) est excellent dans le rôle de cet homme amateur de beaux éphèbes, prêt à tout pour réussir à ses fins. Brendan Fraser (Darkly Noon) est pour sa part également très bon pour jouer cet homme athlétique mais peu instruit et qui finit par comprendre ce que pense James Whale.
Au final, Gods and monsters est un très bon drame qui relate à sa façon la fin de vie de James Whale. Une sortie en DVD et/ou en blu ray de ce long métrage serait on ne peut plus méritée.
11) Home sweet home (France, 2013) de David Morley :
La critique du film :
Après une première incursion dans le genre avec Mutants (2009), un film de virus, le Français David Morley est de retour avec un “home invasion movie” intitulé tout bonnement Home sweet home.
Le scénario de Home sweet home est assez simple : un psychopathe s'introduit dans la maison d'une gentille petite famille. Il s'installe tranquillement dans la maison de ses futures victimes pour ensuite les séquestrer. Evidemment, avec un tel script, il est difficile d'être original dans un genre ultra balisé.
Pour autant, même si David Morley doit composer avec les codes du genre, il a plusieurs idées qui rendent son long métrage tout à fait intéressant, à défaut d'être novateur. Ainsi, on apprécie qu'il prenne son temps pour installer son film. Le tueur, dont on ne saura jamais les motivations, prend possession des lieux en installant divers objets, en verrouillant toutes les fenêtres et en neutralisant les systèmes de communication, de telle sorte qu'il devient quasi impossible de sortir de la maison une fois que l'on y est rentré.
En cela, la maison, dont on découvre progressivement les différentes pièces, devient indirectement un personnage à part entière du film. On se demande comment les protagonistes vont faire pour échapper au psychopathe qui a jeté son dévolu sur eux.
Cela fait l'objet de la deuxième partie du film. Evidemment, elle est bien plus démonstrative que la première. Cela étant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les scènes sanglantes ne sont pas nombreuses. Elles en sont d'autant plus marquantes. Elles bénéficient d'ailleurs de SFX tout à fait probants. La deuxième partie du film, même si elle est plus attendue, avec notamment un jeu du chat et de la souris qui se met en place entre le psychopathe et l'héroïne, apporte néanmoins quelques éléments originaux.
Mine de rien, avec Home sweet home, on se situe dans un film d'ambiance, qui maintient une tension permanente.
Côté distribution, les deux acteurs qui interprètent l'infortuné couple sont probants dans leurs rôles respectifs.
En synthèse, si Home sweet home investit un champ horrifique qui a déjà donné lieu à de très nombreuses productions, le film parvient malgré tout à tirer son épingle du jeu.
12) Modus anomali, le réveil de la proie (2012, Indonésie) de Joko Anwar
La critique du film :
Quatrième film du jeune cinéaste indonésien Joko Anwar, Modus anomali : la proie du tueur a été désigné par le rédacteur en chef du magazine Mad Movies, comme un film transgenre.
Dès le début, on est plongé dans une ambiance étrange. On aperçoit un homme qui sort de terre au milieu de nulle part, dans une forêt. Se demandant bien ce qui lui arrive, cet homme entre dans une maison en bois où des indications l'invitent à visionner une vidéo. On songe alors à la saga des Saw. D'autant que la vidéo nous montre une femme qui se fait égorger en direct.
Et pourtant, on est bien loin du compte. Car jusqu'à la fin du film, la surprise va être de rigueur. Le principal personnage du film apprend qu'il est l'époux de la femme qu'il a vu se faire égorger, et qu'il a deux enfants. Il ne sait pas dans quelle galère il se trouve.
Et le spectateur n'en sait pas plus. Le réalisateur aime jouer avec son auditoire en disséminant ça et là des des pistes à suivre. Mais le film a toujours un coup d'avance et il est bien difficile de deviner ce qui va se passer.
A la fin, le film retombe bien sur ses pieds, avec une originalité certaine, dans un cinéma de genre qui est pourtant souvent ultra balisé.
En plus d'un scénario subtil et bien vu dans l'ensemble, le film bénéficie de plusieurs autres qualités. La photographie du film est superbe. Le directeur photo a très bien su tirer parti de l'environnement naturel dans lequel a été tourné Modus anomali.
Deuxième qualité : l'interprétation du film. L'acteur Rio Dewanto, qui joue le rôle de John Ewans, est particulièrement crédible. Cet acteur interprète très bien son personnage. Il a sans nul doute de l'avenir au niveau de sa carrière.
Et puis dernier avantage, qui a déjà été évoqué précédemment, le film est transgenre et ne peut donc pas être rangé dans un type de film en particulier. On va de surprise en surprise et l'ambiance de ce long métrage est pour le moins étrange. Si le terme est souvent galvaudé, on peut raisonnablement affirmer que Modus anomali a une atmosphère quasi lynchienne.
Au final, si Modus anomali : le réveil de la proie est un film surprenant, il constitue une bonne surprise.
13) Possession (1981, France / RFA) d'Andrzej Zulawski :
La critique du film :
Le festival Hallucinations collectives a gâté ses spectateurs, leur donnant l'occasion rare de visionner le film Possession de Zulawski dans une copie 35 mm. En préambule, on a eu droit à une présentation du film par Nicolas Boukhrief qui nous a fait part de son amour pour ce film, à tel point qu'il a été jusqu'à devenir à un moment donné assistant réalisateur de Zulawski.
Pour revenir au film, Possession est clairement un film de Zulawski puisqu'il rentre très bien dans sa filmographie. C'est un film qui sur un couple qui se désagrège. Les rapports entre les différents protagonistes sont très violents, tant d'un point de vue physique qu'au niveau des dialogues. Les mots échangés entre les personnages sont loin d'être anodins et contribuent à une réflexion sur les rapports hommes – femmes. A titre non exhaustif, on peut relever les phrases suivantes : “Je suis le seul dans ta vie à avoir des droits car je n'en réclame aucun” ; “Je suis en guerre contre les femmes car elles sont dangereuses”.
La mise en scène très dynamique, voire même chaotique, se met au rythme des sentiments exacerbés des personnages du film. Sur ce point, la scène du métro est inoubliable avec une Isabelle Adjani quasi hallcucinée qui bouge, hurle dans tous les sens et paraît en transe.
A noter que ce film comporte un aspect fantastique avec cette créature visqueuse qui réside dans l'appartement crasseux du personnage joué par Isabelle Adjani. Cette créature étrange entretient des rapports étroits avec cette dernière et prend progressivement forme humaine, ce qui ne fait que renforcer l'aspect paranoïaque du film.
Même s'il ne manque pas de qualités, Possession n'en demeure pas moins un film exigeant, qui demande une certaine attention du spectateur.
05.09.12

Nouveau venu dans la catégorie des festivals de cinéma, Champs-Elysées film festival s'est invité pendant une semaine – du 6 au 12 juin 2012 – sur la plus prestigieuse avenue du monde.
Les organisateurs ont souhaité apporter un nouvel éclat aux Champs-Elysées sur le plan culturel, permettant au public de visionner des avant-premières de films américains et de films français, mais aussi plusieurs rétrospectives de qualité.
Pour ma part, je me suis rendu sur le festival durant le week-end des 9 et 10 juin 2012, ce qui m'a tout de même permis pendant ce laps de temps relativement court de regarder sept films.
J'ai constaté une organisation au top, surtout si l'on considère qu'il s'agit de la première édition de ce festival.
D'abord, j'ai pu récupérer avec une grande facilité le festival pass (qui donne accès à toutes les séances), qui était au prix très convenable de 35 euros. Ensuite, je me suis rendu dans les salles de cinéma qui participaient au festival. On notera sur ce point que les organisateurs ont eu la bonne idée d'utiliser des lieux de projection très proches les uns des autres, ce qui permet au spectateur de pouvoir passer sans souci d'un cinéma à l'autre, sans être pressé par le temps.
Photos-0006D'autant que même si les salles étaient plutôt pleines, il n'y a eu que peu d'attente au pour entrer dans les salles. Autre point très positif : les films ont tous été lancés dans les temps qui étaient indiqués sur le programme.
Au niveau de la programmation, Champs-Elysées film festival proposait une sélection très riche et hétéroclite avec une prédominance de films américains. Il était possible de voir, outre des avant-premières et de rétrospectives de films américains, des films étrangers ayant concouru pour l'oscar du meilleur film étranger.
Et puis comme on est dans un festival, il y avait naturellement des invités. Les séances étaient agrémentées pour certaines d'elles de la présence de réalisateurs et d'acteurs des équipes des films projetés. Si je n'ai pas eu le plaisir d'assister aux interviews de Donald Sutherland, de Michael Madsen ou encore de Lambert Wilson, j'ai pu écouter avec intérêt les interventions des équipes des films de Blank city et de Not waving but drowning.
De mon côté, j'ai été particulièrement proche de la thématique dominante du festival en voyant six films américains sur sept visionnés, le 7ème étant par ailleurs le film canadien ayant concouru à l'oscar du meilleur film étranger.
Au final, j'ai été très satisfait par ce nouveau festival de cinéma, en espérant qu'une deuxième édition aura lieu l'an prochain.
En attendant, je vous invite à lire ci-après mon avis sur les sept films que j'ai eu le plaisir de regarder.
Les séances du samedi 9 juin 2012 :
1) Brake de Gabe Torres :

La critique du film : Réalisé par Gabe Torres, Brake (qui signifie en français kidnapping) raconte l'histoire d'un homme, travaillant pour les services secrets américains, qui est emprisonné dans le coffre d'une voiture. La question est évidemment de savoir ce que veulent ses ravisseurs, ce qu'ils attendent de lui. On ne tarde pas à le savoir. Il faut qu'il dise où se trouve « Roulette », un bunker de repli du président américain.
Pour arriver à leurs fins, les kidnappeurs sont prêts à tout. C'est d'ailleurs l'une des grandes qualités du film. En effet, l'agent Jeremy Reins est victime tout à la fois de torture physique et de torture mentale
Les rebondissements dans ce film sont nombreux et on ne s'ennuie pas une seconde. On a l'impression d'assister à un film d'action mené tambour battant, à l'image d'un épisode de 24 heures chrono.
Par ailleurs, si le film se suit plutôt bien, c'est aussi et surtout grâce à la performance de Stephen Dorff qui est tout bonnement excellent dans le rôle de l'agent Jeremy Reins.
Pour autant, malgré des qualités évidentes, Brake est plombé par certains défauts qui mettent à mal l'intérêt du film.
D'abord, il faut bien remarquer que le film manque singulièrement d'originalité. L'histoire de cet homme qui est enfermé et pris en otage par des terroristes rappelle étrangement le film Buried. Mais surtout, Brake se saborde de lui-même dans son épilogue. En effet, la fin à twists est aussi incroyable que stupide.
Mon avis sur le film en quelques mots : Un film d'action globalement efficace, qui souffre d'un final peu crédible.
2) Terri d'Azazel Jacobs :
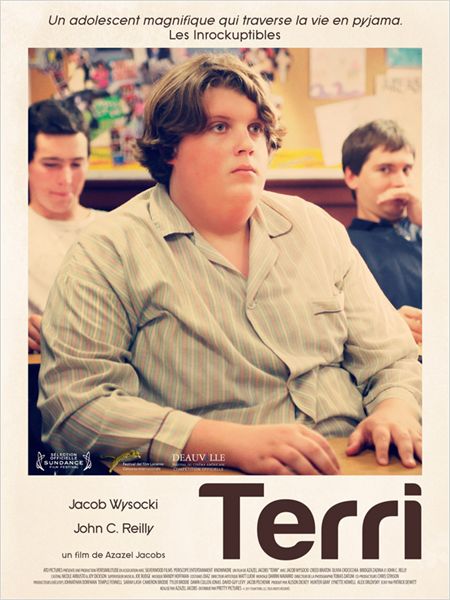
La critique du film : Réalisé par Azazel Jacobs, Terri est un adolescent, au physique disgracieux, qui vit avec son vieil et s'occupe de son vieil oncle. Terri est présenté comme un jeu homme qui se sent mal dans sa peau. Vivant reclus, n'ayant pas d'amis, il est même la risée de son lycée où il vient bien souvent en pyjama. Certains élèves se moquent de son physique en l'appelant « gros tas » ou encore « gros nibards ».
Cette chronique adolescente douce-amère va cependant proposer une évolution de son principal personnage. Et pour cela, Terri va pouvoir compter sur le soutien indéfectible du principal de son lycée, qui est décidé à l'aider coûte que coûte. Tout le film est fondé sur cette relation pleine de sensibilité et de subtilité.
Terri va progressivement s'ouvrir aux autres et se faire de nouveaux amis. Rempli d'humanisme, le film n'oublie pas pour autant d'être très drôle par instants : entre les remarques du principal, de Terri, de Chad, on a droit à de sacrés moments de rigolade. Sans compter que certaines scènes sont volontairement très drôles, comme cet épisode où le prêtre vient célébrer un enterrement et s'en va directement après avoir parlé en latin.
Film tout à la fois drôle et touchant, qui place la vie au centre de tout, Terri est un film très intéressant à regarder.
La réussite du film est sans nul doute due à son excellent casting, où l'on retient notamment les compositions de Jacob Wysocki dans le rôle de Terri et de John C. Reilly dans celui du principal.
Voilà à mon sens le meilleur film que j'ai vu lors de ce festival.
Mon avis sur le film en quelques mots : Une chronique sociale attachante et pleine de sensibilité.
3) Summertime de Matthew Gordon :

La critique du film : Mis en scène par Matthew Gordon dont c'est le premier film, Summertime est une chronique familiale qui montre clairement que tout n'est pas facile dans la vie et que certains restent des exclus de la société.
De manière plus générale, le film met à mal le rêve américain avec ce grand frère, Lucas, qui revient dans sa famille mais qui a tout raté alors qu'il était il y a quelques années un jeune espoir au niveau du football américain.
Cela étant dit, le film porte son attention dans cette histoire sur le frère cadet, Robbie, pour qui tout n'est pas rose – il n'a pas de père et sa mère est absente - mais qui tente de s'en sortir. Ce garçon un peu sauvage est décidé à ne pas se laisser faire ni à laisser insulter sa famille : « Un nom c'est tout ce qu'on a. »
Le film établit bien les rapports très étroits entre Robbie et son jeune frère qui passent beaucoup de temps ensemble et les rapports beaucoup plus contrariés entre Robbie et Lucas.
Le film comprend à de nombreuses la voix off de William Ruffin, jeune acteur prodigieux qui interprète avec beaucoup de naturel le rôle de Robbie, et qui indique ses états d'âme à son professeur par le biais d'une lettre.
Summertime est par ailleurs un film quasi poétique avec une musique calme et une insistance sur des paysages naturels qui rappellent le cinéma de Terrence Malick. Cette poésie ne sera pas forcément du goût de tout le monde, certains spectateurs pouvant considérer qu'elle donne un côté dérythmé au film.
Summertime est au final une sympathique découverte, qui vaut surtout pour l'interprétation de son jeune acteur principal.
Mon avis sur le film en quelques mots : Une chronique familiale réaliste, portée à bout de bras par un jeune acteur au talent remarquable.
4) Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau :

La critique du film : En adaptant avec Monsieur Lazhar la pièce d'un dramaturge québécois, le cinéaste Philippe Falardeau signe là sans conteste son meilleur film. Le pari n'était pourtant pas gagné d'avance car le film aborde des sujets difficiles et sensibles tels que le suicide et la politique en matière d'immigration.
Ici, suite au suicide d'une institutrice, un homme, Bachir Lazhar propose ses services à la directrice d'école pour enseigner aux enfants (âgés de 12 ans) qui n'ont plus de professeur. Le film réussit adroitement à dépasser ses thématiques de base pour montrer que chacun a des zones d'ombre (culpabilité) mais que chacun recèle en lui une véritable humanité (rédemption). La question du remords plane sans cesse au-dessus de ce film, sans qu'il y ait pour autant d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Évitant tout manichéisme, le film fait preuve d'une vraie finesse et d'une véritable ouverture d'esprit. Si le personnage s'appelle Lazhar, ce n'est manifestement pas un hasard. On peut penser que c'est une façon pour le réalisateur de faire écho à ce personnage qui a ressuscité. L'évolution du personnage principal du film quant à sa situation sur le plan de l'immigration et le pardon des enfants en partie responsables du suicide de leur institutrice sont sans aucun doute des éléments qui font penser à Lazare.
Film très subtil qui ne cède jamais à la facilité sur le plan moral et qui ne se montre pas insistant sur la politique de l'immigration, Monsieur Lazhar est un film qui laisse au spectateur la possibilité de se forger sa propre opinion. Ce long métrage a largement mérité d'être présent à l'oscar du meilleur film étranger.
Mon avis sur le film en quelques mots : Un drame qui évite brillamment tout manichéisme.
5) Tabloïd de Errol Morris :

La critique du film : Mis en scène par Errol Morris, Tabloïd est un film documentaire qui s'intéresse au personnage complètement excentrique et farfelu que constitue Joyce McKinney. Cette femme, ex-miss Wyoming, s'est rendue célèbre pour avoir kidnappé un missionnaire mormon dont elle était tombée follement amoureuse. Le film comprend des interviews récentes avec notamment Joyce McKinney qui explique son histoire de son point de vue et d'autres protagonistes qui apportent des éléments d'explications. Ce long métrage est également agrémenté de vidéos et de photos d'époque.
Si ce fait divers paraît quelque peu incroyable, le réalisateur du film joue à fond la carte de l'humour. En effet, de nombreux propos de Joyce McKinney apparaissent quasiment comme surréalistes. De plus, le film est entrecoupé d'images tirées d'autres films, de photos montages, de petites séquences d'animation, ou de mots inscrits sur l'écran (impuissance ; vérité) qui donnent un côté décalé et drôle à l'ensemble.
Ce documentaire relate d'abord cette histoire d'amour impossible ; puis le fait que les tabloïds ont profité du passé pour le moins flou de Joyce (était-elle dans sa jeunesse une prostituée?) pour en faire leurs gros titres ; et enfin l'événement incroyable où Joyce a souhaité cloner son chien décédé.
La phrase de Joyce qui raconte vers la fin du film : « Comme l'a dit Brigitte Bardot, j'ai donné ma jeunesse aux hommes, je donne ma vieillesse aux chiens » est révélatrice de l'état d'esprit particulier de cette personne et du ton pour le moins léger et amusant de ce documentaire.
Mon avis sur le film en quelques mots : Un documentaire plein d'humour sur une histoire extravagante.
6) Blank city de Céline Danhier :

La critique du film : La jeune cinéaste française Céline Danhier a mis en scène un film documentaire sur le New York des années 70, en s'intéressant aux quartiers pauvres et crasseux de la ville qui a été celle d'une grande richesse sur le plan du cinéma et de la musique.
A la vue de Blank city, on imagine aisément que sa réalisatrice a dû passer beaucoup de temps à préparer son film. Car il y a de très nombreuses interviews avec des protagonistes de l'époque et de très nombreux extraits de films ou de concerts qui sont très rares voire carrément invisibles du côté de la France.
Tous ces films se révèlent de véritables curiosités de nos jours, des films transgressifs qui ne sont « peut-être naïfs et maladroits mais intègres et sincères ».
A cette époque où New York apparaît dans certains quartiers à l'état d'abandon (on voit des bâtiments abandonnés, délabrés), certains jeunes gens sans le sous ont décidé de faire preuve d'un véritable système D pour tourner des films.
Ce film qui montre par ailleurs l'interaction des artistes new-yorkais à cette époque entre la musique « no wave » (à ne pas mélanger avec la new wave) et le cinéma, est plaisant à regarder, d'autant qu'on a en fond une bande son tout à fait entraînante.
Cela dit, on reste quand même un peu sur sa faim. Car à moins d'être un connaisseur du New-York de cette époque, on finit par être un peu perdu avec un documentaire qui passe d'une personne sans que l'on est l'impression qu'il y a un fil directeur derrière tout ça.
En outre, le contexte socio-économique et culturel aurait pu faire l'objet d'explications. De même, certains éléments qui sont abordés ne sont que survolés, comme par exemple l'arrivée du sida ou la transformation de la ville de New York qui devient l'apanage des riches.
Au final, Blank city constitue un documentaire très riche au niveau des interviews et des extraits d'archives mais qui manque quelque peu d'explications qui auraient eu le mérite de le rendre plus clair.
Mon avis sur le film en quelques mots : Un documentaire avec de nombreuses images d'archives qui manque d'explications pour le néophyte.
7) Not waving but drowning :

La critique du film : Sur le papier, Not waving but drowning, est l'un des films les plus intéressants de ce festival. En effet, le synopsis raconte que deux amies, très proches l'une de l'autre, vont être amenées à évoluer chacune de leur côté. Le film entend montrer en filigranes le passage de l'adolescence à l'âge adulte.
Quoi d'ailleurs de plus logique pour filmer nos deux héroïnes que de disposer d'une réalisatrice ? C'est la cinéaste Devyn Waitt qui est derrière la caméra pour mettre en scène ce film. Elle a d'ailleurs l'avantage de filmer deux actrices principales, Vanessa Ray et Megan Guinan, qui sont confondantes de naturel. Elles représentent sans conteste la qualité première du film. Au crédit du film, on peut aussi noter une musique pop qui apporte un vrai plus et quelques scènes oniriques quasi évanescentes qui sont plaisantes à regarder. Et c'est tout au niveau des points positifs.
Malheureusement, le film est plombé par un certain nombre de défauts. Le premier est ce prélude intitulé « le côté féminin qui est en vous » dont on ne voit pas franchement le lien avec le reste du film. Le second est une photographie qui est par moments plutôt laide (à moins qu'il ne s'agisse d'une volonté de produire un côté « réaliste » à ce long métrage). Surtout, le film paraît complètement dérythmé et les histoires de ces deux jeunes filles peinent sérieusement à passionner le spectateur. Du coup, on s'ennuie quelque peu ce qui est fort dommage car il y avait matière à faire quelque chose de bien. Not waving but drowning constitue donc une réelle déception. Et c'est la seule de ce festival.
Mon avis sur le film en quelques mots : Un film sur deux post-adolescentes servi par de bonnes actrices mais qui souffre d'un défaut de rythme.
13.06.12
Petit retour d'expérience sur l'excellent festival Hallucinations collectives, qui a lieu chaque année à Lyon :

Pour Pâques, quand on est petit, on part dans le jardin chercher les œufs.
Pour Pâques, quand on devient grand, il faut aller à Lyon. Pourquoi ? Car c'est durant cette période que se déroule l'excellent festival de cinéma Hallucinations collectives.
Hallucinations collectives est un festival organisé chaque année au cinéma Le Comoedia par une association de passionnés, Zonebis.
Pour reprendre les termes de la présentation de cette deuxième édition sur son site Internet, Hallucinations collectives cherche à faire découvrir aux spectateurs des « films oubliés », des « nouveautés frapadingues » et le tout avec des « invités iconoclastes ».
Pour ma part, j'ai pris plaisir pendant le week-end pascal à assister à la bagatelle de onze films (sur un total de vingt trois longs-métrages projetés), constitués d'avant-premières ou de films rares. Tous ont fait l'objet de présentations qui augmentaient l'envie de regarder ces films.
Le plaisir de participer à Hallucinations collectives a été décuplé par le fait de pouvoir discuter aussi bien avec les membres de Zonebis qu'avec des spectateurs ravis par le programme du festival.
Il est toujours appréciable de pouvoir discuter de cinéma avec des gens qui apprécient toutes sortes de films
Un rapide bilan s'impose. A cet effet, il convient de noter la grande qualité globale de ce festival.
Au niveau des avant-premières, j'ai eu l'occasion de découvrir le très intéressant film Red state de Kevin Smith qui tire à boulets rouges sur les travers de la société américaine. Ce film était personnellement mon favori pour remporter le prix du meilleur long-métrage.
J'aurais également mis quelques pièces sur la comédie frapa-dingue Detention (une sacrée exclusivité!) de Joseph Kahn qui n'est pas piquée des hannetons et se révèle sans conteste le film le plus « hallucinant » de la sélection.
Au rang des satisfactions, on compte aussi deux films post-apocalyptiques : le très maîtrisé Hell du jeune suisse allemand Tim Fehlbaum et le très sombre The divide de Xavier Gens.
The theatre bizarre n'est pas mal non plus, même si les sketchs de ce film qui rend hommage au grand-guignol sont de niveau très variables.
En fait, le seul film qui m'a déçu est le polar atypique Kill list qui souffre d'un défaut de rythme et d'une fin incongrue. Ce film n'a manifestement pas déplu à tout le monde puisque le jury d'Hallucinations collectives lui a délivré le prix du meilleur long-métrage.
Du côté des films remis au goût du jour l'espace d'une séance, Hardware et Dust devil de Richard Stanley ont représenté de véritables expériences. Ces films ont été d'autant plus plaisants à voir que chaque film a été précédé d'une présentation par Richard Stanley, invité d'honneur du festival. Ce dernier s'est d'ailleurs montré très disponible sur le festival, étant toujours prêt à répondre très gentiment aux questions des spectateurs.
Dans le style des curiosités qui marquent durablement la rétine, Schizophrenia obtient sans nul doute la palme. Ce film qui se focalise sur le quotidien d'un serial-killer est très malaisant par son aspect documentaire très réaliste.
Le film Les lèvres rouges, qui s'inscrivait dans la rétrospective La Belgique interdite, propose pour sa part une œuvre fantastique très étrange, qui se démarque des films de vampires des années 70.
De manière plus conventionnelle, j'ai revu sur grand écran l'excellent Total recall de Paul Verhoeven, qui faisait partie de la rétrospective dédiée à Philip K. Dick. Le film n'a décidément pas vieilli d'un iota et est toujours un pur chef d'oeuvre de la science fiction !
Comme l'année précédente, les longs-métrages en compétition ont été précédés de courts tout à fait plaisants à regarder. On pourra notamment signaler le déjanté A function, qui est caractéristique du style gore et décomplexé de la Corée du Sud. Sa jeune réalisatrice a bien mérité le prix du meilleur court-métrage. Signalons aussi la grande maîtrise formelle du court nommé Hope de Pedro Pires (Canada) qui avait remporté le grand prix au PIFFF.
En somme, le cru 2012 du festival Hallucinations collectives a été très bon.
On attend désormais qu'une chose : revenir sur ce festival qui aura lieu pour sa prochaine édition du 28 mars au 1er avril 2013, au cinéma Le Comoedia à Lyon.
Vous savez donc quelles dates sont à bloquer sur votre agenda l'année prochaine !
08.03.11
Suite du coup de projecteur sur 10 films ayant marqué les années 2001 à 2010.
Cette fois on traite des années 2006 à 2010 :
2006 : Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro (Etats-Unis) ;
2007 : Anna M de Michel Spinosa (France) ;
2008 : There will be blood de Paul-Thomas Anderson (Etats-Unis) ;
2009 : Morse de Tomas Alfredson (Suède) ;
2010 : Le soldat dieu de Koji Wakamatsu (Japon).

2006 : Une année prolifique sur le plan cinématographique
En cette année 2006, les chefs d’œuvre sont de sortie. Le choix a donc été draconien. Le regard aurait aussi bien pu se porter sur La vie des autres du jeune cinéaste allemand Florian von Donnersmarck que sur l'excellent Black book de Paul Verhoeven. Mais non la première place va revenir à Guillermo del Toro. Réalisateur de plusieurs films reconnus dans le genre avec Mimic (1997), L'échine du diable (2002) et Blade 2 (2002), Guillermo del Toro rentre avec Le labyrinthe de Pan dans une nouvelle dimension.
Ce film joue astucieusement sur deux aspects antinomiques : la réalité avec en 1944 la guerre d'Espagne en toile de fond et le rêve avec ce conte qu'est amené à vivre une petite fille. De manière particulièrement adroite, del Toro mélange ces deux éléments. La mise en scène est d'ailleurs d'un incroyable dynamisme, de telle sorte que l'on est emporté par cette histoire.
D'un côté, on a la petite Ofélia qui vit avec sa maman et a peur de l'homme que cette dernière fréquente, le terrible Vidal, capitaine de l'armée franquiste. D'un autre côté, la petite Ofélia vit des aventures extraordinaires par le biais du dieu Pan.
Mais ces êtres merveilleux existent-ils vraiment ou ne sont-ils pas tout simplement le fruit de l'imagination de cette jeune fille pour échapper à la réalité ? Car le quotidien est loin d'être plaisant avec un Vidal qui représente à lui seul le fascisme. Sergi Lopez est à cet égard parfait dans le rôle de Vidal ; il représente sans conteste un des « méchants » les plus impressionnants et les plus charismatiques de l'histoire du cinéma.
Film magistral où il y a une antinomie entre fascisme et merveilleux, Le labyrinthe est rempli d'images fabuleuses. Sa fin est a fortiori très réussie. Ce film marque durablement la rétine.
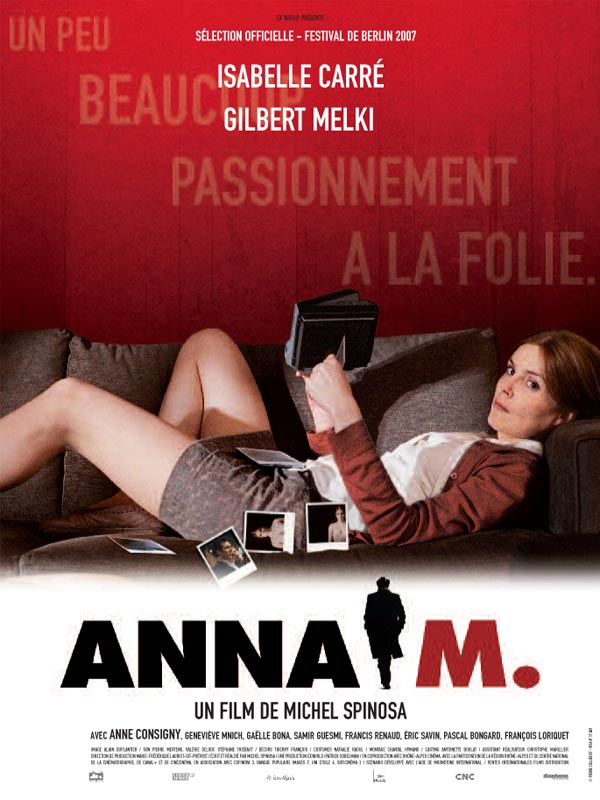
2007 : Un cinéaste français surprend son monde
Comment penser que le réalisateur de La parenthèse enchantée (2000), chronique sur les années post 1968, film certes sympathique au demeurant mais pas vraiment transcendant, serait capable de livrer un drame d'une grande intensité ? Pas grand monde.
Et pourtant, en traitant à l'écran le cas d'une érotomane amoureuse d'un médecin père de famille, le réalisateur Michel Spinosa dresse le portrait d'une femme excessive, qui n'en demeure pas moins humaine.
A cet égard, la composition d'Isabelle Carré est époustouflante dans le rôle de cette femme amoureuse à la folie. Le tour de force de Michel Spinosa est de mettre le spectateur en empathie avec ce personnage d'Anna alors que celle-ci commet des actes répréhensibles. Preuve que le personnage d'Anna a parfaitement été travaillé, évitant toute caricature.
A noter également l'excellente interprétation de Gilbert Melki dans le rôle du médecin dont est amoureux Anna. Évidemment, le film ne serait pas aussi réussi sans une mise en scène bien adapté à son sujet, où Michel Spinosa filme au plus près du corps d'Isabelle Carré.
Ce grand film est aussi la preuve que le cinéma français peut encore faire de grandes choses.

2008 : Un film de Paul-Thomas Anderson confirme tout le bien que l'on pense de ce réalisateur
Auteur de films d'excellente facture avec Magnolia (2000) et Puch drunk love (2003), Paul-Thomas Anderson a l'habitude de prendre son temps. Bien lui en a pris car avec There will be blood il donne au spectateur une fresque sociale d'une grande intensité, malgré sa durée de 2h38.
Ce film commence par la découverte d'un premier puits de pétrole au début du XXème siècle par le personnage de Daniel Plainview jusqu'à la crise de 1929. There will be blood dresse le portrait d'un incroyable self-made-man, ce Daniel Plainview, prêt à tout pour réussir. Cet homme s'avère être quelqu'un d'aussi sombre sur le plan relationnel que le pétrole qu'il chérit tant. Daniel Day-Lewis a très logiquement obtenu l'oscar du meilleur acteur pour ce rôle.
On notera également la composition de Paul Dano, excellent en prêtre radical. Pour parachever le tout, on a droit tout au long du film à une mise en scène fluide, à une superbe photo et enfin à la musique inspirée de Jonny Greenwood (guitariste du groupe de rock alternatif Radiohead).
En somme, le jeune Paul-Thomas Anderson (il est né en 1970) prouve avec ce film qu'il est un auteur américain surdoué, pétri de talent.

2009 : La Suède fait un retour fracassant sur le devant de la scène
Avec une avalanche de films sur la thématique du vampire, difficile de renouveler ce mythe. C'est pourtant ce que réussit brillamment à faire le réalisateur suédois Tomas Alfredson, qui offre une vision originale du vampire que l'on n'avait pas vu depuis l'excellent Aux frontières de l'aube (1988) de Kathryn Bigelow.
Dans Morse, le fait d'être immortel n'est pas ressenti comme une bénédiction, c'est plutôt le fait de devoir tuer des gens pour se nourrir qui est vécu comme un fardeau.
Le cinéaste Tomas Alfredson ne se contente pas de brosser un film fantastique. Au contraire, le fantastique n'est qu'un des éléments de son film.
Morse se déroule dans les années 80 dans une petite ville de Suède où le temps est particulièrement peu clément puisqu’il y fait très froid et la neige est omniprésente. Dans ce cadre où la vie semble assez rude, on va suivre la rencontre entre deux personnages qui sont rejetés, exclus par le monde qui les entoure. Dans Morse, on assiste ainsi à une belle histoire d'amitié/d'amour pur entre deux êtres très différents : Oskar, un jeune garçon blond de 12 ans qui est martyrisé par ses camarades de classe et Eli, une jeune fille brune, énigmatique, qui se révèle être un vampire.
La mise en scène de Tomas Alfredson est parfaite, privilégiant des gros plans sur les visages qui permettent ainsi de voir les beaux yeux bleus d’Eli, ce qui renforce le côté mystérieux voire envoûtant (ne pas oublier qu’elle est un vampire) de son personnage. Les rapports entre Oskar et Eli sont très forts, ce que rappelle sans équivoque l'une des très belles scènes finales du film. Chronique fantastique d’une grande sensibilité, Morse est un véritable bijou.

2010 : Le Japon retrouve les sommets
Le soldat dieu est évidemment le plus récent de cette liste puisqu'il n'est sorti sur les écrans français qu'en décembre 2010. Dans une année 2010 où les grands films se comptent sur les doigts d'une main, le cinéaste Koji Wakamatsu a su tirer son épingle du jeu avec son histoire de lieutenant de l'armée japonaise revenu de la guerre sino-japonaise en héros mais privé de ses bras et de ses jambes.
Si le film de Wakamatsu mérite de figurer en bonne place, c'est en raison de thématiques fortes qui y sont développées : le cinéaste s'en prend clairement à un nationalisme aveuglant mais aussi à un machisme ambiant.
Pour Wakamatsu, l'expression de soldat-dieu n'a rien d'honorable. Elle renvoie en fait à un nationalisme exacerbé. Dans le film, on voit par exemple qu'il y a une propagande de tous les instants qui est véhiculée par le média présent partout à l'époque, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, à savoir la radio. Du coup, tout le monde ou presque se met à la cause de l'Empire.
Ce soldat dieu est aussi le symbole du machisme ambiant de l'époque. Cet homme-tronc, le lieutenant Kurokawa, ne peut plus que manger et dormir. Pour autant, il continue d'exprimer ses envies à son épouse. Sa femme, Shigeko est sous son emprise. Seulement, le réalisateur a la bonne idée de montrer qu'en temps de guerre, les rapports de force ne sont plus les mêmes, a fortiori quand on est fortement handicapé. Shigeko en vient progressivement à se venger. Cette révolte ne peut être que salutaire.
Par ailleurs, le lieutenant Kurokawa, est in fine le symbole d'un Japon en pleine déconfiture. Son suicide coïncide d'ailleurs avec la fin de la guerre marquée par la capitulation de l'empire du Japon le 15 août 1945. Du début à la fin du film, la guerre est au demeurant vilipendée par son inutilité. Ce n'est pas anodin si la dernière image du film est celle de la bombe atomique.
Wakamatsu réalise ainsi avec Le soldat-dieu un film extrêmement abouti qui se révèle un formidable plaidoyer contre la guerre. Dans un style très sec et sans concession, le cinéaste en profite également pour s'insurger contre une société japonaise des années 40 alors rétrograde, tant par son nationalisme exacerbé que dans les relations entre hommes et femmes.
C'est la fin de cette rétrospective. On se donne rendez-vous dans dix ans pour la rétrospective des dix meilleurs films des années 2011 à 2020 !
07.03.11
Alors que l'on commence l'année 2011, un petit rappel sur des films ayant marqué les dix dernières années ne manque pas d'intérêt.
Cette rétrospective, qui se base sur mon film préféré de chaque année, est forcément subjective mais elle met tout de même en valeur dix films qui ont fait parler d'eux lors de leur sortie et qui continuent pour certains à marquer durablement le septième art.
Les films en question :
2001 : La chambre du fils de Nanni Moretti (Italie) ;
2002 : Parle avec elle de Pedro Almodovar (Espagne) ;
2003 : Le retour du roi de Peter Jackson (Etats-Unis) ;
2004 : Old boy de Park Chan-Wook (Corée du Sud) ;
2005 : The descent de Neil Marshall (Royaume-Uni) ;
Les films des années 2006 à 2010 seront dévoilés dans la partie 2 de ce dossier !

2001 : L'année de Nanni Moretti
Le renouveau du cinéma italien n'a pas encore débuté que déjà l'un de ses fers-de-lance, Nanni Moretti, se fait particulièrement remarqué en cette année 2001 où il obtient la palme d'or avec La chambre du fils.
Réalisateur italien engagé, comme le prouvent ses derniers films (Le caiman), Nanni Moretti est aussi capable de faire des longs métrages d'une grande sensibilité, à la thématique universelle. C'est le cas ici avec La chambre du fils où il interprète lui-même le rôle principal du film, celui d'un père de famille qui a bien du mal à faire le deuil de son fils.
Ce film montre très subtilement la dislocation des relations au sein d'une famille suite à la mort accidentelle d'un enfant.
Toujours situé dans un ton juste, le film de Nanni Moretti ne sombre jamais dans le pathos. Au contraire, le cinéaste italien manifeste à travers ce film une sensibilité à fleur de peau. La fin du film, vue comme une ouverture vers l'extérieur, est bien dans l'idée que la vie doit continuer malgré tout.
Voilà un très beau film, où tous les acteurs jouent parfaitement leur rôle (en plus de Nanni Moretti, l'actrice Laura Morente est remarquable), qui constitue indéniablement une des palmes d'or de Cannes les plus justifiées.

2002 : Un film de Pedro Almodovar à l'honneur
Si Pedro Almodovar n'a pas eu droit pour sa part à une récompense majeure dans un des trois festivals incontournables (Berlin, Cannes et Venise), il n'empêche que ses films sont bien souvent d'une grande qualité. Avant de tourner Parle avec elle, Pedro Almodovar est dans une excellente phase, après avoir mis en scène des films tels que En chair et en os (1997) et Tout sur ma mère (1999).
Le cinéaste espagnol réalise même avec Parle avec elle un véritable chef d’œuvre sur un sujet pourtant particulièrement casse-gueule.
En effet, le film évoque tout de même une relation sexuelle qu'a un infirmier avec une femme tombée dans le coma, ce qui a pour effet de la ramener durablement à la vie. Autour d'un sujet que certains pourraient qualifier de prime abord de scabreux, le cinéaste réussit à tisser un drame d'une grande intensité, où finalement tous les personnages ont leurs raisons propres et où personne n'est à blâmer.
Pedro Almodovar en profite pour évoquer une thématique qui lui tient à cœur : la vie et la mort, et il rend grâce une fois de plus à la beauté des femmes, ici sous les traits des superbes Leonor Watling et Paz Vega.
Mis en scène brillamment, avec un superbe travail opéré sur la photographie, Parle avec elle est un film qui laisse aussi la part belle à ses acteurs. Voilà donc un film à voir ou à revoir.

2003 : Peter Jackson termine sa trilogie du seigneur des anneaux
Capable dans ses jeunes années de films d'horreur ultra gore avec Bad taste (1988) et Braindead (1993), Peter Jackson est également l'auteur de drames intimistes, d'une grande finesse comme Heavenly creatures (1996) ou Lovely bones en cette année 2010.
En adaptant le seigneur des anneaux, Livre le plus lu du vingtième siècle derrière la Bible avec un nombre incalculable de fans, Peter Jackson était donc attendu au tournant. Le résultat est à la hauteur des espérances.
Si ce troisième volet du seigneur des anneaux (après la communauté de l'anneau, sortie au cinéma en 2001 et les deux tours, sortie en 2002) est très axé sur les combats – comme dans le livre d'ailleurs – il donne lieu à de grands moments de bravoure et à des combats titanesques.
Certains moments du film restent durablement gravés dans les mémoires, comme lorsque les Rohirrim viennent au secours de Minas Tirith (certainement la plus belle scène de charge vue au cinéma) ou lorsque Eowyn affronte le terrible seigneur des Nazguls. Sans oublier le courage de Sam aux fins de secourir Frodon et de l'amener jusqu'à la montagne du destin. La fin du film est très émouvante avec tous les personnages principaux qui regagnent chacun des horizons différents.
Ce film clôt de manière admirable cette fantastique trilogie du seigneur des anneaux en atteignant une dimension dramatique rarement vue dans un blockbuster. On attend avec impatience Peter Jackson dans deux ans, lorsqu'il va nous montrer son adaptation de Bilbo le hobbit, qui devrait sortir en décembre 2012 puis en décembre 2013.

2004 : La Corée du Sud bouscule la hiérarchie établie
Si la Corée du Sud possède un auteur reconnu mondialement avec Im Kwon Taek,le renouveau de ce pays est assuré par de nouveaux cinéastes tels qu'Im Sang Soo, Lee Chang Dong, Hong Sang Soo et donc Park Chan Wook. Avec son film Old boy qui a obtenu le grand prix du festival de Cannes en 2004, ParK Chan Wook entre dans la cour des grands.
Et il faut dire que c'est mérité. Old boy constitue le deuxième film de la trilogie de la vengeance de Park Chan-Wook après Sympathy for Mr vengeance (2003) et avant Lady vengeance (2005).
Ce long métrage part d'un postulat pour le moins original avec Oh Dae-Soo, un père de famille au dessus de tout soupçon, qui est enlevé devant chez lui et qui est placé dans une cellule isolée. Il va rester 15 ans dans cette cellule avec une télévision mise à disposition pour lui montrer l'évolution de la société.
Évidemment, le spectateur ne sait pas plus qu'Oh Dae-Soo pourquoi il a été kidnappé ni pourquoi il a été enlevé. C'est alors qu'un jeu de pistes particulièrement tordu est créé par le ravisseur d'Oh Dae-Soo, jusqu'à une révélation étonnante qui est véritablement l'apothéose de ce film. Avant d'en arriver là, le réalisateur Park Chan-Wook aura fait montre de son talent de cinéaste avec une mise en scène d'une grande fluidité et des scènes inoubliables.
A cet effet, on a droit à des scènes surréalistes avec par exemple Dae-Soo qui sort d'une malete ou encore le ravisseur muni d'un masque à gaz qui observe Dae-Soo qui est endormi. Mais sans conteste la scène la plus marquante est ce superbe plan de séquence où Dae-Soo, armé d'un marteau, combat pendant plus de 3 minutes une douzaine d'hommes dans un couloir. Culte !
Marqué par la formidable performance de l'acteur Choi Min Sik dans le rôle d'Oh Dae-Soo, Old boy est un film inoubliable. Il est aussi le symbole de la montée en puissance de la Corée du Sud sur le plan cinématographique.
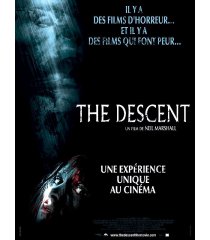
2005 : Le cinéma d'horreur revient en force
Pour les fans du genre, Neil Marshall est le cinéaste du bourrin mais inégal Dog soldiers, un film sur des militaires qui se font dégommer par des loups-garous.
Pourtant, réalisé par le même cinéaste,The descent constitue le choc de l'année 2005. Le réalisateur britannique transcende le genre (le cinéma d'horreur) pour donner lieu à un survival de grande classe.
Dans ce film, Neil Marshall met en scène six femmes – qui au demeurant se comportent comme des hommes – venues se débarrasser de leurs soucis quotidiens le temps d'un week-end en faisant de la spéléologie dans les Appalaches.
Dans un environnement hostile peuplé de monstres humanoïdes, ces femmes reviennent à une nature primitive et leur unique interrogation est de survivre. The descent est prenant de bout en bout dans un endroit obscur qui est à déconseiller aux claustrophobes.
La fin du film bénéficie d'un twist des plus intéressants qui ne laisse pas de place au happy end. Voilà un film majeur du cinéma d'horreur et même du cinéma tout court, à ranger aux côtés de films qu'il cite implicitement, Alien et Predator.
30.04.10

Compte rendu de la troisième édition de L'Etrange festival de Lyon, par Nicofeel :
S'étant déroulée du 31 mars au 6 avril 2010, la troisième édition du festival de Lyon a réuni un public de personnes curieuses manifestement plus important que les années précédentes.
Je n'ai pu être présent que lors du week-end des 3 et 4 avril 2010 mais cela m'a tout de même donné l'opportunité de voir plusieurs films rares, atypiques voire carrément déjantés. Bref des films qui rentrent parfaitement dans la thématique de L'étrange festival.
Je vous invite donc à lire ci-dessous mes avis à chaud sur les 5 films visionnés pendant le week-end.
1°) Villemolle 81 de Winschluss :

Pour commencer le week-end lyonnais et nous mettre directement dans l'ambiance du festival, les organisateurs ont eu la bonne idée de commencer par le déjanté Villemolle 81.
Le visionnage du film Villemolle 81 a été précédé par les bandes annonces des films Blackaria et Viva la muerte.
La direction de l'Etrange festival a eu la bonne idée (que l'on retrouve lors de chacune des séances) d'inclure un court métrage. Dans le cas présent, il s'agit de la soubrette à la tronçonneuse, un court animé avec des pâtes à modeler. Comédie et gore sont au rendez-vous de cette animation bien frapadingue signée par un japonais.
Mais revenons à Villemolle 81. Réalisé par Vincent Paronnaud (alias Winshluss), connu pour être le co-scénariste de Persépolis, Villemolle 81 est une comédie complètement délirante. Villemolle 81 se situe parfaitement dans l'esprit des Inconnus et de Groland.
Complètement déjanté, le film nous offre toute une clique de personnages du « terroir » plus atypiques les uns que les autres : il y a la secrétaire nymphomane, le maire persuadé qu'il va faire de son village une métropole (une plage antillaise sous l'effet de la remontée des eaux ! ; ou encore l'espoir d'un spectacle médiéval renommé), le super nounours joué par l'écologiste de service, Zoltar le chef d'une secte , Sébastien le garçon de ferme simplet.
Tout prête à rire dans ce film qui mélange fausse publicité (la présentation complètement ringarde de Villemolle), faux documentaire (le journaliste de de l'émission Charmants villages de France venu tourner un documentaire sur Villemolle) et qui n'hésite pas à utiliser des images complètement différentes : ainsi, on a droit tantôt à des images comprenant beaucoup de grain, des images saturées ou encore des séquences d'animation. Le tout donne lieu à un joyeux bordel à l'humour communicatif.
Les dialogues sont vraiment décapants et les situations complètement stupides. Malgré des effets spéciaux qui jouent ouvertement la carte de ringardise (on se croirait dans un film d'Ed Wood au niveau des effets spéciaux) et des acteurs qui sont réellement en roue libre, on prend un plaisir évident à regarder ce film.
D'autant que Villemolle 81 vire progressivement vers le film de zombie. Evidemment, pas le film de zombie à la Romero mais plutôt du zombie rigolard à la Peter Jackson.
En somme, voilà une première surprise agréable qui nous a fait débuter dans la joie et la bonne humeur ce week-end lyonnais.
2°) Marvel 14 : superhéros contre censure de Philippe Roure et Jean Depelley :

Le visionnage du film Marvel 14 a été précédé par les bandes annonces de Morgane et ses nymphes et de The broken imago, le prochain film de Douglas Buck produit par Metaluna (la société de Jean-Pierre Putters, le créateur du magazine Mad Movies).
La direction de l'Etrange festival a eu la bonne idée (que l'on retrouve lors de chacune des séances) d'inclure un court métrage. Dans le cas présent, il s'agit de Dolorosa, un court métrage de Christophe Debacq. Très bien filmé, le film est émaillé de nombreuses séquences-chocs où l'on retrouve une jeune femme enceinte. La violence allant en crescendo et la conclusion du court m'ont laissé quelque peu dubitatifs. Faisant clairement penser à Martyrs, je me demande quelles sont les intentions du cinéaste : choquer le spectateur ? Dénoncer la violence par la violence ? Voilà un court pour le moins sujet à controverse, surtout vu le lieu où il a été filmé.
Produit par Metaluna , Marvel 14 est un documentaire qui s'intéresse aux super-héros et à la censure. Les 2 réalisateurs, Philippe Roure et Jean Depelley signalent que l'étalonnage technique s'est achevé il y a seulement 2 jours. Quelques éléments imparfaits, notamment au niveau du son, sont donc à prévoir. Pourtant, la vision de ce film documentaire s'est déroulée sans accrocs particuliers.
Ce film documentaire s'intéresse au fameux numéro 14 de Marvel qui n'est jamais sortie officiellement mais que certaines personnes pourraient détenir. Au-delà du mystère suscitée par ce numéro auprès des nombreux fans de comics, le documentaire est surtout intéressant par sa capacité à évoquer la censure dans l'après-guerre. En effet, on apprend que la loi du 16 juillet 1949 crée une commission de censure contre la jeunesse. Celle-ci se justifierait par le fait que les mauvaises lectures des jeunes expliqueraient le taux de criminalité.
Les BD de comics vont faire l'objet de sévères censures. Quand la revue n'est carrément pas interdite de vente aux adolescents (le public cible de ce type de publications), elle fait en tout cas l'objet de nombreux aménagements pour permettre sa diffusion. Les éditions LUG, qui diffusent la bande dessinée Marvel, doivent remplacer de nombreuses onomatopées par rapport à l'oeuvre américaine originale. De nombreuses images qui véhiculeraient la violence et des mots grossiers sont aussi supprimés. L'oeuvre originale n'est pas respectée et le public français lit donc une version édulcorée des Marvel.
Sous des faux prétextes (la violence véhiculée par la BD), la France s'est donc lancée dans la censure afin de limiter en fait l'emprise des Etats-Unis, notamment une idéologie capitaliste et consumériste.
Le documentaire se révèle donc tout à fait instructif, même si le montage du film (voir les images de début et de fin) est tout de même quelque peu orienté vis-à-vis du public.
3°) Viva la muerte de Fernando Arrabal :

Note liminaire : Fernando Arrabal aurait dû être présent afin d'évoquer son film mais il a « planté » la direction de l'Etrange festival. C'est une réelle déception car son film est plus que jamais sujet à débat.
Le visionnage du film Viva la muerte a été précédé par les bandes annonces de Eating Raoul et de Lust in the dust.
La direction de l'Etrange festival a eu la bonne idée (que l'on retrouve lors de chacune des séances) d'inclure un court métrage. Dans le cas présent, il s'agit de The funk (L'angoisse), un court métrage australien de 7 minutes où un homme perd la mémoire et finit par se suicider. Ce court métrage de Cris Jones laisse quelque peu dubitatif quant à ses intentions.
Le film Viva la muerte est tiré du roman Baal Babylone de Fernando Arrabal. Les dessins de tortures que l'on voit notamment au début du film sont de Roland Topor.
Fernando Arrabal fait partie du mouvement Panique où l'on retrouve également Alejandro Jodorowsky et le dessinateur Roland Topor.
Dans ce film, qui est certainement l'un de ses plus radicaux, Fernando Arrabal dénonce sans ambages le franquisme, c'est-à-dire ce régime fondé par le général Francisco Franco de 1939 à 1977, qui est marqué notamment par un régime de parti unique, une liberté d'expression réduite et un catholicisme devenu religion d'Etat.
Ce régime est marqué par des arrestations et des exécutions sommaires. C'est ce qui nous permet de faire un lien direct avec ce film, Viva la muerte. Le film est vu à travers les yeux d'un enfant, dont le père, un communiste est recherché par le régime en place.
Cet enfant est sujet à de nombreuses hallucinations qui se caractérisent par de nombreuses images saturées dans le film (en rouge, en bleu), qui évoquent tantôt le personnage du père tantôt celui de la mère. Le côté oedipien de l'oeuvre est évident avec cet enfant très proche de sa mère qui l'observe non sans une certaine envie (cf l'image saturée en bleu où il la voit sous la douche ou encore quand il l'observe par le trou de la serrure).
En plus de cette histoire personnelle, Arrabal n'oublie à aucun moment de dénoncer le franquisme. C'est le cas lors des nombreuses séquences de tortures ou lorsqu'il évoque la religion. Il y a un côté clairement anti-clérical avec par exemple ce curé qui se retrouver à manger ses testicules. Ou encore dans une scène saturée où une religieuse est vue comme une truie.
Les images-chocs sont légion dans ce film. Parfois, c'est même à la limite du supportable. On peut même quelquefois se poser la question de la légitimité. Ainsi, dans les séquences où des animaux sont sacrifiés (comme dans les films de cannibales), quel est l'intérêt de tels procédés ? Ces actes paraissent tout de même quelque peu gratuits.
Au final, Viva la muerte est un film-choc, qui ne manque pas d'intérêt par les thématiques qu'il développe, mais tout cela est tout de même amoindri par une volonté de choquer le spectateur. Oeuvre radicale, elle peut tout autant fasciner que repousser le spectateur.
4°) Echo d'Anders Morgenthaler

Le visionnage du film Echo a été précédé par les bandes annonces des films La comtesse et Alice.
La direction de l'Etrange festival a eu la bonne idée (que l'on retrouve lors de chacune des séances) d'inclure un court métrage. Dans le cas présent, il s'agit de Nourriture spirituelle de Will Hartmann. Il s'agit d'un court de 8 minutes très drôle qui mélange comédie et horreur avec un professeur zombie qui invite ses élèves à manger des carottes et non des humains pour éviter d'accroître le nombre de zombies.
Echo date de 2007. C'est le deuxième film de son réalisateur. Très bien filmé et bénéficiant d'un scénario astucieux, Echo est une découverte très agréable.
La grande force du film est de ne pas hésiter à jouer avec différents genres. Au départ, le film évolue dans le cadre du drame voire du thriller avec cet enfant qui a été enlevé par son père policier, lequel a décidé de trouver refuge dans une maison isolée. Puis, et de manière relativement constante, le spectateur a l'impression qu'il se trouve dans un film de fantôme, à la manière de l'excellent Dark water d'Hideo Nakata. En effet, à plusieurs reprises, on sent dans la maison la présence d'une sorte de fantôme avec d'ailleurs ce filmage en caméra subjective. On a l'impression que les deux protagonistes principaux du film, ce père de famille et son fils, sont épiés par ce fantôme. A cette occasion, le film a d'ailleurs une capacité certaine à susciter la peur avec cette mise en scène qui joue sur les différents couloirs de la maison. Et puis la photographie froide du film, alliée aux décors quasi déserts de la maison, accroît ce sentiment de peur. Le moindre bruit peut être interprété comme l'arrivée du fantôme.
Progressivement, le spectateur comprend que la piste sur laquelle le cinéaste l'a invité à aller est finalement un leurre. Le film bascule dans la catégorie drame avec une explication très rationnelle des événements qui ont eu lieu. Le passé refait surface et on saisit alors les raisons qui amené le père de famille à aller en ces lieux et les raisons des différentes visions.
Réellement inquiétant, le film joue aussi la carte de la pédophilie sous-jacente avec des détails qui interloquent le spectateur, alors que celui-ci ne comprenne qu'il s'agit là encore d'une fausse piste.
Parfaitement joué, le film Echo vaut vraiment le coup. La réussite de cette oeuvre est totale et la fin donne un côté apaisé à ce film. A voir.
5°) Valérie ou la semaine des merveilles de Jaromil Jirès

Le visionnage du film Valérie ou la semaine des merveilles a été précédé par les bandes annonces des films Alice et Lust in the dust.
La direction de l'Etrange festival a eu la bonne idée (que l'on retrouve lors de chacune des séances) d'inclure un court métrage. Dans le cas présent, il s'agit du court métrage The cat with the hands. Ce court, basé sur un élément fantastique, se regarde très bien. Non dénué d'humour, il nous montre un chat qui a pris l'apparence de plusieurs personnes. On comprend à la fin que ce chat maléfique est tout bonnement le narrateur.
Valérie ou la semaine des merveilles est un film tchécoslovaque datant de 1971. Le film n'est visible que depuis 2-3 ans en DVD, et uniquement à l'étranger. Il n'a jamais été présenté en France. La copie a permis de voir le film a été empruntée à la Cinémathèque de République Tchèque. Le film comprend 3 passages noirs car on nous a signalé qu'il y a 3 bobines. Il s'agit d'un film de collection dont on ne peut pas couper les amorces. Aujourd'hui, on ne dispose plus de doubles postes comme l'époque. Il a donc fallu faire avec des pauses d'environ 20 secondes entre chaque bobine.
Comme pour l'exceptionnel Morse de Thomas Alfredsson, le réalisateur Jaromil Jirès n'est pas porté à la base par le fantastique. C'est certainement la raison pour laquelle il a apporté un ton original au film Valérie ou la semaine des merveilles. Ce film est tout bonnement une variation sur le célèbre Alice au pays des merveilles.
Le film bénéficie de trois éléments fondamentaux. D'abord, il y a la présence de la jeune Jaroslava Schallerova (alors âgée de seulement 14 ans) qui interprète le rôle de Valérie. Cette jeune actrice illumine de toutes parts l'écran par sa présence. L'actrice, avec son visage d'adolescente, et avec sa petite voix douce, donne réellement le sentiment de représenter l'être pur par excellence. C'est d'ailleurs sa pureté qui va être mise à mal par un démon, Constable qui lui en veut de manière constante. Il y a aussi dans cette histoire un prêtre libidineux ou encore une jeune fille qui va inviter Valérie à s'adonner au lesbianisme.
La deuxième qualité du film est la mise en scène du film. Sur le plan technique, le film est très bien réalisé et contribue sans nul doute à la réussite du film. Ainsi, la mise en scène est marquée par de nombreux plans en plongée où on retrouve par exemple l'héroïne endormie dans une pièce entièrement blanche. Le filmage adapté donne un côté quasi féérique ou inquiétant selon les cas de figure, à l'ensemble.
La troisième qualité du film, et non des moindres, est la photographie du film. Cette dernière est superbe et participe au côté fantastique du film. Dès le début du film, cette impression est présente. Ainsi, on voit des filles qui se baignent dans un ruisseau et Alice qui les regarde. On dirait que l'on a affaire à des nymphes. L'esthétique est vraiment superbe.
Si les qualités du film sont évidentes, malheureusement celui-ci souffre à mes yeux de quelques défauts. Il y a d'abord un aspect kitsch que l'on retrouve par exemple par la représentation assez ridicule du monstre principal, à savoir Constable, qui donne le sentiment d'être une sorte de vampire de pacotille. Il y a aussi l'arrivée du prêtre libidineux qui est assez ridicule.
Ce problème reste tout de même mineur. Le principal défaut est sans nul doute la différence entre le rêve et la réalité qui est parfois bien difficile à faire. On ne sait pas toujours si on se trouve en plein rêve (ou cauchemar) ou non. Le film manque d'une certaine clarté sur ce point. Ce qui est dommage car le film est réussi sur de nombreux plans.
Et puis il faut dire que voir ce film à 22 heures un dimanche, après avoir déjà regardé quatre autres films dans le week-end, n'aide pas forcément à la compréhension.
Dans tous les cas, ce week-end lyonnais s'est révélé très intéressant et a permis de découvrir des films rares pour certains, qui avaient surtout le mérite de sortir des sentiers battus.
26.01.09
Daredevil / Le Caïd
 Le Caïd, Wilson Fisk, est un personnage particulier. A l’origine, simple parrain de la pègre parmi d’autres, il apparaît dans les premières aventures de Spider-Man contre qui il fait preuve d’une force peu commune puis est repris par Frank Miller qui va donner une nouvelle jeunesse au personnage en le faisant devenir l’ennemi numéro 1, la parfaite nemesis de Daredevil. De fil en aiguille, il va passer d’un criminel caricatural à un génie du crime tirant en ficelle les secrets mais étant aussi implacable avec Murdock lorsqu’il découvrira son identité.
Le Caïd, Wilson Fisk, est un personnage particulier. A l’origine, simple parrain de la pègre parmi d’autres, il apparaît dans les premières aventures de Spider-Man contre qui il fait preuve d’une force peu commune puis est repris par Frank Miller qui va donner une nouvelle jeunesse au personnage en le faisant devenir l’ennemi numéro 1, la parfaite nemesis de Daredevil. De fil en aiguille, il va passer d’un criminel caricatural à un génie du crime tirant en ficelle les secrets mais étant aussi implacable avec Murdock lorsqu’il découvrira son identité.
D’ailleurs, on notera avec cynisme que Tête à cornes doit être le martyre désigné de Stan Lee tant celui-ci a été victimes de coups du sorts entre le Tireur et le Caïd.
Personnage à la carrure hors norme, dirigeant un empire du crime, on peut reconnaître que le film lui rend hommage en cela qu’il respecte le matériel de base dans ses grandes lignes, malgré le recours à des poncifs qui parviennent à ne pas être ridicules. La grande force de Daredevil reste justement d’avoir su se réapproprier les personnages de départ pour les faire entrer dans un univers qui lui est propre. On peut certes sourire devant le jeu d’Affleck dans la peau de l’avocat aveugle voir devant celui de Farrel qui dénature parfois le caractère à l’origine assez sombre (bien que fantasque) du Tireur. Néanmoins, avoir choisi M. Clarke Duncan pour interpréter le Caïd relève d’une sacrée justesse de casting. Inconcevable lors de sa création, le fait d’avoir un acteur black correspond tout à fait à la volonté d’égalité prônée par nos sociétés d’aujourd’hui. Ainsi, les blancs ne sont pas les seuls bad guys à pouvoir corrompre le pouvoir. De plus la stature de l’acteur colle tout à fait et ne trouve pas d’équivalent chez les acteurs blancs. Pour mémoire, c’est John Rhyes Davies (Arthuro dans Sliders) qui avait prêté son visage à Fisk dans un téléfilm de l’ancienne série Hulk pour la télévision. Mais pour ce qui est de la grande scène de rencontre entre Le Caïd et Daredevil , il faudra se tourner vers la version director’s cut pour ressortir satisfait. Et il sera évident pour ceux qui ne l’ont encore pas vu que Clarke Duncan était parfait : cruel, brutal, excellent dans le combat au corps à corps qui n’a rien à voir avec la version courte … sans compter les multiples relations avec le Tireur entre autre. On pourra s’amuser de voir la relation entre la rose qu’il laisse sur ses victimes et le fait que son fils dans le comics se fasse connaître sous cette identité , mais dans l’ensemble, la prestation reste relativement bonne et se classe même plusieurs crans au dessus de personnage comme Fatalis et son homologue grand écran.
Spider-Man / Sand Man
Dans la galerie habituelle des vilains de Spider-Man, l’Homme sable sort légèrement du lot. Habituellement, l’Araignée doit faire face au Vautour, au Rhino et autres Dr Octopus qui reelèvent tous d’emblèmes totémiques. L’homme sable ne renvoie à aucun animal puisqu’il est le fruit d’un accident résultant d’une expérience, un peu à la manière de Hulk ou d'Abomination. D’ailleurs, l’aspect gamma en moins, il aurait tout à fait eu sa place dans l’entourage du Béhémot vert. De plus, dans la bande dessinée, ce personnage n’est ni tout à fait un bad guy , malgré sa période Terrifics, ni tout à fait un héros , dixit la période Vengeurs. L’homme sable relève somme toute de l’anti héros classique. Jamais là au bon moment, cherchant à se faire connaître avant de comprendre lui même , ses pouvoirs font souvent de lui un enjeu non négligeable dont il se passerait bien. Dans le film, on se base sur ses origines papiers avec une fidélité certaine et on a même droit à une séquence de mutation assez impressionnante. De Spider-Man 3 , il est d’ailleurs la plus grande réussite visuelle et narrative, parvenant à en remontrer au tisseur tout en envahissant littérallement l’écran et étant un pis aller parfait pour boucler des arcs scénaristiques majeurs comme la mort d’Oncle Ben qui va enfin être élucidée dans sa totalité et permettre à Peter d’avancer en réussissant à être un peu plus en paix avec lui-même.

Il reste quand même intéressant de relever que de tous les vilains des films de Sam Raimi, Flint Marko est le seul à ne pas avoir cherché ses capacités. Le bouffon vert et Octopus étaient tous deux des esprits scientifiques majeurs, Harry Osborn ne reprend que la quête de son père à laquelle on peut ajouter une certaine violence tandis que Venom de par sa nature cherche à détruire puis s’unit à quelqu’un qui cherche un moyen de contrer Spider-Man suite à des histoires de vengeance personnelle. Flint Marko n’a rien voulu de tout cela, il n’a simplement pas eu de chance et au-delà des bijoux ou du pouvoir, il recherche simplement le pardon pour avoir une chance de se reconstruire, quête parallèle à celle de Parker qui poursuit le même but. Spider-Man 3, au-delà de sa narration un peu brouillon reste avant tout une course à la rédemption et au pardon, phase par laquelle passeront tous les personnages majeurs mis en place depuis le premier opus, héros comme humains étant concernés. Marko n’est que le parangon de cette recherche qu’il finit par conclure, se laissant finalement aller aux quatre vents dans un dernier plan onirique assez fort graphiquement. Peut être pas l’un des méchants les plus attendus, mais l’un des plus réussis.
Spider-Man / Dr Octopus
Dans le comics original, le Dr Otto Octavius est un brillant scientifique qui avait mis au point pour pouvoir gagner du temps et exécuter plusieurs tâches en même temps sans pour autant s’exposer aux radiations de nombreux produits dangereux. Las, un accident se produisit et son harnais fut soudé à son coprs et à son système nerveux. Parla suite, il appris à se défaire de ce dernier tout en étant capable de la contrôler à distance. Grand ennemi de Spider-Man devant l’éternel, les anciens lecteurs de Strange auront eu le plaisir d’assister à de nombreux affrontements entre ces deux personnages arachnides, Octopus étant un adversaire plus que redoutable ayant même réussi à se faire aimer ou du moins apprécier de Tante May. Il est aussi à l’origine de la fondation des Sinistres Six , dont les enjeux dans la période post McFarlane n’était ni plus ni moins que de diffuser un produit dans l’atmosphère rendant les gens normaux dépendant à la drogue , problème pour lequel il était le seul à proposer un hypothétique remède.
De plus, il restait un personnage finalement assez complexe puisque oscillant souvent entre la justice et le crime et courant fréquemment après une reconnaissance qui lui était refusée de par ses doubles activités. On se souviendra de sa volonté de s’amender , soutenu par le Dr Richards qui connaissait alors de sérieuses inquiétudes quant à la naissance de son second enfant. En apportant son aide à l’accouchement, Octopus ne parvint pourtant pas à sauver le nourrisson et cru que Richards s’était joué de lui. Il bascula alors définitivement. Tué par le clone de l’Araignée, il fut ensuite ressuscité par la Main.
 L’adaptation et la réactualisation de ce personnage et en soi une des grandes réussites de la saga cinéma de Spider-Man. L’acteur titre tout d’abord, Molina (qui jouait les cher à patouille pour pièges de civilisations disparues dans le premier Indiana Jones) possède le physique adéquat et s’est approprié le rôle avec conviction, excellant tout autant dans le côté prof de fac un tantinet paternaliste que dans celui de criminel d’envergure et sans pitié. Mieux encore, les tentacules sont maintenant traitées comme des entités à part entière, pensant par elle-même et n’étant pas seulement des accessoires. Lors de l’accident qui les ont fusionnées avec Octopus, ce sont elles qui vont le pousser à devenir un criminel. C’est d’ailleurs lorsqu’elles vont se retrouver court circuitées que Otto va retrouver son humanité.
L’adaptation et la réactualisation de ce personnage et en soi une des grandes réussites de la saga cinéma de Spider-Man. L’acteur titre tout d’abord, Molina (qui jouait les cher à patouille pour pièges de civilisations disparues dans le premier Indiana Jones) possède le physique adéquat et s’est approprié le rôle avec conviction, excellant tout autant dans le côté prof de fac un tantinet paternaliste que dans celui de criminel d’envergure et sans pitié. Mieux encore, les tentacules sont maintenant traitées comme des entités à part entière, pensant par elle-même et n’étant pas seulement des accessoires. Lors de l’accident qui les ont fusionnées avec Octopus, ce sont elles qui vont le pousser à devenir un criminel. C’est d’ailleurs lorsqu’elles vont se retrouver court circuitées que Otto va retrouver son humanité.
Mieux encore, leurs potentiel visuel est uitlisé à son maximum, aussi bien lors de leurs premières utilisation « pacifique » que lors de leur réveil à la Evil Dead ou bien encore durant de multiples scènes de combats avec tête de toile qui se trouve du coup magnifié par l’utilisation judicieuse de son fluide. Quand on y réfléchit, deux scènes majeures restent à l’esprit quand les lumières se rallument dans la salle : le braquage de la banque et le match digne d’un des meilleurs capcom sur le toit du Train.
Et quand c’est un bad guy qui monopolise et remporte l’adhésion, c’est que le pari de départ est réussi , dixit Batman Returns.
X-Men / Mystique
Les personnages bénéficiant d’un pouvoir auto guérisseur sont assez peu nombreux en regard de ceux qui possèdent une force surhumaine dans la bande dessinée. Et pourtant, ce sont ceux qui ont été le lus portés à l’écran. Serval , Dents de Sabre ou bien encore Mystique possèdent cette faculté. Le personnage de Mystique est l’un des plus complexes de l’Univers X Men, en cela qu’elle a déjà pu vivre plusieurs vies, sans compter qu’elle est une espionne et une terroriste reconnue, nonobstant le fait qu’elle soit la mère de Diablo et qu’elle aie eu un enfant avec Creed. Sa version animée en faisait un égal négatif de Xavier. Sa version live était sans conteste l’une des plus grandes réussites visuelles du premier épisode des X Men Version , Singer, qui en fit un véritable pilier dans le second volet. De simple faire valoir de Magnéto, elle est devenue quelque chose de beaucoup plus travaillé, n’hésitant pas à entretenir une relation assez trouble avec ce dernier. L’un des regrets que l’on pourra émettre à son égard reste son abandon pur et simple dans l’Affrontement final, bien que permettant de révéler l’aspect profond de Magnéto (les mutants d’abord et voilà tout) qui reste prêt à tout pour porter sur le devant de la scène (ou du moins sauver) ceux de sa race mais qui les abandonnent dès qu’ils ne correspondent plus à ses critères.

Ses transformations sont assez réussies et s’embellissent au fur et à mesure des ses apparitions à l’écran, non sans un certain humour quand elle prend l’apparence de kelly. Elle est dévouée corps et âme à Magnéto mais finira par le trahir après avoir elle-même été bafouée.
Cependant, il est dommage de ne pas avoir creusé un peu plus sa parenté avec le perso de Diablo qui avait dynamité l’introduction du deuxième film. Plus que vénéneuse, remarquablement douée en arts martiaux et en informatique , elle représente l’un des individus les mieux retranscrits et réadaptés de toute la saga mutante. On retiendra surtout d’elle la scène de séduction du garde et celle du piratage informatique dans X men II , sa confrontation avec Wolwerine dans X Men 1 et sa guérison (si l’on peut dire) dans X Men III.
Personnage à la carrure hors norme, dirigeant un empire du crime, on peut reconnaître que le film lui rend hommage en cela qu’il respecte le matériel de base dans ses grandes lignes, malgré le recours à des poncifs qui parviennent à ne pas être ridicules. La grande force de Daredevil reste justement d’avoir su se réapproprier les personnages de départ pour les faire entrer dans un univers qui lui est propre. On peut certes sourire devant le jeu d’Affleck dans la peau de l’avocat aveugle voir devant celui de Farrel qui dénature parfois le caractère à l’origine assez sombre (bien que fantasque) du Tireur. Néanmoins, avoir choisi M. Clarke Duncan pour interpréter le Caïd relève d’une sacrée justesse de casting. Inconcevable lors de sa création, le fait d’avoir un acteur black correspond tout à fait à la volonté d’égalité prônée par nos sociétés d’aujourd’hui. Ainsi, les blancs ne sont pas les seuls bad guys à pouvoir corrompre le pouvoir. De plus la stature de l’acteur colle tout à fait et ne trouve pas d’équivalent chez les acteurs blancs. Pour mémoire, c’est John Rhyes Davies (Arthuro dans Sliders) qui avait prêté son visage à Fisk dans un téléfilm de l’ancienne série Hulk pour la télévision. Mais pour ce qui est de la grande scène de rencontre entre Le Caïd et Daredevil , il faudra se tourner vers la version director’s cut pour ressortir satisfait. Et il sera évident pour ceux qui ne l’ont encore pas vu que Clarke Duncan était parfait : cruel, brutal, excellent dans le combat au corps à corps qui n’a rien à voir avec la version courte … sans compter les multiples relations avec le Tireur entre autre. On pourra s’amuser de voir la relation entre la rose qu’il laisse sur ses victimes et le fait que son fils dans le comics se fasse connaître sous cette identité , mais dans l’ensemble, la prestation reste relativement bonne et se classe même plusieurs crans au dessus de personnage comme Fatalis et son homologue grand écran.
Spider-Man / Venom
Le symbiote. Apparu dans les mythiques Guerres Secrètes de feu Spidey, magnifié par Todd « Spawn » McFarlane, il est vraiment la personnification de ce que doit être un ennemi intime, voire mortel pour un super héros. En créant ce personnage, les créatifs de l’époque ont été bine plus loin qu’un Luthor ou qu’un Bizarro en cela que Venom a d’abord été un allié et un atout pour Spider-Man avant de devenir ivre de rage pour avoir été rejeté et de tomber dans les mains d’un opposant naturel de Spidey qui découvrira du même coup la fameuse identité secrète de tête de toile. Comble de malice, Brock va se retrouver, en plus de toutes les connaissances d’ordre privées du symbiote, avec les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Comment créer plus bel opposant ?
 En le rendant psychotique et en le faisant évoluer selon son propre code d’hhonneur, Venom se retrouvant alors selon les circonstances Bad ou good guy. Si on ajoute à cela tous les aléas psychologiques de Brock qui ne se laissera pas toujours guider aveuglément par le symbiote, on obtient un personnage parfait de la classe d’un Fatalis. De plus, Venom étant avant tout deux individus, on crée un background d’un richesse inouïe pour le symbiote en propre, celui-ci venant d’une espèce qui s’infiltre sournoisement sur une planète afin d’en éradiquer les habitants par la violence pour ensuite s’emparer de leurs mondes. Le symbiote s’opposera à cette manière de voir les choses et sera pour cela exilé vers la planète du Beyonder pour y être exécuté … avec la suite que vous connaissez. Et quand enfin on pense avoir fait le tour du personnage, on lui adjoint une descendance assez folle pour le faire passer pour un enfant de cœur avec Carnage , lui offrant du même coup suffisamment d’élements pour qu’il puisse espérer un jour voir sa propre destinée portée au cinéma.
En le rendant psychotique et en le faisant évoluer selon son propre code d’hhonneur, Venom se retrouvant alors selon les circonstances Bad ou good guy. Si on ajoute à cela tous les aléas psychologiques de Brock qui ne se laissera pas toujours guider aveuglément par le symbiote, on obtient un personnage parfait de la classe d’un Fatalis. De plus, Venom étant avant tout deux individus, on crée un background d’un richesse inouïe pour le symbiote en propre, celui-ci venant d’une espèce qui s’infiltre sournoisement sur une planète afin d’en éradiquer les habitants par la violence pour ensuite s’emparer de leurs mondes. Le symbiote s’opposera à cette manière de voir les choses et sera pour cela exilé vers la planète du Beyonder pour y être exécuté … avec la suite que vous connaissez. Et quand enfin on pense avoir fait le tour du personnage, on lui adjoint une descendance assez folle pour le faire passer pour un enfant de cœur avec Carnage , lui offrant du même coup suffisamment d’élements pour qu’il puisse espérer un jour voir sa propre destinée portée au cinéma.
Si l’histoire de Venom parvient à s’attirer l’attachement des lecteurs sans grande peine, il n’en est pas de même pour sa venue sur grand écran. Dans le film de Sam Raimi, ses origines sont gommées pour des raisons de scénario et de droits évidentes, qui ne pourront conduire qu’à une nouvelle version type Hulk si le projet de séquelle voit véritablement le jour, mais le fait de faire venir le symbiote via une météorite peut passer pour acceptable. Le fait que Parker sombre du côté obscur de la force avec l’utilisation progressive de son costume est lui aussi plutôt bien porté sur grand écran, sans compter le principe essentiel qui respecte la nature consciente du symbiote. Raimi a su garder à l’esprit qu’il s’agissait d’un esprit et d’un être à part entière. L’énorme autre point positif réside aussi dans son apparence, tout à fait en adéquation avec un parasite mais aussi avec les pouvoirs de son hôte originel. Suintant, envahissant, on se rend bien compte que ce symbiote n’est pas une bonne chose mais cette épanouissement visuel destiné au fan ne peut alors que faire espérer le meilleur quand le passage de Parker à Broke va se produire. Las, le Eddie du film n’a rien à voir physiquement avec celui de la bande dessinée, contrairement à l’épatante transposition de l’homme sable, et c’est un gringalet qui récupère le rôle. Premier constat, il n’est pas du tout imposant avec le costume noir. Second constat, quand venom apparaît vraiment avec les crocs et le reste de l’attirail, on se surprend à rire jaune tant l’impact des couvertures de McFarlane se retrouve ici réduit à zéro. Evidemment, la scène culte des cloches est reprise, mais en voulant traiter à la fois deux nouveaux vilains plus clôturer les anciens arcs scénaristiques des opus précédents avec le bouffon vert tout en essayant de traiter par-dessus l’ensemble le désastre de la vie privée de Peter, Raimi se perd et bâcle les affrontements les plus attendus et qui devaient être dantesque. Jamais Spider-Man 3 ne parvient à retrouver le souffle quasi épique et la virtuosité de l’épisode 2 avec par exemple la scène du Train et du combat contre Octopus. Le geek révaît de Venom contre Spidey en live et c’est un geek suprême et assumé qui finalement loupe le coche et propose seulement un brillant catalogue des possibilités actuelles dans le domaine des effets spéciaux. Dommage.
X Men / Le Fléau
De tous les personnages Marvel, certains sont purement et simplement inadaptables. Ou du moins le pense t on. Quelques uns ont malgré tout réussi leur passage du papier au format ciné (Octopus, Iron Man) alors que d’autres se sont lamentablement ramassés (Galactus et dans une moindre mesure Venom). Le Fléau était il vraiment nécessaire et indispensable dans l’Affrontement final là où un Blob, voir même un Avalanche aurait pu faire l’affaire, s’il s’agissait seulement de tout détruire sur son passage. De plus, le Juggernaut est un individu au passé extrêmement lourd et proche de celui de Xavier (je ne diras pas tout, au cas où des fans de films de super héros désireraient se plonger dans les comics papiers) , sans compter une partie mystique à la base de sa force phénoménale grâce au rubis de Cyttorak. Enfin, malgré sa masse imposante qui pourrait en remettre à Hulk (côté stature et même côté force dans ses bons jours) , Caïn Marko reste rusé et intelligent et connaissant parfaitement ses limites.
 L’idée de le porter en live était intéressante en soi, mais au vu du résultat, on reste dubitatif. La plus grosse erreur est, outre l’éradication pure et simple de ses origines, d’en avoir fait un mutant, ce qu’il n’a jamais été. De plus, la célèbre armure rouge a sauté au bénéfice d’un ensemble ridicule. Enfin, Vinnie Jones, s’il était amusant chez Guy Ritchie est ici pitoyable tant son jeu est limité et à mille lieues ne serait ce que des adaptations animées. A part beugler « I’m unstoppable » à l’instar d’un Nuclear man qui en son temps s’arracher le dentier à brailler « Kill Superman » et foncer dans des murs sans réfléchir, il n’y a rien à en tirer.
L’idée de le porter en live était intéressante en soi, mais au vu du résultat, on reste dubitatif. La plus grosse erreur est, outre l’éradication pure et simple de ses origines, d’en avoir fait un mutant, ce qu’il n’a jamais été. De plus, la célèbre armure rouge a sauté au bénéfice d’un ensemble ridicule. Enfin, Vinnie Jones, s’il était amusant chez Guy Ritchie est ici pitoyable tant son jeu est limité et à mille lieues ne serait ce que des adaptations animées. A part beugler « I’m unstoppable » à l’instar d’un Nuclear man qui en son temps s’arracher le dentier à brailler « Kill Superman » et foncer dans des murs sans réfléchir, il n’y a rien à en tirer.
Ensuite, un simple camion prison n’aurait jamais du / pu le retenir , quelque soit ses entraves. A force de multiplier et de dénaturer les mauvais mutants dans son opus, Rattner a réussi l’impossible, à savoir les rendre futiles. Le Fléau a lui seul mériterait d’avoir un film ou du moins d’être un bad guy unique , et non pas massacré comme c’est le cas ici. On peut lui adjoindre le personnage d’Angel ou des Sentinelles à ce titre qui ont eu aussi été massacrés sur l’autel de la pluralité. Le scénario d’X Men III est si faible en fait qu’il a fallu recourir à la multiplication des pouvoirs et des bad guys pour réussir à tenir la distance… pour ensuite s’en débarrasser facilement.
Le plus triste dans tout cela, c’est qu’on ne reverra sûrement jamais plus le Fléau au cinéma, tant l’image que celui-ci a laissé ici sera négative pour les années à venir. Le plus gros gâchis de la franchise après Dents de Sabre.
X-Men / Pyro
Pyro est un personnage plutôt inattendu dans la trilogie X Men. Assez Anecdotique dans le comics, si ce n’est lorsqu’il sacrifia sa vie pour sauver celle du sénateur Kelly, il prend une véritable ampleur dans le second volet de Singer avant de redevenir caricatural dans celui de Rattner. Dans la bande dessinée, il ne possède qu’un pouvoir en propre , celui de contrôler n’importe quelle flamme dans un rayon d’une trentaine de mètres, pouvant aussi lui donner la forme qu’il désire sans compter une certaine consistance. Pour être sur de ne jamais manque de flammes, il s’est harnaché d’un dispositif lui permettant d’avoir accès à des types bien particuliers de briquets, ne pouvant pas lui-même produire naturellement cet élément. Dans le film, c’est un adolescent intégré à l’école de Xavier qui semble pouvoir , au contraire, générer lui-même des gerbes de feu, à l’image de ses exploits dans le second opus chez les parents de Bobby Drake.
De Bobby Drake justement, parlons en. Il était somme toute logique dans ces films manichéens d’avoir un opposant naturel à Iceberg. Wolwerine avait Dents de Sabre, Magnéto avait Xavier …. Et logiquement le feu pouvait être un opposant sympathique à la glace. Le fait qu’il s’agissent de jeunes adultes ne pouvait que conduire à un clash.
 Pyro est un des personnages dont la réappropriation est des plus réussies. On en termine avec le personnage un peu simple des bandes dessinées pour obtenir la matérialisation des doutes sur l’adolescence et le changement. Sans cesse en proie à un questionnement intérieur sur sa condition, il va se retrouver pris entre deux feux entre un Xavier qui ne veut que son bien au prix d’un certain contrôle et un Magnéto qui bien que le manipulant lui permettra de s’exprimer pleinement, jusqu’à en devenir un lieutenant fidèle et dévoué (ce qui reste drôle puisque servant du même coup Mystique, comme un écho au monde papier et à la confrérie des mauvais mutants…. La boucle est alors bouclée).
Pyro est un des personnages dont la réappropriation est des plus réussies. On en termine avec le personnage un peu simple des bandes dessinées pour obtenir la matérialisation des doutes sur l’adolescence et le changement. Sans cesse en proie à un questionnement intérieur sur sa condition, il va se retrouver pris entre deux feux entre un Xavier qui ne veut que son bien au prix d’un certain contrôle et un Magnéto qui bien que le manipulant lui permettra de s’exprimer pleinement, jusqu’à en devenir un lieutenant fidèle et dévoué (ce qui reste drôle puisque servant du même coup Mystique, comme un écho au monde papier et à la confrérie des mauvais mutants…. La boucle est alors bouclée).
Il permet également d’être un miroir pour l’ensemble de la jeune écurie Xavier, Xmen comme Nouveaux Mutants et de leur donner à voir ce qu’ils pourraient devenir en optant pour la mauvaise solution.
Il reste regrettable que cette évolution psychologique soit réduite à peau de chagrin dans le dernier volet malgré une ultime utilité dans un combat de jeunes coqs assez téléphoné, celle de pouvoir retrancher Drake dans ses premiers retranchements d’adulte en puisant dans son pouvoir de manière telle qui finit par revêtir son allure définitive d’homme de glace, assez réussie visuellement d’ailleurs.
Pyro reste donc un bon atout malgré l’aspect moralisateur à peine sous jacent du « je n’ai pas misé sur le bon cheval donc je perds mes pouvoirs et redeviens quelqu’un de banal, encore plus insignifiant que lors de ma première apparition.» Dommage.
Spider-Man / le Bouffon Vert
Le Bouffon Vert est l’un des pires vilains de l’entourage de Spider-Man. C’est tout simplement le symbole du passage à l’âge adulte de Peter, qui avait déjà commencé avec la mort de l’oncle Ben. Le Bouffon n’est autre que le responsable de la mort de Gwen Stacy , qu’il jettera du haut d’un pont, à l’instar du final de Spider-Man 1 avec Mary Jane Watson. Dans le comics, il est aussi un des vilains qui sera le plus reproduit, avec pas moins de quatre déclinaisons (les deux osborn, Hamilton et Ulrich) sans compter une version Super Bouffon qui occupera longuement notre Spidey plongé au cœur d’une guerre civile au sein du crime organisé et même un Bouffon Noir qui relèverait plutôt de la juridiction de Ghost Rider ou du Dr Strange. Le Bouffon Vert est un peu le pendant du Joker de Batman pour ce qui est de la folie voire peut être même un anti Tony Stark. Riche industriel, il est avide de pouvoir et finit par créer un sérum lui promulguant accidentellement force et intelligence jusqu’à le rendre fou. Il se dote alors d’un équipement high tech et commence à mener la vie dure à tête de toile , sous le joug de cette double personnalité qui s’adresse à lui via les miroirs (excellente idée reprise avec succès dans le film) dans l’espoir d’obtenir la reconnaissance mais aussi le respect du monde de la pègre.
Je ne révèlerais pas les pourquoi des différents bouffons, si ce n’est que le fils reprendra le flambeau, sous la domination psychologique de la figure paternelle.
 Vu qu’il s’agit de l’unique Bad Guy du premier opus, Sam Raimi lui a apporté un soin tout particulier à l’écran en le transposant de manière assez moderne, conservant le rapport financier et technologique en y incluant les militaires et les relations commerciales avec ces derniers. Evidemment, on peu ressentir quelque doute sur l’apparence du Bouffon Vert, sorte de nain de jardin diabolique customisé façon 2000 et perdant ainsi l’aura de mystère voulue par le costume originel. De fait, on conserve les bombes citrouilles et le sac à malice , en les modernisant eux aussi , nonobstant le planeur qui dégage une fumée pestilentielle, annonçant parfaitement la couleur des affrontements qui vont suivre. Et plus encore que tous ces attributs de science fiction, la réussite de ce personnage va résider dans l’interprétation hallucinée de Willem Dafoe , excellent en père tyrannique mais magistral lorsqu’il s’agit de laisser parler son côté obscur à l’instar de sa transformation dans le labo quat il tue le scientifique ou bien encore lorsqu’il comprend que Spider-Man et Parker sont une seule et même personne.
Vu qu’il s’agit de l’unique Bad Guy du premier opus, Sam Raimi lui a apporté un soin tout particulier à l’écran en le transposant de manière assez moderne, conservant le rapport financier et technologique en y incluant les militaires et les relations commerciales avec ces derniers. Evidemment, on peu ressentir quelque doute sur l’apparence du Bouffon Vert, sorte de nain de jardin diabolique customisé façon 2000 et perdant ainsi l’aura de mystère voulue par le costume originel. De fait, on conserve les bombes citrouilles et le sac à malice , en les modernisant eux aussi , nonobstant le planeur qui dégage une fumée pestilentielle, annonçant parfaitement la couleur des affrontements qui vont suivre. Et plus encore que tous ces attributs de science fiction, la réussite de ce personnage va résider dans l’interprétation hallucinée de Willem Dafoe , excellent en père tyrannique mais magistral lorsqu’il s’agit de laisser parler son côté obscur à l’instar de sa transformation dans le labo quat il tue le scientifique ou bien encore lorsqu’il comprend que Spider-Man et Parker sont une seule et même personne.
Le combat de titan final est d’autant plus appréciable qu’ils sont de même niveau avec un point commun résidant dans la personne de Harry, fils de l’un, meilleur ami de l’autre qui ne doit pas se douter vaille que vaille des tensions existant entre eux. La mort attendue du Bouffon, quasi conforme à celle de la bande dessinée, empalé par son propre planeur est réussie (bien que le dernier râle le soit beaucoup moins….) et on le retrouve avec surprise et plaisir en manipulateur de conscience dans l’opus suivant, conduisant son fils sur la même voie que lui.
Le troisième opus conclura avec brio la trilogie Spider-Man qui n’est en fait que l’exploration des rapports liant deux amis autour d’une même femme et de pouvoirs qui les dépassent mais les magnifie également, Harry mourrant pour sauver Peter.
On assiste donc à l’émergence d’un vilain qui aurait pu être grotesque et qui finalement se révèlera le plus humain de toute cette saga.
Ainsi s’achève ce micro dossier qui s’était donné pour but de brosser le portrait de quelques bad guys de l’univers ciné de Marvel. J’ai volontairement laissé de côté les personnages majeurs tels que Magnéto ou Jean Grey car je voulais éviter d’être trop réducteur à leur égard et préféré m’attarder sur les exemples non exhaustifs que vous venez de lire. N’hésitez pas à apporter votre propre vision des choses dans la partie du dessous, la vôtre, et bon visionnage à l’avance pour la sortie DVD/Blu-ray prochaine de Hulk version Leterrier. Au plaisir de vous revoir bientôt…
21.01.09
Salut à tous ! Pour se reposer de nos pérégrinations trekkiennes et pour marquer le coup de la sortie d’Iron Man en dvd et se préparer à celle de Hulk, je vous propose un nouveau dossier basé sur les adaptations des super vilains de l’Univers Marvel sur grand écran. Ce dossier sera multiple et tentera de toucher à l’ensemble des vilains. Tous ne seront évidemment pas traités mais j’essaierai d’être exhaustif en prenant des fers de lance mais aussi des seconds couteaux. Et n’oubliez pas, réagissez !
X Men / Dents de Sabre
Père potentiel et un temps envisagé de Wolwerine, mutant centenaire au passé extrêmement trouble lié au projet Arme X, Creed est l’un des plus farouches ennemis de Serval , si ce n’est sa Nemesis. Pouvoir auto guérisseur, griffes, taille impressionnante et force phénoménale sans compter des affrontements au pire jouissifs au mieux cataclysmique avec les X Men. Bien exploité par Capcom dans ses célèbres versus, véritable bête sauvage, il est le reflet de ce que serait devenu Logan s’il avait laissé libre cours à ses instincts. Graphiquement imposant, doté d’une vivacité d’esprit redoutable ayant même failli conduire Psyloque de l’autre côté du miroir, il est l’un des personnages les plus instables de toute l’écurie Marvel , ne cherchant qu’à assouvir sa soif de sang que ce soit pour l’un ou l’autre des camps, ou bien encore en jouant les mercenaires.
 L’annonce d’un tel personnage dans le premier film sur la célèbre troupe de mutants ne pouvait que satisfaire des millions de fans, Serval étant lui aussi de la partie, forcément. Bryan Singer étant derrière la caméra, le traitement aurait du être explosif , d’autant plus que le physique de l’acteur retenu correspondait parfaitement à son pendant dessiné et que le costume attribué respectait les mêmes origines contrairement au costume cuir de Serval qui remplaçait avantageusement (?) celui de Spandex, ou du moins en atténuait l’aspect Live qui aurait été limite ridicule (bien que l’on appréciera toujours l’allusion savoureuse de Hugh Jackman à ce sujet).
L’annonce d’un tel personnage dans le premier film sur la célèbre troupe de mutants ne pouvait que satisfaire des millions de fans, Serval étant lui aussi de la partie, forcément. Bryan Singer étant derrière la caméra, le traitement aurait du être explosif , d’autant plus que le physique de l’acteur retenu correspondait parfaitement à son pendant dessiné et que le costume attribué respectait les mêmes origines contrairement au costume cuir de Serval qui remplaçait avantageusement (?) celui de Spandex, ou du moins en atténuait l’aspect Live qui aurait été limite ridicule (bien que l’on appréciera toujours l’allusion savoureuse de Hugh Jackman à ce sujet).
Les premières images ne pouvaient que nous conforter dans notre petit bonheur de geek, celles donnant lieu à un combat remarquablement bien mis en scène vue les conditions naturelles portées à l’écran. Dents de sabre apparaît sauvage, le travail sur les yeux n’étant pas nécessaire mais restait sympa et les coups portés sont relativement puissants. Las, quelle déconvenue lorsque celui-ci apparaît brutalement empoté, peu prévoyant et inapte au combat rapproché, ce qui est un comble. De plus, contrairement à d’autres bad guys du métrage ou de la saga, son visage n’exprime rien et le peu de bestialité que l’on avait pu ressentir ne vient en fait que d’artifices de maquillage.
Evidemment, avec une éminence grise du niveau de magnéto, il était impossible pour un premier film de ce qui se voudrait être une franchise en cas de succès de proposer deux cerveaux pour le groupe de mauvais mutants. Résultat déplorable quand on constate la richesse des personnages du côté adverse avec des individus comme Charles Xavier (évidemment le principe de Nemesis fonctionne dans les deux sens) ou bien Jean Grey ou encore Serval justement. Les bases pour ces trois personnages sont solidement mises en place au point de n’avoir une issue pour certains que dans le dernier opus de la Trilogie. Dents de Sabre était un personnage au potentiel énorme qui aurait pu trouver une place logique dans le second volet des X Men , sans compter la présence d’une lady Deathstrike assez éloignée de ses origines comics mais qui offrait un smplendide combat final. Imaginez un peu qu’au détour des premiers plans , Un Sabretouth habité par la haine contre Wolwerine se jette sur lui où que l’on voit même pourquoi pas un plan flou (style Captain America dans Iron Man) sur un Sasquatch , au loin, annonciateur d’un métrage sur la Division Alpha , création réussie de John Byrne que je n’aurais pas l’impudence de présenter, surtout en m’exprimant sur les X Men. Un beau massacre dont on ne comprendra jamais le Leitmotiv des créatifs. Le Crapeau a été bien mieux adapté pour un personnage secondaire qui n’en valait pas la peine.
Daredevil / Le Tireur
Le Tireur. A l’image de Daredevil dont il est le parfait antonyme, il ne possède pas à proprement parler de supers pouvoirs. Quand on réfléchit bien, le sens radar de l’homme sans peu n’est qu’une résurgence de son état d’aveugle, consécutif certes à sa rencontre forfuite avec un bidon de substances radioactives, mais réaction naturelle du corps malgré tout. Rien à voir avec le regard laser de Cyclope ou le pouvoir météorologique de Tornade. Pour ce qui est de sa forme olympique, elle n’est que le fruit d’un travail constant, comme pour son antonyme. Les adaptations marvel ont eu la (fâcheuse ?) tendance pour rameuter les foules de mettre en scène dès leurs premiers opus les bad guys les plus estimés de chaque franchise (exception faite de Spiderman). On se retrouve ainsi avec les X Men et Magneto, les quatre fantastiques et Fatalis et j’en passe. Est-ce pour autant une bonne chose pour Daredevil ? Dans le monde des comics, le Tireur est un personnage froid au passé trouble et extrêmement complexe. Passant d’un père violent à un parricide à l’âge de 10 ans nonobstant un passage à la NSA puis une carrière de mercenaire à son propre compte, le Tireur est en fait l’anti Frank Castle, ou du moins l’une de ses dérives.
 Ce qui reste intéressant, outre sa coordination parfaite entre ses yeux et ses mains, c’est son parcours croisé avec Daredevil qu’il rendra responsable d’une partie de ses maux (paralysie, tumeur, déchéance de son statut de tueur auprès du Caïd et j’en passe pour ne pas gâcher le potentiel scénaristique). Leurs affrontements seront nombreux et toujours spectaculaires et auront assurés une floppée des plus belles couvertures de Strange en son temps, magazine chéri mais décédé depuis près d’une dizaine d’années. Ces histoires furent magnifiées par Frank Miller qui lui fit exécuté Elektra, le grand amour de Murdock et de Daredevil. Tout est d’ailleurs parti de là. Daredevil se vengea en le laissant s’écraser d’un toit. Mais ce dernier s’en sortit et continua de tuer les femmes comptant dans la vie de l’avocat.
Ce qui reste intéressant, outre sa coordination parfaite entre ses yeux et ses mains, c’est son parcours croisé avec Daredevil qu’il rendra responsable d’une partie de ses maux (paralysie, tumeur, déchéance de son statut de tueur auprès du Caïd et j’en passe pour ne pas gâcher le potentiel scénaristique). Leurs affrontements seront nombreux et toujours spectaculaires et auront assurés une floppée des plus belles couvertures de Strange en son temps, magazine chéri mais décédé depuis près d’une dizaine d’années. Ces histoires furent magnifiées par Frank Miller qui lui fit exécuté Elektra, le grand amour de Murdock et de Daredevil. Tout est d’ailleurs parti de là. Daredevil se vengea en le laissant s’écraser d’un toit. Mais ce dernier s’en sortit et continua de tuer les femmes comptant dans la vie de l’avocat.
Que reste il de ces considérations dans l’adaptation cinéma ? Le fait que le costume ait été modifié apporte un certain plus dans la première partie du film (la réduction primaire à un e panoplie dans la seconde reste trop cheap pour être défendable et même Ben Stiller dans Mystery Men faisait plus crédible) justement par sa constitution d’un look un peu à part. Colin Farrel apporte une folie douce au personnage qui aurait pu être salvatrice à condition de se réapproprier le matériel historique. Autant Dents de Sabre était réussi physiquement que ce Tireur est loupé artistiquement. Du personnage torturé et psychotique de la bande dessinée, Colin Farell ne garde que le côté déjanté et transforme ce fin stratège en grand guignol peu crédible et dont la menace se réduit à peau de chagrin au fur et à mesure que l’on avance dans le film. Il fut un passage mémorable dans une arène de cirque dans le comics qui marqua toute une génération. Le duel dans l’église du film, bien qu’esthétiquement réussi, ne parvient pas à emporter l’adhésion, la faute à une mauvaise utilisation des effets spéciaux , contrairement à leur usage dans Blade II où ils participaient à l’identité même du métrage, mais aussi à une suite d’éléments perturbateurs peu inspirés qui finissent par faire surclasser le Tireur alors que les deux adversaires de force égale ne l’emportent jamais réellement l’un sur l’autre dans leur homologue papier. De plus, la cible sur le front de Farrel est ridicule et le fait de le voir tuer des grands-mères soulantes à coup de cacahuètes (bien que produisant un effet assez jubilatoire) reste assez réducteur quand à la puissance potentielle du personnage. Alors, ou, les multiples séances d’utilisation d’objets divers comme projectiles et la fameuse séquence de la mort du père d’Elektra restent assez bien réalisées, mais un traitement plus sérieux et plus respectueux du matériel original aurait vraiment apporter une touche majeure à ce film espéré et assez réussi por sa version Director’s cut. On est loin de la catastrophe de Dents de Sabre ou de Fatalis bien que restant sur une impression de gâchis, d’être passé à côté de quelque chose. Si seulement ce tireur avait pu avoir plus d’intensité…
Ghost Rider / Méphistophélès
On est indubitablement devant un paradoxe. Dans la bande dessinée , le premier Ghost Rider (il y en aura un second plus moderne du nom de Dan Ketch qui fera parfois équipe avec Johnny B Laze, qui a gardé un fusil un peu particulier de son lien avec Zarathos) vend son âme au diable pour sauver la vie de son père, célèbre motard cascadeur atteint d’un cancer. Dans le film, la même scène se reproduit et on assiste à ce pacte , le diable étant toutefois remplacé par Méphistophélès. Doit on y voir une allusion au diable de Faust ? Le Malin ne serait plus alors le chef infernal que l’on connaît mais simplement un de ses suppôts. La filiation satanique avec Blackhearth tomberait alors d’elle-même puisqu celui-ci doit être le fils du Corrupteur. D’un autre côté, si l’on opte pour un raccourci facile, Méphistophélès devient Méphisto, qui, dans la cosmogonie marvel est effectivement l’équivalent de Satan mais aussi l’un des garants de la réalité au même titre que’Eon, qu’Infinity voire même aussi de Galactus (pour les non convaincus, merci de vous référer ne serait ce qu’au défi de Thanos, qui outre le fait d’être un excellent comics permet aussi de donner leur juste valeur à toutes ces entités cosmiques). Le problème, c’est que ce personnage précis n’a rien à voir avec le personnage de Ghost Rider puisqu’étant l’ennemi juré du Surfer d’Argent. Vous suivez toujours ?
Le film se permet donc de brasser trois influences distinctes au bas mot pour nous offrir un mix que nous dirons inédit d’un personnage qui aurait du brûler la toile, ne serait ce que pour compenser la fadeur maléfique d’un fils hypothétique aux fréquentations discutables qui ne parviennent graphiquement pas à la cheville de la bande de tueurs d’Elektra.
 Il est certain que la classe naturelle de Peter Fonda apporte beaucoup dans la semi réussite de ce personnage mais nous avons déjà pu voir dans le passé un acteur de le même trempe se predre pour Dieu le père tout en méprisant la condition et le prix de la vie humaine , et ce , avec beaucoup plus de panache et d’efficacité… Je veux bien sûr faire référence à Terence Stamp dans Superman II the Donner’s Cut. Sans effets spéciaux à la limite du grotesque, il réussissait de par sa simple présence à envahir l’écran. On pourra bien sûr reprocher à Fonda de ne pas avoir eu d’acteur en verve en face de lui , contrairement à Reeve face à Stamp, tant Nicolas Cage proposait un jeu à peine suffisant pour payer ses impôts de , mais cela ne justifie pas tout. Cabotinage et médiocrité sont au rendez vous.
Il est certain que la classe naturelle de Peter Fonda apporte beaucoup dans la semi réussite de ce personnage mais nous avons déjà pu voir dans le passé un acteur de le même trempe se predre pour Dieu le père tout en méprisant la condition et le prix de la vie humaine , et ce , avec beaucoup plus de panache et d’efficacité… Je veux bien sûr faire référence à Terence Stamp dans Superman II the Donner’s Cut. Sans effets spéciaux à la limite du grotesque, il réussissait de par sa simple présence à envahir l’écran. On pourra bien sûr reprocher à Fonda de ne pas avoir eu d’acteur en verve en face de lui , contrairement à Reeve face à Stamp, tant Nicolas Cage proposait un jeu à peine suffisant pour payer ses impôts de , mais cela ne justifie pas tout. Cabotinage et médiocrité sont au rendez vous.
La Marvel n’a pas su assumer le potentiel de l’une de ses trois sources, alors que son mix des facultés des deux Ghost Rider reste somme toute appréciable (mélange des pouvoirs de l’original avec le regard expiatoire du second). Mieux aurait fallu avoir un bad guy simplement assimilé au Diable, sans nom particulier , ou alors donner pleins pouvoirs au Méphisto cosmique, au risque de phagocyter le héros lui-même, chose évidemment impossible. Ce cinéma de super héros , via des films comme Ghost Rider ou Daredevil (d’ailleurs tous deux mis en scène par le même réalisateur) semble malheureusement avoir oublié que la puissance d’un bon film peut aussi résider dans la force de ses vilains. Lucas en son temps l’avait compris (entre Dark Vador et Skywalker, avec qui aimeriez vous avoir 15mn seuls à seuls ? ) , Last Action Hero l’avait souligné.
La Marvel n’y a pas pensé. Dommage quand on voit la qualité de certains plans et la volonté de filmer dans un clair obscur permanent. Et pour jouer le diable, un simple regard suffit. Comment Peter Fonda n’a-t-il pas pu imposer ce point de vue dans une ère du tout numérique là ù Donner parvenait à susciter l’effroi via une réalisation intelligente, un acteur remarquable, de la suggestion et une musique oscarisée dans The Omen ?
Blade / Deacon Frost
Dans la bande dessinée, Deacon Frost était un chimiste allemand obsédé par l’immortalité. Au détour d’une expérience ayant mal tourné, il se retrouva infecté du virus vampire dans la seconde moitié du … 19ème siècle et depuis ce jour, il se balade à travers le monde, tuant des proies au hasard, simplement pour sa subsistance. C’est de cette manière qu’un soir, il se retrouva à mordre une femme noire qui était en fait la mère du futur Blade. C’’est également Frost qui créa le vampire Hannibal King. Il fut tué à plusieurs reprises par le Daywalker dans les années qui suivirent.
 A priori, pas de quoi se relever la nuit et encore moins de quoi faire un vilain acceptable pour le cinéma tant il apparaît anecdotique. A part le fait d’être le père de Blade, il n’a pas grand-chose de grandiose à son tableau de chasse. Fort heureusement, ce personnage appartient à la galerie de ce que nous pourrons qualifier de réadaptation réussie. Plutôt que de le transposer littéralement, Norringhton remanie ses origines et nous propose un bad guy aux origines contemporaines. Ainsi Frost n’est plus qu’un simple bandit arriviste né dans les années 80 et non plus un savant du siècle passé. Ses motivations prennent également une autre ampleur avec une volonté de devenir le Dieu des Vampires afin de surclasser les sangs purs, autre fait qui ne le concerne guère dans le comics. On conserve toutefois dans un but de construction scénaristique évident les origines impures du personnage et le fait qu »il soit lié à la naissance de Blade.
A priori, pas de quoi se relever la nuit et encore moins de quoi faire un vilain acceptable pour le cinéma tant il apparaît anecdotique. A part le fait d’être le père de Blade, il n’a pas grand-chose de grandiose à son tableau de chasse. Fort heureusement, ce personnage appartient à la galerie de ce que nous pourrons qualifier de réadaptation réussie. Plutôt que de le transposer littéralement, Norringhton remanie ses origines et nous propose un bad guy aux origines contemporaines. Ainsi Frost n’est plus qu’un simple bandit arriviste né dans les années 80 et non plus un savant du siècle passé. Ses motivations prennent également une autre ampleur avec une volonté de devenir le Dieu des Vampires afin de surclasser les sangs purs, autre fait qui ne le concerne guère dans le comics. On conserve toutefois dans un but de construction scénaristique évident les origines impures du personnage et le fait qu »il soit lié à la naissance de Blade.
Le personnage étant peu connu des néophytes, son interprète ne fait guère polémique et il faut bien reconnaître que le choix de Stephen Dorff était plutôt judicieux, lui que l’on avait pu voir à ses débuts dans The Gate. D’apparence frêle, presqu’assimilable à un Junkie, il représente un opposant redoutable à Blade. Mépris de la vie et arrivisme le qualifie sans peine, sans pour autant tomber dans une caricature extrême. Entouré d’une bande de décérébrés, il parvient à en remontrer aux plus âgés , en particulier dans la scène d’exécution d’Udo Kier.
Malin également, quand il affronte Blade en plein jour alors qu’il lui propose de rallier son camp ou lorsque qu’il convie de force les représentants de tous les clans pour leur extirper leurs forces vitales.
Le combat final les opposant est assez réussi même si sa finalité ne laisse guère planer le doute quand au vainqueur. Un exemple parfait de personnage bien transposé, charismatique et dérangeant qui marque encore longtemps les esprits lorsque l’on essaie de regarder Blade Trinity.
Les Quatre Fantastiques / Galactus
Au même titre que Thanos, le personnage de Galactus dépasse le clivage du bien et du mal pour la simple et bonne raison qu’il représente une entité d’équilibre entre ces deux notions, aussi bien qu’entre L’ordre et le Chaos. Véritable soupape de sécurité de la réalité cosmique , il est l’un des personnages les plus imposants de l’Univers Marvel, au sens propre comme figuré. Ses origines remontent à la période pré – Big Bang, moment clé de création dont il absorba l’énergie après une fusion avec la conscience d’Eternité. Emprisonné sous sa forme d’énérgie pure par les Gardiens (j’effectue ici des raccourcis gigantesques car il s’agit avant tout de qualifier leurs apparitions ciné et non leurs origines dessinées) dans la fameuse armure d’influence inca que nous connaissons tous aujourd’hui, il acquiert sa réputation de dévoreur des mondes en se nourrissant de la force vitale des planètes qui correspondent à ses besoins.
Sa première confrontation avec la Terre sera le fruit de sa découverte par Norrin Radd , sur lequel nous reviendrons. Et c’est seulement au détour d’un tour de force de Red Richards que Galactus renoncera à tout jamais à s’attaquer à la planète bleue, sous la menace de l’anéantisseur ultime, arme d’apparence anodine mais capable de rayer de la carte une galaxie entière.
 Dans la bande dessinée, Galactus est doté de pouvoirs infinis, il se crée souvent un hérault pour accomplir ses basses besognes, qui consistent le plus souvent à dégoter une planète. Dans son écurie, on relèvera le Surfer d’Argent mais aussi Nova, Terrax ou bien encore … Superman ! Galactus reste en soi un personnage phare car il n’est pas guidé par un quelconque appât de puissance, de gloire, de gain ou de vengeance, comme c’est le cas de l’essentiel des Vilains de BD. Son but est autre. Il est détesté et craint de par l’Univers car il représente la menace ultime et pourtant, il ne détruit des planètes que lorsque sa faim est devenue insoutenable. Il ne le fait pas par plaisir. Il détruit par nécessité. S’il devait disparaître, c’est la rélaité dans son ensemble qui subirait des altérations telles que l’entité Delphique de Star Trek Enterprise passerait pour une simple plaque d’eczéma.
Dans la bande dessinée, Galactus est doté de pouvoirs infinis, il se crée souvent un hérault pour accomplir ses basses besognes, qui consistent le plus souvent à dégoter une planète. Dans son écurie, on relèvera le Surfer d’Argent mais aussi Nova, Terrax ou bien encore … Superman ! Galactus reste en soi un personnage phare car il n’est pas guidé par un quelconque appât de puissance, de gloire, de gain ou de vengeance, comme c’est le cas de l’essentiel des Vilains de BD. Son but est autre. Il est détesté et craint de par l’Univers car il représente la menace ultime et pourtant, il ne détruit des planètes que lorsque sa faim est devenue insoutenable. Il ne le fait pas par plaisir. Il détruit par nécessité. S’il devait disparaître, c’est la rélaité dans son ensemble qui subirait des altérations telles que l’entité Delphique de Star Trek Enterprise passerait pour une simple plaque d’eczéma.
La suite cinéma des Quatre Fantastiques impliquant le Surfer d’Argent, on s’attendait forcément, en parallèle avec l’album éponyme, à voir débarquer Galactus. La crainte restait de se retrouvait avec une version deluxe de Bioman, avec d’une part un géant, d’autre part des maquettes en carton de la ville. Reconnaissons qu’un Inca géant et violet de la carrure de Galactus risquait d’être ridicule à l’écran. On part donc du principe de la suggestion pendant une grande partie du film, laissant le soin à Norrin radd et à Fatalis de se partager le mauvais rôle durant un temps. Evidemment, celui s’emparera du pouvoir du Surfer et sèmera la panique , faisant passer au second plan Galactus.
Las, en choisissant de lui donner une apparence énergétique pas si stupide que cela, puisque que correspondant à son état originel, le film fait forcément abstraction d’un potentiel de dramatisation énormissime. Sous cette forme, pas de vaisseau, sans vaisseau pas de capsule personnelle caractéristique , et sans cette dernière, pas de pompe à énergie planétaire se mettant en marche ni d’essai pour la détruire sans succès. Les conséquences restent visibles à l’écran, mais sans menace identifiable et on se perd alors en forêt pour capturer le Surfer. Pas de vue sur la zone négative non plus. Et comme le film est destiné à un public pré adolescent et non à un noyau de geeks pur et dur, le tout se finit bien avec un Surfer réussissant l’impossible, à savoir détruire son créateur, ce qui reste une trahison en bonne et due forme du matériel d’origine. Dans la bande dessinée, pour avoir oser se retourner contre son maître, le Hérault est privé de sa liberté de mouvement et ne peut plus quitter la Terre. Dans la version ciné, Galactus est à priori anéanti tandis que le Surfer survit.
La peur inhérente à l’inconnu n’a donc pas le temps de s’installer, le Surfer endossant les problèmes climatiques, Richards ne tente quasiment rien pour contrer ou du moins comprendre Galactus et aucune discussion sur la valeur de la vie et de l’évolution, voire même du bien existant fondamentalement dans las nature humaine ne ressort à l’écran. Tout le monde reprend ses petites vacations sans se préoccuper d’autre chose.
Le fait de transposer Galactus en entité cosmique indéfinie aurait pu avoir du bon mais le résultat de ce traitement de l’un des plus grands personnages de Marvel frôle l’indigence.
Les Quatre Fantastiques / Victor Von Fatalis
Le personnage de Fatalis est un paradoxe de notre temps. Dans les comics, il est à la fois roi, ambassadeur, criminel reconnu, ancien empereur du Monde. Il est également l’un des plus grands experts scientifiques de son temps au même titre qu’un Red Richards doublé d’un grand maître des arts mystiques au niveau proche voire équivalent à celui du Dr Strange. Rajoutons à cela qu’il s’agit d’un des vilains les plus charismatiques de l’Univers marvel avec Thanos, entre autre et qu’il est l’un des personnages phares et historiques de la maison des Idées. L’adaptation au cinéma était don cattendue au tournant, sans compter que face aux Qautre Fantastiques, Fatalis aurait pu avoir un spin off lui étant propre, tant le matériel de base le concernant était touffu. Si Blade de Norrignthon a été la réussite que l’on sait pour un héros somme toute mineur de la cosmogonie des Comics, imaginez un peu ce qu’aurait pu donner Fatalis, The Movie.
Las, il faudra s’en contenter comme d’un sidekick maléfique de base à opposer au gentil redresseur de tort élastique. Quand bien même. Dans ses X Men , Singer avait réussi à faire de Magnéto un pôle scénaristique bien plus développé et intéressant que la majorité de ses bons mutants. Burton dans Batman Returns était lui aussi parvenu à rendre les méchants fascinants au détriment même de son Caped Crusader dont il avait pourtant réinventé partiellement la mythologie.
Le film va être un véritable chemin de croix et une réussite extraordinaire dans la destructuration d’un tel potentiel. Julian McMahon , pourtant agréable et plutôt bon dans le rôle de Cole de la série Charmed, démon majeur sous les traits de Balthazar et accessoirement Source à ses heures perdues va endosser le rôle pour notre plus grand déplaisir. Imbu de lui-même, superficiel, sans ambition aucune, il nous ressert son excellente interprétation du Dr Troy mais dans un rôle qui appelait plus de grandeur. Dans le film de Story, il parvient seulement à nous offrir un enfant gâté ayant grandi trop vite et étant égoïste et un tantinet cruel.
 Pour ce qui est du magnétisme naturel dont il faisait preuve dans les bandes dessinées, il ne reste plus grand-chose non plus. Pire encore, les scénaristes se sont permis d’oblitérer tout le passé tragique du roi de Latvérie, ses origines à la fois gitanes et relevant de la sorcellerie, la haine qu’il voue à Richards depuis l’adolescence pour une expérience qui a mal tourné et enfin son statut de monarque craint et respecté qui lui donnait autant d’allure. Car ne l’oublions pas, toute la fascination qui s’exerce autour de Fatalis vient en partie du fait qu’il est roi et qu’il est intouchable quoiqu’il fasse à l’extérieur de son pays grâce à son immunité diplomatique. Le seul autre personnage de Marvel qui est roi et qui se bat dans l’interminable conflit manichéen bien contre mal est la Panthère Noire , voire peut être Namor aussi, bien qu’il soit déchu de son titre pendant un temps. Et encore, Namor étant plus qu’un mutant mortel, on ne peut guère établir la comparaison.
Pour ce qui est du magnétisme naturel dont il faisait preuve dans les bandes dessinées, il ne reste plus grand-chose non plus. Pire encore, les scénaristes se sont permis d’oblitérer tout le passé tragique du roi de Latvérie, ses origines à la fois gitanes et relevant de la sorcellerie, la haine qu’il voue à Richards depuis l’adolescence pour une expérience qui a mal tourné et enfin son statut de monarque craint et respecté qui lui donnait autant d’allure. Car ne l’oublions pas, toute la fascination qui s’exerce autour de Fatalis vient en partie du fait qu’il est roi et qu’il est intouchable quoiqu’il fasse à l’extérieur de son pays grâce à son immunité diplomatique. Le seul autre personnage de Marvel qui est roi et qui se bat dans l’interminable conflit manichéen bien contre mal est la Panthère Noire , voire peut être Namor aussi, bien qu’il soit déchu de son titre pendant un temps. Et encore, Namor étant plus qu’un mutant mortel, on ne peut guère établir la comparaison.
Fatalis est donc LE personnage de l’écurie de Spiderman and co qui a été le plus massacré lors de son adaptation, au grand dam des geeks qui n’auront pas pu se consoler de son retour encore plus caricatural dans l’opus suivant qui réussit en plus la gageure de massacrer un album culte de notre jeunesse écrit par le grand Stan Lee.
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Le Blog des DVDpasChériens
Les dvdpascheriens ayant la fibre journalistique peuvent participer à ce blog. Sur le thème des DVD, de la HD et de la vente en ligne. On y trouve des critiques, des dossiers, des articles sur les nouveautés ...
Rechercher
Cat�gories
- Toutes
- Box office cinéma (50)
- Dossier (34)*
- Interview (42)
- Nouveautés (615)
- Point de vue (11)
- Test / Critique (1511)
- Test de commande (10)
- Top 10 (31)
Archives
- Janvier 2017 (1)
- Novembre 2016 (3)
- Octobre 2016 (3)
- Septembre 2016 (5)
- Ao�t 2016 (7)
- Juillet 2016 (3)
- Juin 2016 (4)
- Mai 2016 (6)
- Avril 2016 (3)
- Mars 2016 (4)
- F�vrier 2016 (7)
- Janvier 2016 (12)
- Suite...
Qui est en ligne?
- Visiteurs: 14
Divers
 Flux XML
Flux XML
- RSS 0.92: Articles, Commentaires
- RSS 1.0: Articles, Commentaires
- RSS 2.0: Articles, Commentaires
- ATOM 1.0: Articles, Commentaires