Le Blog des DVDpasChériens
16.09.16
Titre du film : Le fils de Jean
Réalisateur : Philippe Lioret
Année : 2016
Origine : France
Durée : 1h38
Avec : Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Marie-Thérèse Fortin, Catherine de Léan, etc.
Par Nicofeel

Le cinéaste Philippe Lioret avait beaucoup ému les spectateurs et connu un succès d’estime avec Je vais bien, ne t’en fais pas, drame familial prenant, où Kad Mérad faisait preuve d’une étonnante justesse de ton dans un rôle dramatique.
Son nouveau long métrage, Le fils de Jean, partage plusieurs points communs avec ce film. Dans les deux cas, il s’agit de drames familiaux, où la disparition d’un être cher est au cœur de l’intrigue.
Dans Je vais bien, ne t’en fais pas (2006), l’absence d’un frère pèse de plus en plus sur les frêles épaules d’Elise (« Lili »), interprétée par une épatante Mélanie Laurent. Dans Le fils de Jean, librement adapté du roman de Jean-Paul Dubois, « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi », Mathieu est un trentenaire célibataire, père d'un jeune garçon, travaillant dans une grande entreprise agro-alimentaire. Son quotidien est chamboulé le jour où il apprend que son père naturel, dont il ne connaissait jusqu’alors pas l’identité, vient tout juste de décéder.
Comme pour Elise qui cherchait à savoir ce qu’il était advenu de son frère, Mathieu est porté par une irrépressible envie de connaître ses origines. Il décide alors de débarquer au Canada où résident deux demi-frères inconnus.
De manière très subtile, Philippe Lioret déploie un mystérieux drame familial sous les yeux du spectateur, qui se retrouve tout aussi perdu que Mathieu. Le film use à sa façon des codes du thriller. Il y a un vrai suspense dans Le fils de Jean. Comment cet homme a-t-il pu disparaître au beau milieu d’un lac ? Et puis, est-il réellement mort ? Pour quelle raison l’ami de Jean, Pierre, demande à Mathieu de se faire passer pour un « ami français » et donc de mentir à ses demi-frères au sujet de son identité ? Quant à la relation historique entre Pierre et Jean, elle intrigue.

Mais après tout, dès le départ, Philippe Lioret annonce que l’on aura droit à un thriller puisque Mathieu rédige des polars pour son plaisir personnel, et que la femme de Pierre aime ce genre de livre.
Comme tout bon thriller, Le fils de Jean multiplie les artifices, les fausses pistes, les faux-semblants, et suscite de la même manière, tant chez Mathieu que chez le spectateur, espoirs naissants et déceptions manifestes. Sous une fausse identité, Mathieu apprend à connaître ses deux demi-frères et se lasse sans doute de la nature humaine, comme souvent bien plus attachée aux considérations matérielles (l’héritage de Jean) qu’aux considérations humaines. Surtout que Pierre, médecin bourru, ne lui décrit pas son père sous un jour très favorable.
L’envie de connaître la véracité des faits conduit le spectateur à s’intéresser à la quête de Mathieu. Pourtant, au bout d’un moment, on se demande bien si Philippe Lioret ne nous aurait pas conduit à un endroit précis, pour mieux nous égarer. Pourquoi diantre le père de Mathieu aurait-il laissé comme seul cadeau à son fils français un tableau, sans la moindre explication ? Stratagème calculé ? Mort fictive ?
C’est au moment où l’on a l’impression que cette histoire commence à tourner en rond que le film fait un virage à 180 degrés.
De la même façon que pour Je vais bien, ne t’en fais pas, Philippe Lioret a pris soin d’élaborer un twist ayant pour conséquence de nous amener à reconsidérer tout ce que l'on avait vu jusqu'à présent.
Si certains spectateurs ne seront pas forcément surpris par ce nœud dramatique, de dernier se révèle d’une efficacité imparable. Il a le mérite de mettre sur le devant de la scène une émotion sincère et vraie, où Philippe Lioret privilégie les regards échangés, qui en disent long sur les sentiments des protagonistes.
A l’instar de La chambre du fils de Nanni Moretti, à la fin tous les personnages sont en phase avec eux-mêmes et avec leur entourage. On a l'impression que le futur se construit aujourd’hui. On se retient de verser des larmes devant ce drame aux thématiques universelles.
C’est sans doute la distribution quatre étoiles du film qui justifie un tel sentiment. Avec sa mine juvénile de jeune premier, Pierre Deladonchamps émeut le spectateur dans le rôle de Mathieu. L’acteur est clairement le référent du spectateur par son besoin de connaître ses racines et d’aller de l’avant. Il nous touche par les relations affectives qu’il tisse avec les différents personnages du film. Nos « cousins » canadiens peuvent de leur côté se targuer de l’interprétation de Gabriel Arcand, tour à tour bougon, soutien de Mathieu et symbole de la figure patriarcale. Gravitent autour de son personnage de Pierre, deux excellentes actrices : Marie-Thérèse Fortin, dans le rôle de l’épouse aimante et bienveillante, qui en sait bien plus qu’il n’y paraît ; Catherine de Léan, dans le rôle de la fille, Bettina, qui est proche de Mathieu.
Dix ans après Je vais bien, ne t’en fais pas, Philippe Lioret réalise ce qu’il sait le mieux faire : un drame familial aux secrets savamment entretenus. Outre un scénario astucieux, il peut compter sur les très beaux paysages canadiens (la scène du lac pourrait presque rappeler la découverte de Laura Palmer dans Twin Peaks) et sur une distribution au top niveau. N’en jetez plus, la coupe est pleine et vous savez ce qu’il vous reste à faire.

15.09.16
Titre du film : Toni Erdmann
Réalisatrice : Maren Ade
Année : 2016
Origine : Allemagne
Durée : 2h42
Avec : Peter Simonischek (Winfried – Toni Erdmann), Sandra Hüller (Inès), etc.
Par Nicofeel

Présenté en compétition officielle lors du dernier festival de Cannes, Toni Erdmann y est reparti bredouille alors qu’il avait les faveurs des critiques. Ces derniers ne s’y étaient pourtant pas trompés. Toni Erdmann est une œuvre aussi excellente que singulière.
Sa réalisatrice, l’allemande Maren Ade, a mis en scène une comédie dramatique forte, où le sens du burlesque risque toutefois de décontenancer plus d’un spectateur.
Et pourtant, c’est bien ce qui fait l’originalité de Toni Erdmann. D’emblée, on entre dans le quotidien de Winfried, un soixantenaire célibataire, employé dans une école, dont le signe particulier est d’aimer faire des farces à ses congénères. La première « victime » est son facteur. Il lui fait croire que son colis est destiné à son frère sortant de prison. Après s’être déguisé grossièrement pour faire croire qu’il est ce fameux frère, il lui dit que le colis est piégé avant de lui avouer qu’il s’agit d’une blague. Cette plaisanterie est symptomatique du mode de pensée de Winfried. Il adore faire le pitre et amuser son entourage. Quelque part, il a conservé un esprit d’enfant.
Tout l’inverse de sa fille, Inès, cadre dans un grand cabinet d’audit international. Cette jeune femme, très stricte, ne prend pas vraiment le temps de s’amuser. Son travail de conseil en externalisation en Roumanie, lui accapare l’intégralité de son temps. Elle est obnubilée par sa réussite professionnelle et est prête à tout pour y arriver, y compris à assister à des dîners mondains ennuyeux ou à faire visiter Bucarest à la femme d’un client important sur son temps libre.

Forcément, quand Winfried débarque à l’improviste chez Inès, nul doute que les choses ne vont pas se passer comme prévu pour la jeune cadre dynamique. Notre trublion vient perturber le quotidien minutieusement établi d’Inès : il perturbe son principal client, il fait l’imbécile avec ses collègues de travail et ses connaissances.
L’apparente bouffonnerie de Winfried pourrait donner l’impression que le film repose uniquement sur son aspect comique. Que nenni. Lors d’une discussion en tête à tête avec sa fille, Winfried lui demande si elle est heureuse dans la vie. Question à la fois simple et complexe pour cette femme ne souhaitant absolument pas se lancer dans une introspection, pouvant se révéler douloureuse. Raison pour laquelle elle écourte le séjour de son père, fatiguée de ses facéties et de son intrusion dans sa vie.
Alors que l’on pense que Winfried a rejoint l’Allemagne, il revient à la charge pour le deuxième acte du film sous l’identité de Toni Erdmann. Il se présente désormais en tant que coach de vie et consultant, ami de Ion Tiriac. Il repart de plus belle dans ses bouffonneries, dans le but évident de se rapprocher de sa fille et de lui faire comprendre que l’essentiel est ailleurs pour cette business woman.
Affublé d’un dentier répugnant et d’une perruque ridicule, Toni Erdmann n’a pas peur de se moquer de lui-même avant de pointer du doigt tous ces bourgeois et autres riches méprisants à l’égard d’autrui.
Si la cinéaste Maren Ade prend le parti de l’humour, c’est pour mieux critiquer notre société capitaliste actuelle, où l’argent est devenu le cœur de tout. Derrière les conseils en externalisation prodigués par Inès, il y a surtout des gens sur le point de perdre leur emploi. Pour quelle raison ? Pour augmenter les profits d’une entreprise qui n’en a jamais assez. Toni Erdmann s’en prend ouvertement à ces méthodes au management douteux et fustige également les fastes de bourgeois / cadres déconnectés de la réalité. On est proche de la description des golden boys version American psycho.
Heureusement, le film ne se focalise pas seulement sur les travers de notre société. C’est aussi une étude – plus fine qu’il n’y paraît – de la relation entre un père et sa fille. Si les deux paraissent totalement opposés, il n’empêche qu’ils ont un point commun : celui d’être désespérément seuls. Le besoin de se retrouver est donc fondamental.
A cet effet, si le film joue à fond la carte du burlesque, il réserve quelques beaux moments d’émotion. On songe notamment à cette scène surréaliste où Winfried – Toni Erdmann se rend à la fête de sa fille (une fête mémorable, prouvant qu’elle a commencé à changer) affublé d’un étrange costume bulgare, lointain cousin de Chewbacca. D’après les us et coutumes locales, ce costume aurait pour but de chasser les mauvais esprits. En l’état, c’est une façon pour Toni Erdmann de libérer Inès des entraves mentales qu’elle s’est créées. Et en avant la liberté ! La fin du film, très ouverte, comporte peu de dialogues. Pratiquement tout se joue au niveau des regards échangés entre Toni Erdmann et sa fille.
D’ailleurs, la réussite de ce long métrage tient pour beaucoup à sa distribution. Peter Simonischek est épatant de naturel dans le rôle de Winfried – Toni Erdmann. Quant à Sandra Hüller, elle donne bien le change dans le rôle difficile de l’impavide et ambitieuse Inès. Sans eux, le film n’aurait pas le même cachet.
Pour autant, tout n’est pas parfait. Le principal reproche que l’on peut formuler tient à la durée du film. Les 2h42 qui attendent le spectateur ne sont pas justifiées. Il eut été plus judicieux de couper certaines séquences, pour limiter la durée à un total de deux heures, par exemple. Il faut reconnaître que la première heure, sans être laborieuse, est trop étirée.
Dans l’ensemble, Toni Erdmann n’en demeure pas moins une œuvre atypique, très drôle et touchante par moments. Cela n’est pas un hasard si Toni Erdmann déclare être un coach de vie. Celui qui est le référent du spectateur, est aussi un miroir pour ce dernier. Il est là pour nous amener à reconsidérer notre propre vie. Vous avez dit bien vu ?

10.09.16
Titre du film : Bastard
Réalisateurs : Powell Robinson et Patrick Robert Young
Année : 2016 (date de sortie non prévue à l'heure actuelle)
Origine : Etats-Unis
Durée : 1h22
Avec : Rebekah Kennedy (Betty), Ellis Greer (Hannah), Tonya Kay (Rachael), Dan Creed (West), Will Tranfo (Jake), Burt Culver (Michael), Ryan Shoos (Tanner), etc.

Les films d'horreur sortant au cinéma ou en DVD sont légion chaque année. Dès lors, il n'est pas facile de faire preuve d'originalité ou tout simplement de tirer son épingle du jeu.
Totalement inconnus au bataillon, les réalisateurs Powell Robinson et Patrick Robert Young se sont sans doute rappelés cette idée, lorsqu'ils ont mis en scène Bastard, leur premier long métrage.
Ce film est clairement l'oeuvre de fans de films d'horreur, tant certaines références paraissent évidentes. Toutefois, Bastard ne croule pas sous ces références et fait même preuve d'une certaine originalité.
On appréciera ainsi le début du film avec ce duo de psychopathes Hannah et West, qui détroussent sans vergogne des chauffeurs libidineux et autres pervers, ayant la bien mauvaise idée de croiser leur route. On songe immédiatement aux tueurs de la lune de miel. On s'attend alors à un road-movie horrifique avec des morts s'amoncellant au fur et à mesure du parcours de nos amoureux fous. On imagine bien les séquences à venir, ce qui n'est pas sans nous déplaire. D'autant que le film fait preuve d'un dynamisme, qui ne va jamais se démentir.

Pourtant, le film va rapidement prendre un autre tournant. Ce serait sous-estimer la capacité des réalisateurs que de les limiter à un road-movie horrifique. Leurs ambitions sont plus importantes et les deux compères se révèlent bien plus astucieux qu'il n'y paraît. Bastard est à sa façon une sorte de film-choral. Outre ce duo de psychopathes que l'on ne voudrait pas croiser dans la vie, ce film développe plusieurs histoires en parallèle, finissant par se rejoindre : tel un policier homosexuel au bout du rouleau, vivant une histoire contrariée. Et puis on a surtout la description de deux jeunes, Jake et Betty (frère et sœur ?), venant de quitter le cocon familial pour des raisons obscures (abus sexuel, violence ?). On a réellement peur pour eux quand on voit qu'ils sont pris en auto-stop par Hannah et West.
Tout ce beau monde décide de se ressourcer dans un endroit paisible, une résidence tenue par une jeune femme, Rachael, qui n'a pas l'air non plus d'être au-dessus de soupçon.
A la manière d'un pur slasher, les réalisateurs Powell Robinson et Patrick Robert Young mettent en scène un tueur masqué, qui va d'abord s'en prendre à des inconnus avant de jeter son dévolu sur tout notre joli monde. L'un des attraits du film consiste alors à se demander, comme dans un Cluedo, l'identité du tueur qui exécute sans pitié ses victimes. Les fans de films d'horreur apprécieront sans nul doute la violence des meurtres et la générosité du gore qui a cours. Certes, on ne se situe pas dans Massacre à la tronçonneuse, mais certaines mises à mort se révèlent tout à fait marquantes.
Et puis ce n'est tout de même pas fréquent que l'on voit certains psychopathes se faire attaquer par d'autres psychopathes. Dans un film où la réflexion n'est pas fondamentalement de rigueur, les cinéastes ont peut-être un message à faire passer. Si au premier abord, tout paraît aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, quand on gratte le vernis les choses se révèlent bien différentes. La société a engendré nombre de personnes dérangées, faisant payer leur mal-être à leurs congénères. La société américaine a beau être l'une des plus développées au monde, elle comporte beaucoup de psychopathes et rednecks que l'on préfère éviter au quotidien.
Entre des scènes d'horreur bien sèches et « carrées », une multiplicité d'acteurs et une intrigue digne d'un bon slasher, Bastard a de quoi tenir la route. Toutefois, le film paye ses excès. Sur une durée relativement réduite – à peine plus d'1h20 – les réalisateurs ont voulu en mettre plein la vue au spectateur. Au détriment du scénario dont la crédibilité laisse par moments franchement à désirer. On pourra ainsi ergoter contre des facilités scénaristiques, à l'image de cette scène où une prisonnière regarde une vidéo comportant des images violentes, dont on se demande bien comment elles ont pu être filmées. Certes, il s'agit d'une scène choc en lien avec ce qui arrive à la prisonnière, mais tout de même. Dans le même ordre d'idée, le film laisse franchement à désirer dans sa séquence finale, avec des coïncidences vraiment tirées par les cheveux. Mais après tout, le final annonce un épisode 2 de Bastard que l'on attend avec un certain intérêt.
Car ces défauts n'entament pas le plaisir que l'on prend à regarder ce film d'horreur faisant preuve d'une réelle générosité dans ses scènes gores et d'un esprit ludique tout à fait plaisant. Bastard aurait mérité de sortir sur grand écran.

09.09.16
Titre du film : L'économie du couple
Réalisateur : Joachim Lafosse
Année : 2016
Origine : Belgique
Durée : 1h40
Avec : Bérénice Béjo, Cédric Kahn, Marthe Keller, etc.
Par Nicofeel

Après Nue propriété (2006) et A perdre la raison (2012), le cinéaste belge Joachim Lafosse continue de tracer son sillon de l'étude de la famille. Chez Lafosse, la famille est loin d'apparaître sous un jour favorable. Il y est constamment question de tensions, d'étouffement, de désaccords profonds, avec souvent l'argent comme source de conflits.
D'ailleurs, dans son dernier film, L'économie du couple, Lafosse dépeint la vie privée de Marie et Boris, deux personnes mariées vivant sous le même toit mais ne partageant plus rien. Les sentiments ont disparu entre eux et seules leurs deux petites filles – de jolies jumelles – demeurent le lien très fragile qui les fait inexorablement cohabiter.
En dehors de leurs enfants, l'argent est au cœur de leurs discussions. Boris ne quittera pas le domicile conjugal tant qu'il n'aura pas récupéré « sa » part. Si la maison a été entièrement payé par sa femme, il estime que les travaux qu'il a effectués lui ont fait gagner de la valeur.
Pendant plus d'heure trente, on assiste à la cohabitation houleuse d'un couple qui a littéralement explosé. Boris donne l'impression d'un mari irresponsable, immature et profiteur. Il ne travaille pas et vit aux crochets de sa femme. Cette dernière ne peut pas compter sur lui et après une dizaine d'années de vie commune, elle ne peut plus le supporter. D'autant qu'il passe son temps à la chercher, à la provoquer. A se demander si cette situation ne l'amuse pas. « Ce sont tes règles » déclare-t-il à plusieurs reprises, une façon facile de l'agacer.

On sent vraiment qu'il y a un point de non retour (voir la scène du dîner avec les amis de Marie) et que les choses ne peuvent qu'aller de mal en pis. Même l'argent ne fait pas tout.
Joachim Lafosse décrit avec beaucoup de pertinence l'usure d'un couple lambda et la fin de l'amour. Son film est d'autant plus intéressant qu'il est très réaliste. Les dialogues (l'un des co-scénaristes n'est autre que Mazarine Pingeot) ciselés ne donnent pas l'impression d'être joués. On a droit à une impressionnante violence verbale, en mesure de secouer le spectateur.
Surtout que Joachim Lafosse a l'intelligence de faire adopter le point de vue de Marie. On souffre pour cette femme qui vit une séparation difficile.
A cet effet, le lieu de l'action du film n'est pas anodin. Il se passe quasi exclusivement dans cette maison familiale, avec aucun horizon à l'extérieur. De la sorte, on ressent l'étouffement de ces personnages, obligés de vivre en vase clos, faute de mieux. La mise en scène épouse d'ailleurs les thématique de ce long métrage. Les nombreux plans fixes sont là pour signifier l'absence de solution. Quant aux mouvements de caméra, matérialisés par des travellings, ils attestent de la violence des propos échangés entre Boris et Marie.
Le film de Lafosse est tellement bien fait que le spectateur est happé par les sentiments des uns et des autres : la souffrance de Marie et la malice de Boris, qui cherche à la faire craquer sur le plan mental.
Evidemment, dans un tel film, la réussite tient pour beaucoup à la performance des acteurs. A cet égard, Bérénice Béjo est vraiment épatante dans le rôle de cette femme à bout, qui veut plus que tout ménager ses enfants, tout en cherchant une issue à son conflit conjugal. Quant à Cédric Kahn, que l'on connaît plutôt en tant que réalisateur (L'ennui, Roberto Succo), il nous épate dans le rôle du « méchant », une personne sans foi ni loi, dont l'argent est manifestement le seul point d'intérêt.
L'économie du couple est finalement en phase avec son temps. On vit en effet une époque où la séparation est devenue banale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais Joachim Lafosse a le mérite de nous montrer que les dégâts collatéraux peuvent être importants sur le plan affectif. Il n'hésite pas à ce titre à dresser le portrait sans fards d'un couple ne s'aimant plus.
La mise en scène de ce cinéaste belge adopte totalement les thématiques de L'économie du couple. C'est par cette réalisation rigoureuse que Joachim Lafosse signe sans nul doute son meilleur film. Et l'une des œuvres les plus marquantes de l'année 2016, jusque-là relativement pauvre sur le plan cinématographique. Vivement la prochaine étude de mœurs de Joachim Lafosse !

20.08.16
Titre du film : Rosalie Blum
Réalisateur : Julien Rappeneau
Année : 2016
Origine : France
Durée : 1h35
Avec : Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz, Anémone, Philippe Rabbot
Par Nicofeel

Habitué jusque-là au rôle de scénariste (Largo Winch 1 et 2, Cloclo), Julien Rappeneau, fils de Jean-Paul, réalise avec Rosalie Blum son premier long métrage. Il adapte à cet effet la bande dessinée éponyme de Camille Jourdy.
Rosalie Blum est un film marqué du sceau de la sensibilité. Dès le départ, on nous présente le personnage de Vincent Machot, un trentenaire réservé, totalement au service de sa vieille mère possessive. Alors qu'il est désespérément seul dans sa vie, il est intrigué par une femme qu'il aperçoit par hasard dans la rue. Il s'agit évidemment de Rosalie Blum. Vincent a l'impression de la connaître (le final du film nous dira en quoi c'est le cas). Elle l'intéresse tellement qu'il la suit partout, à tel point que ça en devient quasi maladif.
Si le film n'est pas directement tourné vers la comédie, il réserve malgré tout de bons moments de rigolade. Il faut voir le pauvre Vincent suivre maladroitement Rosalie, dans ses moindres faits et gestes, que cela soit sur son lieu de travail à la supérette du coin ou à l'église où elle chante. On n'a pas vraiment affaire au roi de la filature. Loin s'en faut ! Rosalie l'a d'ailleurs remarqué depuis un moment.
C'est alors qu'intervient un amusant et inattendu renversement de situation. On a droit à l'arroseur arrosé ou plutôt au suiveur suivi. Rosalie Blum, également seule dans la vie, se plaît à avoir un mystérieux suiveur à ses basques. Avec la complicité de sa nièce, Aude, elle prend le parti de le faire suivre !

Le film oscille dès lors dans deux directions a priori antinomiques et pourtant complémentaires : la comédie et le drame. La comédie est à l'oeuvre par le biais des différents stratagèmes utilisés par Rosalie Blum pour découvrir qui est ce Vincent Machot et quelles sont ses motivations. Aidée de son fantasque voisin et de ses copines, Aude monte une véritable équipe pour pister Vincent. Leurs découvertes seront à la hauteur des délires sur Vincent (« c'est peut-être un psychopathe »). La rencontre avec la mère un peu fofolle de Vincent, donne lieu à une scène délirante.
Et puis, à l'instar de 500 jours ensemble, le réalisateur Julien Rappeneau a eu la bonne idée de redistribuer les cartes – de la même façon que l'arroseur se retrouve arrosé – en changeant de perspective par le biais d'astucieux flashbacks. En effet, on revoit certaines scènes mais d'une autre façon, ce qui apporte des éléments de réponse. On se croirait presque dans un Cluedo sur le mode humorstique (la vérité sur l'étrange pratique dans la forêt vaut son pesant d'or).
Toutefois, Rosalie Blum n'est pas une comédie. Il y a une dimension sensible, dramatique, qui constitue un de ses piliers. D'abord, il y a l'évident besoin pour Vincent, qui a repris le salon de son père, et qui vit dans le même immeuble que sa mère, de couper le cordon avec cette dernière. Son intérêt pour Rosalie Blum et pour les personnes qu'il va rencontrer, est une façon de s'accorder un nouveau départ. Ensuite, il y a tout le passé de Rosalie Blum qui refait surface progressivement. Un passé lourd qu'il est difficile d'affronter. Le film est fort dans le sens où il montre que cette femme a du mal à se reconstruire suite à des événements dramatiques qu'elle a connu autrefois.
Pourtant, quand la comédie et le drame se rencontrent, on a droit à un florilège d'émotions, avec ces êtres seuls, cabossés par la vie, parfois laissés-pour-compte ou tout comme (Aude et son voisin), prêts à un nouveau départ.

La distribution du film est formidable. Noémie Lvovsky est impeccable dans le rôle de l'étonnante et mystérieuse Rosalie Blum. Quant à Kya Khojandi, cet acteur peu connu est parfait en Vincent Machot, un homme timide qui souhaite plus que tout s'émanciper et vivre une autre vie. Mais dépasser sa timidité, est souvent bien plus facile à dire qu'à faire. Le film réserve tout de même de beaux moments de tendresse, et même d'amour. Eh oui ! Mais revenons au casting. La mignonne Alice Isaaz, vue dans La crème de la crème de Kim Chapiron, interprète de façon franche et directe le rôle de Aude. Les seconds rôles sont également à la fête : que ce soit Anémone, plus piquante que jamais dans le rôle de la mère de Vincent, dont la folie n'a d'égale que l'originalité. Et que dire de Philippe Rabbot, le compagnon dans la vie de Romane Bohringer, interprétant tout naturellement le personnage du délirant voisin de Aude, fan d'animaux et disposé à plein de bizarreries dans le cadre de son « travail »...
Sensible, drôle et touchant, Rosalie Blum est un beau film qui donne forcément envie de lire le roman graphique de Camille Jourdy.
18.08.16
Par Flo001fg
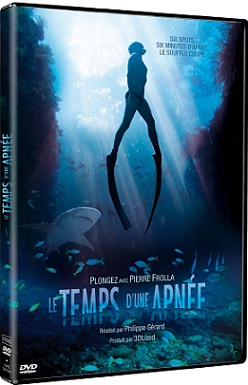
Synopsis :
Ce documentaire suit l’apnéiste quadruple champion du monde, le monégasque Pierre Frolla, dans un voyage de 51 jours. Parcourant les océans (indien, pacifique, atlantique et mer méditerranée) et en compagnie d’une tribu de Nouvelle-Calédonie, le plongeur nous fait découvrir les plus beaux spots de plongée du monde.

Mon avis :
En 1988, Luc Besson popularisait avec "Le Grand Bleu", une discipline sportive jusque-là peu connue du grand public, la plongée en apnée! Si le film se concentrait pas mal sur les exploits sportifs de Jacques Mayol et Enzo Molinari (personnage inspiré en réalité d’Enzo Maiorca), il montrait déjà également les rapports très particuliers que ces plongeurs entretiennent souvent avec la nature et bien évidemment tout particulièrement avec le milieu marin...

Avec "Le temps d'une apnée", le réalisateur Philippe Gérard nous propose un film documentaire suivant l'apnéiste quadruple recordman du monde Pierre Frolla durant 51 jours à travers ses plongées dans la mer méditerranéenne et les océans indien, pacifique et atlantique. Dans ce film d'un peu moins d'une heure donc, l'on perçoit pleinement l'amour qu'a le plongeur pour son environnement de prédilection (les océans en l’occurrence) et pour ses habitants.

On va le suivre ainsi dans son école de plongée avant que celui-ci nous entraîne à la rencontre des cachalots, des requins-tigres ou encore d’une murène avec qui il aura un contact pour le moins surprenant. Le documentaire nous offre, comme on peut s'en douter, des images absolument magnifiques, mais il faut dire que le réalisateur a su s'entourer, faisant notamment appel à René Heuzey ("Océans") en tant que directeur de la photographie. D’ailleurs, le film a remporté le prix de la meilleure image au festival du film de Corée du Sud, un prix amplement mérité.

En revanche, on pourra déplorer le fait que ce documentaire apparemment filmé à l’origine en 3D, ne nous soit pas proposé dans une édition nous permettant de bénéficier du relief... On n’a en effet le droit qu’à une simple édition DVD, même pas une édition Blu-ray qui aurait tout de même pu mettre en valeur les splendides images du film. Quel dommage! Mais, bon ne boudons pas notre plaisir, c’est déjà pas mal de pouvoir avoir ce documentaire sur support physique à l’heure où la plupart des gens ne jurent que par la dématérialisation.

"On A Long Breath" (Oui, le film est plus connu sous ce titre!) nous fait voyager et surtout rêver grâce à ses images magnifiques et rien que pour cela il vaut le détour, mais en plus il nous montre la plongée en apnée sous un angle nouveau et ça, c’est plutôt sympa également et intéressant!


"Le temps d'une apnée" est sorti en DVD le 16 août 2016 chez Factoris Films dans une édition proposant le film au format 1.78:1 16/9ème compatible 4/3 avec piste audio française Dolby Digital 5.1. Comme à son habitude, l'éditeur nous offre en plus la copie digitale du film en illimité en version française 2.0 AAC. En revanche, aucun bonus ne nous est ici offert...

17.08.16
Par Flo001fg
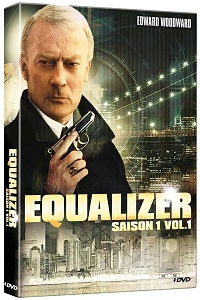
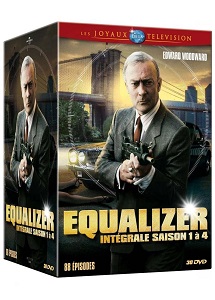
Synopsis :
Robert McCall, après des années dans les services secrets américains, met son expérience au service des plus faibles. Grâce à ses contacts et réseaux acquis pendant son passé d’espion, il devient le justicier des opprimés de New York qui font appel à lui. Son nom de code : l’Equalizer. Implacable, solitaire et sans pitié envers les criminels, il espère expier ses actions passées en aidant ses concitoyens...

Mon avis :
Si c'est avant tout évidemment la récente adaptation en film par Antoine Fuqua avec Denzel Washington qui a remis en lumière cette série tombée quelque peu dans l'oubli, la seule vue du génial et oppressant générique de "The Equalizer" nous replonge aux fins fonds de nos souvenirs et nous rappelle à quel point cette série policière était sympa...

Créée par Richard Lindheim ("B.J. and the Bear") et Michael Sloan ("L'homme au katana", "Alfred Hitchcock présente", "Kung fu, la légende continue"), la série "The Equalizer" capte immédiatement notre attention grâce à un premier épisode pilote mêlant plusieurs intrigues, mis en scène de façon dynamique et au montage particulièrement efficace.

Malgré un rythme soutenu, on a déjà le temps de s'attacher au personnage principal de la série, Robert McCall, interprété par Edward Woodward ("The Wicker Man", "Callan", "1990", "Les nouveaux professionnels"), un ancien agent des services secrets américains à la retraite, qui monte une petite agence pour aider les personnes en détresse. Il faut dire que c'est un personnage généreux, mais qui a aussi des failles et notamment par son passé où il a notamment pas mal délaissé sa famille. Son personnage est d'ailleurs assez étonnant, car si l'action se déroule à Manhattan, lui, ferait plutôt anglais de par son flegme, sa classe, mais également sa voiture, puisqu'il roule toujours en Jaguar...

Avec "L’Enlèvement", le deuxième épisode, on retombe dans un schéma plus classique, avec une seule intrigue et aucune incursion dans la vie privée de notre héros. L'intrigue tient toutefois la route et on reste totalement imprégné par la série. Comme dans l'épisode pilote, on retrouve ici dans le rôle du lieutenant Jefferson Burnett, l'acteur Steven Williams ("The Blues Brothers", "Vendredi 13 : Jason va en enfer", "Los Angeles Heat"), bien connu pour son rôle du Capitaine Adam Fuller dans la série "21 Jump Street".

Dans "Le Transfuge", le troisième épisode, on retrouve une structure d'épisode plus proche de l'épisode pilote, avec une double intrigue, dont une qui ramènera notre héros dans son passé d'agent secret avec une histoire classique d’espionnage sur fond de guerre froide. Dans cet épisode, on notera la présence de Robert Joy ("Recherche Susan désespérément", "La part des ténèbres", "Waterworld", "La colline a des yeux", "Les experts: Manhattan") dans le rôle de Jacob Stock, un agent secret qui réapparaîtra par la suite à plusieurs reprises dans la série.

"La Grande Ville", le quatrième épisode, pourrait presque tourner à la comédie tant la petite famille au coeur de cet épisode semble avoir la poisse, mais au final il s'agira d'une sordide histoire de prostitution, qui ôtera vite le côté presque comique du début de l'épisode. Dans cet épisode, on remarquera quelques têtes bien connues et notamment celle de J.T. Walsh ("Good Morning, Vietnam", "Des hommes d'honneur", "Last Seduction", "Pleasantville") dans le rôle de Sam Griffith, le père de famille ou encore celle de Lori Petty ("Booker", "Point Break", "Sauvez Willy", "Tank Girl") dont c'était ici le premier rôle.

"Police en jupon", le cinquième épisode, bien que très classique, est vraiment pas mal également avec une histoire de flics ripoux, signée entre autres par Kathryn Bigelow ("Aux frontières de l'aube", "Blue Steel", "Point Break", "Strange Days", "Démineurs") et parmi lesquels on remarquera l'acteur Will Patton ("Le client", "Armageddon", "Le plus beau des combats", "24 heures chrono"), mais également Esai Morales ("Bad Boys", "La Bamba", "Rapa Nui").

Le sixième épisode, intitulé en version française "Le Piège", permet quant à lui de retrouver l'acteur Burt Young ("Tueur d'élite", "Le Convoi", "Le Pape de Greenwich Village"), le mythique acteur de la saga "Rocky", bien connu pour son rôle de Paulie Pennino, dans un rôle de loser qui lui va à merveille...

Avec "Un week-end à la campagne", on s'éloigne quelque peu en revanche du concept original de la série, puisque cette fois notre héros va se retrouver directement concerné par l'action, car son fils, qu'on aura le plaisir de retrouver (puisqu'il n'était jusque-là que dans l'épisode pilote!) et lui, vont se retrouver à devoir se défendre bien malgré eux contre l'attaque de trois individus voulant faire taire une jeune femme qu'ils vont croiser lors d'un petit week-end à la campagne... Un épisode en tout cas haletant où l'on croisera notamment dans un petit rôle de docteur, l'acteur Ed O'Neill ("Wayne's World", "La prisonnière espagnole", "Bone Collector", "Modern Family") bien connu pour son rôle d'Al Bundy dans la série "Mariés, deux enfants"...

L'épisode suivant, "Carla" va directement ramener McCall dans son passé, puisque cette fois il va devoir protéger son ancien amour avec la complicité de son concurrent direct, lui aussi ancien amoureux de la dame et chargé malheureusement de l'éliminer. Du coup, ce dernier va charger notre héros de contrecarrer ses propres plans tout en laissant croire à ses commanditaires qu'il n'était pas au courant... Un bon épisode encore où l'on notera la présence notamment de Saul Rubinek ("Le Bûcher des vanités", "Impitoyable", "True Romance", "Warehouse 13").

S'en suit "Le Fils modèle", un épisode de bonne facture également dans lequel notre héros va ressouder les liens d’une famille désunie en aidant un fils de bonne famille tombé dans le trafic de drogue. Quelques têtes connues dans cet épisode également et tout particulièrement Christine Baranski ("Birdcage", "Le Grinch", "Chicago", "Mamma Mia!") et dans un petit rôle de voyou, Billy Wirth ("Génération perdue", "Les contes de la crypte", "Body Snatchers, l'invasion continue") que j'avais beaucoup aimé à la fin des années 80 dans l'excellent "War Party" de Franc Roddam avec Kevin Dillon, un film qui mériterait vraiment de ressortir un jour en DVD...

Dans "Embuscade", Robert McCall va être confronté cette fois à un justicier ; un épisode également sympa, mais où finalement le personnage du justicier ne semble pas suffisamment exploité. Un peu dommage, mais l'épisode présente toutefois d'autres qualités! On aura notamment le plaisir de retrouver l'acteur Keith Szarabajka ("Un monde parfait", "The Dark Knight: Le chevalier noir", "Argo") dans le rôle de Mickey Kostmayer, venant ici pour la deuxième fois prêter main forte à notre héros et dont le personnage deviendra récurrent par la suite dans la série, ce qui est ma foi plutôt une bonne chose, car son personnage est assez attachant. Dans cet épisode, on notera enfin la présence anecdotique, mais toujours remarquée du rocker Meat Loaf ("The Rocky Horror Picture Show", "Wayne's World", "Fight Club")...

Enfin, on finit cette première partie de la première saison avec "Par désœuvrement", un épisode assez intéressant, montrant un Robert McCall souffrant d'une bonne crève, ce qui rend le personnage évidemment plus humain et dans lequel il va se confronter à un tueur professionnel aux goûts assez particuliers... Et c'est Blanche Baker ("Seize bougies pour Sam", "Blue-Jean Cop", "The Girl Next Door") qui va ici faire les frais de ce tueur détraqué excellemment interprété par Ray Sharkey ("La taverne de l'enfer", "Sans pitié", "Un flic dans la mafia"), un acteur malheureusement disparu bien trop jeune puisqu'il décéda à l'âge de 40 ans et qui connut un destin assez tragique puisqu'il tomba dans la drogue et attrapa le virus du SIDA en raison d'une aiguille contaminée...

Un très bon début de série en tout cas qui donne immédiatement envie de voir la suite!


Ce volume 1 de la première saison de la série "The Equalizer" est sorti le 22 octobre 2014 chez Elephant Films, mais un coffret de l’intégrale de la série est annoncé pour le 5 octobre 2016. Ce premier coffret présente une image au format 1.33:1 4/3 avec pistes audio française et anglaise Dolby digital 2.0 et sous-titres français sur la vo. Par contre, seules quelques bandes annonces d’autres séries éditées par l’éditeur sont proposées en guise de bonus.

12.08.16
Titre du film : Frankenstein
Réalisateur : Bernard Rose
Année : 2016
Origine : Etats-Unis
Durée : 1h30
Avec : Xavier Samuel (le monstre), Carrie-Ann Moss (Elizabeth), Danny Huston (Victor), Tony Todd (Eddie), etc.
Par Nicofeel

Frankenstein a été présenté lors de différents festivals (Gérardmer, Neuchâtel, Bruxelles). C'est à Bernard Rose que l'on doit des films singuliers tels que Paperhouse (1988) et bien évidemment le célèbre Candyman (1992). Le voir aux commandes d'une version actualisée de Frankenstein est donc plutôt une bonne nouvelle.
En effet, il paraît primordial d'avoir un réalisateur doté d'idées très personnelles pour monter un projet sur un mythe ayant fait l'objet de moults adaptations : que ce soit la version humaniste de James Whale (1931), la version érotico-gore de Paul Morissey (Chair pour Frankenstein), les versions gothiques de la Hammer ou encore la version assez gore de Kenneth Branagh, Frankenstein est sans conteste une des histoires de monstres les plus populaires.
Dès lors, on se demande bien ce que pourra apporter la version de Bernard Rose. Avec toute l'affection qu'il a pour les exclus de la société, le cinéaste britannique a eu la bonne idée de se rapprocher de la version de James Whale, en la transposant à notre époque actuelle.
Et ce réalisateur a changé de manière intelligente plusieurs données du mythe. Cette fois-ci, le monstre de Frankenstein n'est pas créé à l'aide de membres de différents morts. Non, cette fois-ci c'est l'avancée de la science qui a permis sa création.
A cet effet, tout au long de son film, Bernard Rose n'aura de cesse de s'interroger sur le lien entre le créateur et sa créature, à l'instar de Blade Runner. A la base, pour les croyants, c'est Dieu qui a créé les hommes. Si des chercheurs s'arrogent ce droit, c'est toute la chaîne de la nature qui est remise en cause. Bernard Rose fustige une science qui va loin dans ses expériences, dont les résultats peuvent s'avérer dangereux. C'est bien l'homme qui a créé ce monstre.

Pour autant, il ne faut pas s'y tromper. Si la star du film est le fameux « monstre » de Frankenstein, le véritable monstre c'est bien la société humaine. Ce que nous expliquait déjà jadis James Whale dans sa sublime adaptation de la nouvelle de Mary Shelley (1797 – 1851). Une société qui n'accepte pas ce qu'elle ne connaît pas. L'étranger est au cœur du film, puisque cet être non humain est pourchassé par autrui. Les meurtres qu'il commet ne sont qu'un processus d'auto-défense pour cette créature sans cesse rejetée par le monde qui l'entoure. Ses représailles sont violentes, mais sont finalement à l'image des attaques ou des rejets en règle des humains qu'il ne cesse de subir.
L'un des apports fondamentaux de cette version de Bernard Rose est d'avoir doté le monstre de l'intelligence d'un enfant, comme s'il venait tout juste de naître. L'idée est intéressante, puisqu'elle permet d'expliquer les réactions du monstre. Et puis, pour apporter une empathie envers notre « anti-héros », Bernard Rose a inclus une voix off, qui n'est autre que la réflexion du « monstre ». Le spectateur comprend alors ce qu'il ressent et quelles sont ses envies, ses déceptions. Le monstre, tel qu'il se décrit lui-même, a conscience de sa laideur extérieure et du fait qu'il n'est pas le bienvenu dans cette société. Plus que jamais, il s'interroge sur ses origines. « Qui suis-je ? » demande-t-il à plusieurs reprises.
Avant d'obtenir l'explication qu'il souhaite, ce monstre va connaître un parcours douloureux, qui s'apparente clairement à un chemin de croix. D'ailleurs, la parenté avec le Christ paraît évidente, puisque, comme lui, il finit par ressusciter et comme lui, il va avoir un destin funeste. Et puis, de la même façon que le Christ, le monstre de Frankenstein trouve comme amis (ses seuls) des exclus de la société, des laissés-pour-compte. En trouvant du réconfort auprès d'un clochard aveugle (joué par Tony Todd, l'interprète de Candyman) ou en fréquentant une prostituée, le monstre exprime tout l'intérêt que le réalisateur a pour ces gens, considérés par certains comme de véritables parias.
A l'instar de Paperhouse ou Candyman, Frankenstein contient plusieurs scènes oniriques, fort réussies, qui sont tout bonnement la matérialisation des rêves du monstre. Preuve que cet être n'est pas seulement la création de savants fous. Il est bien doté d'une âme. Sinon, il ne pourrait pas rêver.
Xavier Samuel interprète d'ailleurs avec beaucoup d'émotion le rôle du monstre, demeurant presque aussi marquant que jadis Bela Lugosi. Il exprime parfaitement la souffrance d'un être rejeté. On appréciera également de retrouver l'actrice Carrie-Ann Moss, dans le rôle de la « mère » du monstre. Elle fait preuve elle aussi de beaucoup de sensibilité au niveau de son jeu.
Peu de défauts sont notables dans cette œuvre. Tout au plus on pourra reprocher à Bernard Rose des références trop appuyées au mythe original, avec par exemple l'utilisation des mêmes noms que la nouvelle de Mary Shelley. Il n'était pas franchement nécessaire que le créateur s'appelle Victor Frankenstein. A l'image du titre du film, le spectateur aurait pu faire aisément le lien.
Heureusement, ces menus défauts n'annihilent pas le plaisir à voir ce long métrage qui aurait mérité amplement une sortie en salles par les circuits traditionnels.

| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Le Blog des DVDpasChériens
Les dvdpascheriens ayant la fibre journalistique peuvent participer à ce blog. Sur le thème des DVD, de la HD et de la vente en ligne. On y trouve des critiques, des dossiers, des articles sur les nouveautés ...
Rechercher
Cat�gories
- Toutes
- Box office cinéma (50)
- Dossier (34)
- Interview (42)
- Nouveautés (615)
- Point de vue (11)
- Test / Critique (1511)
- Test de commande (10)
- Top 10 (31)
Archives
- Janvier 2017 (1)
- Novembre 2016 (3)
- Octobre 2016 (3)
- Septembre 2016 (5)
- Ao�t 2016 (7)
- Juillet 2016 (3)
- Juin 2016 (4)
- Mai 2016 (6)
- Avril 2016 (3)
- Mars 2016 (4)
- F�vrier 2016 (7)
- Janvier 2016 (12)
- Suite...
Qui est en ligne?
- Visiteurs: 22
Divers
 Flux XML
Flux XML
- RSS 0.92: Articles, Commentaires
- RSS 1.0: Articles, Commentaires
- RSS 2.0: Articles, Commentaires
- ATOM 1.0: Articles, Commentaires




