Le Blog des DVDpasChériens
Archives pour: Mars 2011
31.03.11
Titre du film : Jimmy Rivière
Réalisateur : Teddy Lussi-Modeste
Durée du film : 1h30
Date de sortie au cinéma : 9 mars 2011
Avec : Guillaume Gouix (Jimmy Rivière), Béatrice Dalle (Gina), Hafsia Herzi (Sonia), Serge Riaboukine (José), etc.
Par Nicofeel

Réalisé par Teddy Lussi-Modeste, Jimmy Rivière est un film qui s'intéresse aux gens du voyage, dont fait d'ailleurs partie le cinéaste.
Lors de l'une des premières scènes du film, on assiste au baptême de Jimmy Rivière, le personnage principal du film. Il s'agit d'un baptême déclaré chrétien mais il faut noter que la mouvance religieuse dont il est question dans le film correspond précisément au pentecôtisme.
Dans la communauté gitane, le pentecôtisme est très présent. Le pentecôtisme est un mouvement religieux fondamentaliste assimilé au protestantisme. Ses adeptes prônent le baptême par le Saint-Esprit et la guérison par la prière.
Le film est une sorte de tranche de vie, avec ce Jimmy Rivière qui fait partie de la communauté gitane mais qui ne sait pas trop bien quel sens donner à sa vie : continuer à être fidèle à sa communauté, comme il vient de le faire en se faisant baptiser ou se remettre à la boxe, sa passion dans le monde des gadjé, ceux qui ne sont pas des tsiganes.
Porté par un excellent Guillaume Gouix (vu notamment dans plusieurs téléfilms) qui interprète brillamment le rôle de Jimmy Rivière, le film joue sur beaucoup d'oppositions : Jimmy Rivière cherche une certaine sérénité alors qu'il est prêt à exploser à tout moment ; il apprécie sa communauté mais il fréquente une gadji ; il déclare qu'il se sent un homme nouveau en étant devenu un chrétien mais il oublie bien vite les préceptes qu'on lui a enseignés en la matière ; il aime les gens avec qui il est proche mais il ne sait pas toujours comment leur dire qu'il les aime.

Fiction qui est parfois proche du documentaire par sa capacité à décrire avec une belle minutie l'esprit de la communauté du voyage, Jimmy Rivière n'en reste pas moins un film très réussi aussi bien dans sa mise en scène (beaucoup de scènes amples et dynamiques) que dans les rapports humains qu'il établis. Certaines scènes sont particulièrement marquantes : il y a d'abord une des premières scènes où Jimmy Rivière se fait baptiser dans l'eau et où tout le monde est à ses côtés, prouvant ainsi la solidarité de la communauté gitane ; il y a ensuite cette très belle scène où Jimmy et sa sœur sont quasiment côte à côte et où cette dernière se confie à lui pour lui dire qu'elle vit avec un homme qu'elle n'aime pas mais qu'elle le fait car on ne peut pas vivre avec un gadjo dans la communauté tsigane ; il y a enfin cette très belle scène où Jimmy est filmé en contre-jour et où il apparaît illuminé comme s'il en venait à être jugé pour le jugement dernier par le pasteur de la communauté, José. Ce dernier est interprété par un excellent Serge Riaboukine, ô combien crédible dans le rôle de ce pasteur au passé trouble qui fait la pluie et le beau temps dans la communauté et qui n'hésite pas à faire jouer de ses relations pour obtenir des terrains où installer les siens.
On voit donc bien que le casting du film est de qualité et permet d'autant plus facilement de se fondre dans cette communauté gitane qui est extrêmement chaleureuse mais n'accepte pas de recueillir des étrangers. C'est ainsi que dans ce film placé sous le signe du destin, Jimmy Rivière doit faire de nombreux choix : la boxe ou la religion ; sa copine gadji ou une femme de sa communauté ; quelle est la place de sa famille dans cet univers ? Autant de questions qui se posent à Jimmy et qui expliquent sans doute pourquoi le principal protagoniste du film est parfois particulièrement peu prolixe.
Film qui joue beaucoup sur les relations humaines qui sont parfois tout en douceur, presque portés par la grâce (voir les déclarations de Jimmy quand il croit vraiment à la religion), ou au contraire assez violentes (les combats de boxe, les relations sexuelles presque bestiales entre Jimmy et sa copine, interprétée par une Hafsia Herzi qui se montre très volontaire dans le film) , Jimmy Rivière est un beau film. S'il n'apporte pas franchement de réponse quant au lien entre les gitans et les gadjé, comme on peut le constater avec sa fin assez ouverte, il n'en reste pas moins un film original sur une communauté qui n'est pas forcément très connue, mis à part les clichés ou les archétypes répandus dans notre société. Teddy Lussi-Modeste est donc un cinéaste à suivre de près.

30.03.11
Titre du film : Parents
Réalisateur : Bob Balaban
Durée du film : 1h21
Date de sortie au cinéma : 1989 (film inédit en DVD)
Avec : Randy Quaid (Nick Laemle, le père), Mary Beth Hurt (Lily Laemle, la mère), Bryan Madorsky (Michael), etc.

Réalisé par Bob Balaban à la fin des années 80, Parents se déroule dans les années 50. La famille Laemle composée d'un couple, Nick et Lily, et de leur enfant Michael âgé d'une dizaine d'année, vient juste de s'installer dans un beau pavillon où toutes les maisons se ressemblent et où la vie des gens semble paisible.
Comme on peut s'en douter, le cinéaste va s'attacher à montrer que tout ceci n'est qu'une apparence. Les tous premiers plans du film sont d'ailleurs particulièrement évocateurs : on commence par la bouche d'un enfant puis on se focalise sur son regard. Le réalisateur nous met sur une piste : le référent du film va être le jeune Michael.
Quand on a une dizaine d'années comme Michael, on se pose beaucoup de questions et on est parfois en proie à des peurs enfantines.
Le film Parents a ceci d'original qu'il adopte le point de vue de l'enfant. La mise en scène se marie d'ailleurs parfaitement avec ce choix. Le réalisateur agrémente ainsi son film de nombreux plans filmés en grand angle. Bob Balaban insiste ainsi sur les perspectives, pour mieux marquer la différence de taille entre les personnages du film et notamment entre le gamin et ses parents. Le metteur en scène place aussi parfois sa caméra au sol pour filmer les pas des gens.
Pour conférer une ambiance particulière à son film, le cinéaste ne s'arrête pas là. Il se plaît à jouer sur des opposés : en surface, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes avec ces maisons bourgeoises des années 50 qui sont très bien entretenues. Quant aux familles, elles fleurent bon le bonheur. Que demander de plus ? Les gens ont tous une voiture, de beaux habits (le film est volontairement rétro) et bénéficient des avancées technologiques qui leur simplifient la vie de tous les jours. Oui mais voilà tout ceci n'est qu'un voile, une apparence.
On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Sauf que dans le cas présent, Michael est un jeune enfant taciturne ! Cela ne l'empêche pas de se poser beaucoup de questions quant aux mœurs de ses parents. Il s'étonne de devoir manger tout le temps de la viande, du déjeuner jusqu'au dîner. Il soupçonne de plus en plus ses parents de s'adonner à des pratiques bien étranges. Et il faut dire que certains indices ne laissent aucun doute, notamment lorsque l'assistance sociale est tuée et que l'on assiste à la scène suivante à un barbecue.
Dans Parents, on comprend assez rapidement que le cannibalisme est la thématique centrale du film. Dès lors, il n'est pas étonnant que Michael soit particulièrement perturbé dans sa famille. Non seulement il est choqué d'avoir surpris ses parents en train de faire l'amour, mais surtout il a du mal à s'adapter au mode de vie de ses parents. C'est ainsi que le film est émaillé de plusieurs scènes de cauchemars. Ce côté onirique où le sens du macabre est bien mis en valeur permet une fois de plus d'adopter le point de vue de l'enfant. On assiste à une première scène cauchemardesque où Michael se noie dans un océan de sang. Une autre fois, Michael voit en en couleurs puis en noir et blanc une main ensanglantée dans l'évier de la cuisine mais aussi du sang qui apparaît sur le réfrigérateur. On comprend aisément que tous ces rêves sont symptomatiques des soupçons qu'il a contre ses parents. Cet enfant est terrorisé par ce qu'il croit comprendre autour de lui. Dans la dernière partie du film, les scènes d'horreur, jusque-là suggérées, vont devenir explicites, comme pour rappeler que tout ceci n'est pas qu'un mauvais rêve.
Pendant plus d'une heure vingt, Bob Balaban aura baladé son spectateur dans un univers oppressant. Si l'humour noir du film est omniprésent et contribue à faire retomber la pression, il n'empêche que Parents joue beaucoup sur la notion de peur. La maison de la famille Laemle a beau être jolie, il n'empêche qu'à l'intérieur on s'adonne à des pratiques pour le moins spéciales. Bob Balaban distille une ambiance étrange avec des scènes qui évoquent le cannibalisme mais ne font que le suggérer. C'est une manière astucieuse de délivrer un message fort contre cette american way of life qui a été si longtemps montrée en exemple. De la même manière qu'un Brian Yuzna avec Society ou qu'un Paul Bartel avec Eating Raoul, Bob Balaban renvoie l'Amérique bien pensante et bien proprette à ses chères études.
En plus d'une interprétation sans faille de ses acteurs principaux, et notamment du gamin qui est vraiment parfait dans son rôle, Parents peut se targuer d'une excellente bande son signée Angelo Badalamenti, le compositeur attitrée des BO de David Lynch, qui signe ici des morceaux qui sont tout à la fois enjoués et dérangeants. La bande son est à l'image du film : à la fois décontractée et amusante (le film joue clairement sur le côté humour noir) et à la fois stressante.
Le réalisateur Bob Balaban livre en somme un film atypique, loin des canons habituels des films d'horreur. La réussite de Parents est donc d'autant plus mérité. Si le film est sans concession, comme le prouve le final qui laisse à penser que Michael est recueilli par des gens semblables à ses parents, Bob Balaban rappelle à juste titre que tout ceci ne reste qu'une fiction, en présentant ses différents acteurs sous la forme de vignettes rétro.

29.03.11
Titre du film : Incendies
Réalisateur : Denis Villeneuve
Durée du film : 2h03
Date de sortie au cinéma : 12 janvier 2011
Avec : Lubna Azabal (Nawal), Mélissa Désormeaux-Poulin (Jeanne Marwan), Maxim Gaudette (Simon Marwan), etc.
Par Nicofeel

Le canadien Denis Villeneuve s'était fait connaître en France par son film dramatique un 32 août sur Terre, lequel comportait toutefois de nombreuses séquences assez drôles. Dans Incendies, son nouveau film, il ne faut pas chercher de séquences humoristiques, il n'y en a aucune. Et pour cause. On est dans un pur drame et on ne sort jamais du genre.
Denis Villeneuve a fait un film très sérieux et à son crédit on peut noter que les thématiques de ce long métrage sont nombreuses : le deuil, les questions de l'origine, le fanatisme religieux, les relations familiales, la guerre civile.
Le cinéaste canadien fait preuve d'une grande ambition dans ce film et c'est d'autant plus à son honneur.
Adaptant la pièce de Wajdi Mouawad, Denis Villeneuve débute son film par un travelling arrière où l'on voit de de beaux paysages du Moyen-Orient puis des enfants qui se font raser le crâne. Cette scène est symbolique du film avec d'une part la beauté de la nature et d'autre part la façon dont l'homme pervertit l'environnement dans lequel il évolue, ici par la violence.
La suite immédiate du film met en scène plusieurs des protagonistes. Là encore, pas de quoi s'amuser puisque deux personnes, Jeanne et Simon, se rendent chez le notaire pour hériter de leur mère. Surtout, ce moment est l'occasion pour eux d'apprendre qu'ils auraient un frère et que leur père ne serait pas mort.

L'héritage étant conditionné à la recherche de ces personnes, Jeanne s'en va au Liban, où a résidé sa mère dans ses jeunes années.
Le film de Denis Villeneuve est intéressant car il va particulièrement évoquer la question des origines. Mais du coup le film n'est pas forcément facile d'accès. Car les flashbacks sont nombreux. On va passer un bon moment du récit à en apprendre sur cette mère que finalement Jeanne et Simon ne connaissent pas autant qu'ils le pensent.
C'est l'occasion aussi pour le cinéaste de traiter indirectement de l'histoire. On comprend assez bien que les événements qui nous sont proposés sont ceux du Liban, et notamment de la guerre civile qui a eu lieu en 1975. L'incendie du bus de Palestiniens (qui explique en partie le titre du film) évoque immanquablement les relations tendues entre le Liban et la Palestine. Cette scène est vraiment marquante car elle montre que des gens sont prêts à tuer en raison d'un fanatisme religieux. Le coup de l'enfant qui se fait tuer de sang froid en est vraiment impressionnant. Et puis l'image du bus qui est en train de brûler continue de trotter dans la tête du spectateur après le visionnage du film.
D'autres scènes sont également impressionnantes et sont révoltantes de notre point de vue d'occidental. Il y a ainsi le fait qu'en raison de nationalités différentes, des gens sont interdits de fréquenter d'autres personnes et sinon l'exclusion du groupe est à craindre. Les valeurs familiales sont différentes des nôtres.
Et puis le film est assez dur à regarder car il évoque sans ambages les difficultés qu'a rencontrées cette femme, Nawal, la mère de Jeanne et de Simon, qui a dû quitter sa famille, arrêter ses études, être emprisonnée et accepter en prison des choses inacceptables.
Le réalisateur Denis Villeneuve crée des ponts entre la petite et la grande histoire, à tel point qu'on a l'impression que ce qui se passe à l'écran a vraiment eu lieu. Par ailleurs, le cinéaste invite le spectateur à s'interroger sur la nature de la condition humaine. Car finalement c'est un monde abject, en pleine déroute, où l'on se permet des choses horribles sous le prétexte religieux, qui nous est conté.
Sur le plan historique et social, le film s'avère captivant. Ce n'est pas que sur ces plans que le film demeure attrayant. En effet, la question des origines des deux enfants prend quasiment la forme d'un jeu de pistes et va donner lieu à une révélation pour le moins déroutante, qui amène elle aussi à d'autres questions.
Au niveau de l'interprétation, tous les acteurs sont de qualité et permettent d'autant plus facilement une certaine identification. On est donc happé par cette histoire qui est très prenante.
Incendies est au final un film de qualité qui traite d'un grand nombre de sujets avec beaucoup d'à propos. Il n'en demeure pas moins un film assez dur à regarder car la vision du monde est plutôt désenchantée. A voir en connaissance de cause.

28.03.11
Titre du film : Fighter
Réalisateur : David O. Russell
Durée du film : 1h40
Date de sortie au cinéma : 9 mars 2011
Avec : Mark Wahlberg (Micky Ward), Christian Bale (Dicky Eklund), Amy Adams (Charlene Fleming), Melissa Leo (Alice Ward), Jack McGee (George Ward), etc.
Par Nicofeel

Depuis Million dollar baby (2004) de Clint Eastwood, on n'avait pas connu ça : un film sur la boxe qui nous émeut profondément.
Et pourtant c'est bel et bien le tour de force que vient de réussir le cinéaste David O. Russell, auteur jusque-là de films sympathiques mais qui étaient loin de casser la baraque (Les rois du désert ; J'adore Huckabees).
Avec Fighter, le réalisateur américain s'inspire de la vie de Micky Ward, boxeur légendaire qui, après une série importante de défaites, a connu une ascension majestueuse le menant jusqu'au titre de champion du monde en 2000. Pour autant, il ne faut pas s'y tromper : on n'est pas dans un Rocky. Les combats que l'on voit dans le film sont certes importants car ils sont très intenses.
Mais ce qui passionne David O. Russell c'est sans conteste tout le contexte familial. Ainsi, dans le film la clé des défaites et des victoires tient en particulier des relations qu'entretient Micky Ward avec sa famille. Cette dernière vit dans une ville pauvre des Etats-Unis, Lowell. Le frère aîné (de 7 ans) de Micky Ward, Dicky Ward fut à la fin des années 70 une star locale après avoir vaincu le boxeur Sugar Ray (1978) mais depuis il est tombé dans la consommation du crack et n'a jamais pu relancer sa carrière.
Au début du film, on le voit entraîner de façon très irrégulière (retards fréquents) son frère Micky dans une salle de sport minable. On comprend que Micky ait dès lors du mal à s'en sortir dans le milieu de la boxe. Surtout que sa mère, qui s'est autoproclamée comme étant son manager, lui trouve des combats complètement foireux contre des adversaires qui ont bien souvent un poids nettement supérieur à celui de Micky Ward, d'où des résultats catastrophiques.

Le film relate bien dans sa première partie cette série infernale de défaites où Micky se prend branlée sur branlée. Malgré cela, Micky continue de faire confiance à son frère Dicky et sa mère, véritable matriarche qui règne en maître sur ses 7 filles avec qui vit. Fighter établit bien la difficulté de Micky qui voit clairement qu'il n'y a pas d'espoir à continuer de la sorte et qui a cependant besoin de sa famille. Sa famille étouffe Micky Ward et l'empêche de progresser mais il en a besoin. Même quand il décidera de prendre de la distance avec sa famille, Micky Ward continuera d'être lié avec elle. Le lien qu'il a avec son frère Dicky est révélateur des liens qu'il a avec sa famille : bien que Dicky soit très différent de lui, il reste son grand frère, qui fut autrefois son idole. On comprend implicitement que c'est Dicky qui a donné envie à Micky de faire de la boxe. La relation entre ces deux frères est forte et le cinéaste David O. Russell l'exprime parfaitement par le biais d'une distribution de qualité.
Sans conteste, les acteurs du film s'en sortent à merveille. Mark Wahlberg est parfait en Micky Ward, boxeur qui cherche à faire évoluer sa carrière car il sait qu'il n'est plus très jeune et que son temps est compté. Mais c'est surtout Christian Bale, qui demeure inoubliable en Dicky Ward. Il a d'ailleurs obtenu cette année l'oscar du meilleur dans un second rôle. Et c'est complètement mérité au vu de sa performance. Christian Bale incarne réellement Dicky Ward, cet homme irresponsable qui fut jadis un boxeur brillant mais qui a depuis été aspiré par le monde de la drogue. Comme dans The machinist, l'acteur s'est d'ailleurs astreint à un régime des plus draconiens pour donner physiquement un aspect encore plus proche de la réalité. Avec ce personnage, Christian Bale réussit tout à la fois à faire rire le spectateur (voir les fois où il se jette de son immeuble pour atterrir dans les poubelles, afin d'éviter sa mère), à l'agacer par son côté cinglé et à l'émouvoir car au fond Dicky n'est pas un mauvais garçon mais un homme tourmenté (voir les séquences à la prison). David O. Russell, qui a décidé de coller au plus près de la réalité, a pris le parti de rappeler que la chaîne HBO a tourné en 1995 un documentaire sur Dicky Ward mais il ne s'agit pas, comme le croyait Dicky, d'un documentaire à sa gloire mais en fait d'un documentaire sur les méfaits du crack (« High on crack street : lost lives in Lowell »). Si Christian Bale crève l'écran dans ce film, il n'est pas le seul à surprendre. L'actrice Amy Adams, vue jusque-là dans des films gentillets tels que Sunshine cleaning et Une nuit au musée 2, est méconnaissable en barmaid particulièrement sexy. Elle joue bien le rôle de cette femme qui, à l'instar de Dicky Ward, n'a rien fait de sa vie, mais va pousser son petit ami Micky Ward à évoluer. Très juste dans son jeu d'actrice, elle aurait très bien pu obtenir un prix. Mais on ne peut malheureusement pas le donner à tout le monde. En l’occurrence, l'oscar de la meilleure actrice dans un second rôle est revenu cette année à Melissa Leo qui joue dans ce film en interprétant le rôle d'Alice Ward. Cette dernière est marquante en mère dominatrice qui entend faire ce qu'elle veut de ses enfants. Dans un style différent de celui de Dicky, elle est également à côté de la plaque avec ses tenues vulgaires qui lui donnent presque un air de prostituée et avec sa croyance qu'elle est un manager de boxe alors qu'elle n'y connaît rien !
Nanti ainsi d'un casting quatre étoiles, le film part sur de bonnes bases. Encore faut-il que la mise en scène suive. Et de ce côté-là, c'est aussi la satisfaction qui domine. Fighter débute astucieusement par une interview qui introduit en quelque sorte l'histoire. Et puis très logiquement il se termine justement par une autre interview (avec la bonne idée d'introduire lors du générique de fin les deux véritables frères, Micky Ward et Dicky Eklund). David O. Russell respecte bien l'histoire qu'il est en train de traiter, à savoir un biopic sur un boxeur célèbre. A plusieurs reprises, la coloration de l'image change, lui donnant un aspect proche du documentaire. C'est certainement une façon pour le réalisateur d'inscrire ses personnages dans l'Histoire. Et puis il faut dire que les combats n'en sont que plus réalistes. Ces combats de boxe sont bien filmés, en étant proches des personnages. On ressentirait presque les coups portés par les boxeurs. Le paroxysme des combats est atteint lors du dernier combat où Micky Ward se bat pour le titre de champion du monde. L'issue incertaine de ce combat (ce que relatent les commentateurs dont semble se moquer David O. Russell car ceux-ci laissent entendre lors de plusieurs combats que Micky Ward ne fait pas le poids avant de l'encenser comme si de rien n'était quand il gagne) rend la scène d'autant plus captivante.
Le film Fighter peut aussi se targuer d'une bande son de qualité qui s'avère extrêmement éclectique. On a de la musique pop des années 80 avec Dance hall days de Wang Chung, lequel est connu pour avoir composé la musique originale de l'excellent film Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. Mais on entend surtout du pur rock avec notamment le groupe mythique Led Zeppelin et leur titre Good times bad times ou encore les Rolling Stones avec Can't you hear me knocking. Des groupes comme les Red hot chili peppers avec Strip my mind et Aerosmith avec Back in the saddle apportent aussi leur pierre à l'édifice pour donner un côté punchy au film. Ce dernier se termine plus tranquillement, tout en émotion, avec du Ben Harper et un titre évocateur : Glory and consequence.
Au final, Fighter constitue un excellent film. Au-delà du fait qu'il s'agit d'un film sur la boxe, c'est une belle réflexion sur les relations humaines, avec des acteurs de grande qualité qui font passer des moments d'émotion. Bien plus fin qu'un Rocky, Fighter glorifie certes un personnage symbolique de l'Amérique triomphante, mais il le fait avec subtilité. Il montre qu'avec la volonté et l'envie, on peut parfois soulever des montagnes.

24.03.11
Titre du film : World invasion : battle Los Angeles
Réalisateur : Jonathan Liebesman
Durée du film : 1h56
Date de sortie au cinéma : 16 mars 2011
Avec : Aaron Eckhart (sergent Michael Nantz), Michelle Rodriguez (Sergent chef Elena Santos), etc.
Par Nicofeel

Décidément les films traitant d'invasions extraterrestres commencent à pulluler ces temps-ci. A la fin de l'année 2010, on a eu droit au catastrophique Skyline des frères Strause et au plus convaincant Monsters.
Cette fois-ci, nouveau film d'invasion extraterrestre tout simplement dénommé World invasion : battle Los Angeles. La mise en scène revient à Jonathan Liebesman, connu pour avoir réalisé une préquelle au film culte de Tobe Hooper Massacre à la tronçonneuse (Massacre à la tronçonneuse : le commencement).
Le cinéaste américain ne va malheureusement pas faire dans la finesse et livrer un film qui manque cruellement d'orriginalité. Le début du film qui nous présente un véritable chaos n'est déjà pas sans rappeler un certain Starship troopers, sauf qu'ici les créatures sont à combattre sur Terre.

Ensuite on a droit un petit flashback qui va présenter sommairement les différents personnages du film. Le principal personnage du film est le sergent Michael Nantz, qui est interprété par un Aaron Eckhart (Thank you for smoking, Le goût de la vie, The dark knight) convaincant dans l'ensemble. Michael Nantz traîne derrière lui un passé récent lourd à assumer. En effet, il a laissé en Iraq des marines qui ont laissé leur vie alors que lui est demeuré le seul survivant. On comprend aisément que le combat contre l'ennemi pour défendre Los Angeles devrait lui permettre de se racheter.
Avec Aaron Eckhart, l'un des rares acteurs connus dans ce film n'est autre que Michelle Rodriguez, vue récemment dans Machete. Ici, son rôle est beaucoup plus limité et se cantonne à celui d'un sergent chef qui va épauler les autres marines.
Et il faut dire que les marines ne sont pas de trop dans cette histoire car leurs adversaires sont particulièrement nombreux et coriaces. Arrivés par le biais de météorites, les extraterrestres disposent de protections particulièrement solides. Sans compter qu'ils ont des vaisseaux puissants et des drones sans pilotes.
Filmé caméra à l'épaule dans plusieurs de ses scènes pour donner un aspect réaliste, World invasion : Los Angeles comporte un nombre important d'images ce qui donne un aspect très « cut » à l'ensemble. Parfois les scènes sont quelque peu illisibles mais après tout le spectateur se trouve perdu comme ces marines. En tout état de cause, en multipliant les images, Jonathan Liebesman a cherché à instaurer un rythme effréné à son film. Sur ce point, il faut reconnaître que le film n'est pas spécialement ennuyeux.
Le problème est qu'une fois que le décor est planté, le film se résume à des séquences d'action. Alors effectivement les amateurs d'explosions en tous genres apprécieront les vaisseaux ennemis et les hélicoptères détruits, les bâtiments réduits en cendres. Sans compter sur le nombre important de morts des deux côtés. Mais tout cela est extrêmement redondant. C'est tout de même un peu long pour un film d'1h56. On aurait apprécié qu'à l'instar d'un Starship troopers, le film comporte une véritable réflexion politique ou une critique derrière tout cet amas de morts.
Au demeurant, si la violence est bien présente par un nombre important de morts, il n'y a aucune scène vraiment gore. Le film est bien gentillet sur ce point ce qui est dommage. Car la guerre est quelque chose de terrible et de moche. Le réalisateur, pourtant auteur d'un massacre à la tronçonneuse bien sanglant, est visiblement rentré dans le rang sur ce point pour livrer un produit formaté destiné au plus grand nombre.
Au final, World invasion : Los Angeles n'est pas aussi mauvais qu'un Skyline puisque cela reste un film qui se suit sans souci et n'est pas trop mal mis en scène. Mais ce long métrage comporte un scénario linéaire, digne d'un jeu vidéo, et les surprises ne sont de pas de sortie. En somme, voilà un film sans âme qui aurait pu être fait par n'importe qui. A voir, si vous souhaitez regarder sur grand écran un « actioner ». Pour les autres, autant rester chez vous.

22.03.11
Titre du film : Route irish
Réalisateur : Ken Loach
Durée du film : 1h49
Date de sortie du film : 16 mars 2011
Avec : Mark Womack (Fergus), Andrea Lowe (Rachel), John Bishop (Frankie), etc.
Par Nicofeel

Réalisé par Ken Loach (Sweet sixteen, It's a free world), chef de file du cinéma britannique, Route irish fait référence à une route extrêmement dangereuse à Bagdad en Irak qui va de l'aéroport à la zone internationale (la fameuse green zone).
Pour autant, il ne faut pas s'y tromper. Route irish ne constitue pas un énième film sur les militaires qui ont rejoint l'Irak. Ou en tout cas il ne s'agit pas de l'unique thématique du film. Non Ken Loach est beaucoup plus subtil que ça.
Le cinéaste nous signale d'abord un fait qui n'est pas vraiment connu du grand public, à savoir que dans le cadre de la guerre en Irak, de nombreuses personnes ont été recrutées en qualité de contractuelles (contractor) pour faire un travail qui s'apparente en tous points à celui des militaires. Sauf qu'au regard des salaires qui sont versées (le film indique la somme de 10 000 livres sterling mensuel) et des personnes qui sont recrutées, on a plus à faire à des mercenaires qu'à des militaires.
Le synopsis du film nous raconte que l'un de ces contractors, Frankie, vient de décéder sur la route irish. Le meilleur ami de ce contractor, Fergus, lui-même un ancien contractor, ne comprend pas comment son ami a pu décéder car son camarade a toujours bénéficier d'une bonne étoile. Il ne peut donc pas admettre que son ami se soit trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ("at the wrong place at the wrong time"). Il décide alors d'enquêter pour se rendre compte par lui-même si on ne lui aurait pas menti et si les nouvelles délivrées par des militaires sont bien vraies.

C'est à partir de ce scénario somme toute assez classique au départ - dans le sens où les films sur l'Irak commencent à être nombreux - que Ken Loach va livrer un film qui va jouer sur plusieurs registres : on est à la fois dans le drame avec la perte de Frankie ; dans le thriller avec la recherche du coupable par Fergus et dans la critique politico-économique par le manque de clarté des autorités officielles qui d'un côté cherchent à combattre des ennemis de la liberté en Irak et de l'autre font diverses tractations avec des sociétés privées pour signer des contrats en Irak.
Le film de Ken Loach est haletant de bout en bout avec ce mélange plutôt réussi des genres. Surtout qu'en filigranes le film apporte une réflexion intéressante sur la notion de vengeance. Fergus critique ce qui s'est passé en Irak avec son ami qui est décédé dans des circonstances inconnues et le fait qu'il ait appris que deux innocents ont été tués par un autre contractor. Mais les méthodes utilisées par Fergus pour en apprendre plus sur ce qui est arrivé à son ami sont-elles pour autant légitimes ? Même si on peut à un moment en douter, on voit bien que Ken Loach n'est absolument pas un fervent supporter de la loi du talion, quand on voit ce qu'il advient aux personnages principaux du film. Car se venger n'apporte rien en soi et surtout une vengeance aveugle peut comporter des erreurs.
Parfaitement bien mis en scène, Route irish comporte son lot de scènes de violence sèche (la torture par l'eau, la voiture qui explose) qui étonnent et surprennent et font surtout écho à cette violence renfermée du principal protagoniste qui utilise lui aussi des méthodes peu conventionnelles pour arriver à ses fins. Ces scènes vont dans la continuité d'autres scènes qui se révèlent assez surprenantes et marquent de vrais rebondissements dans l'action.
Sur ce point, Ken Loach ne manque pas de critiquer le contexte politico-économique qui semble tirer profit de la situation. Si tout n'est pas très clair car on ne saisit pas forcément les liens qu'il peut y avoir entre le gouvernement, les militaires, les sociétés privées britanniques, on voit bien qu'il y a des gens qui sans risques tirent les marrons du feu.
On appréciera aussi toute l'humanité que l'on retrouve dans le cinéma de Ken Loach avec ce plaidoyer en faveur du peuple irakien qui souffre et est in fine l'une des principales victimes "collatérale" de cette guerre larvée.
Les thématiques du film sont bien traitées. Et les acteurs sont également excellents, avec en premier lieu Mark Womack qui joue un Fergus déterminé des plus crédibles.
On regrettera simplement cette histoire d'amour entre Fergus et la femme de son meilleur ami, Frankie. Cela n'est pas très fin et pas forcément évident à croire. Car il demeure difficile de penser que peu de temps après avoir assisté à l'enterrement de Frankie, l'un et l'autre cherchent à être ensemble. Heureusement, Ken Loach apporte un peu de finesse à cette relation.
Au final, voilà un très bon film qui mélange habilement critique politique, drame humain et thriller. Voilà un bon cru pour ce dernier film signé Ken Loach.

18.03.11
Titre du film : Get crazy
Réalisateur : Allan Arkush
Durée du film : 1h31
Date de sortie au cinéma : 1983 (inédit en DVD)
Avec : Malcolm McDowell (Reggie Wanker), Daniel Stern (Neil Allen), Allen Garfield (Max Wolfe), Gail Edwards (Willy Lomen), Miles Chaplin (Sammy Fox), Ed Begley Jr (Colin Beverly), etc.
Par Nicofeel

Réalisé en 1983 par Allan Arkush, Get crazy est une comédie qui se déroule à la même époque à laquelle le film est tourné. En effet, dans la première partie du film, on voit des gens qui préparent dans un théâtre le spectacle qui va avoir lieu le soir pour fêter le nouvel an 1983.
Le début du film nous met directement dans l'ambiance complètement décontractée de Get crazy. Alors que l'on voit un énorme vaisseau qui fait penser au démarrage de Star Wars, il s'agit en fait d'un homme, Max Wolfe, qui est sur un faux vaisseau et qui répète avec son équipe.
Max Wolfe est le propriétaire du Saturn, un théâtre qui chaque année fête le nouvel an avec de grandes stars de la chanson.
Le Saturn étant très bien placé, il est l'objet de convoitises, et notamment de « méchants » menés par le ridicule Colin Beverly dont la mine faussement patibulaire amuse plus qu'autre chose, mais c'est sans aucun doute voulu par le cinéaste.
Beverly tente de négocier avec le neveu de Max Wolfe, le jeune Sammy, qui est un poltron et un homme malhonnête qui ne manque pourtant pas d'ambition. Ce dernier est prêt à tout faire pour vendre à Beverly le théâtre.
Le scénario du film est plutôt sympathique dans l'ensemble mais c'est surtout son traitement qui va rendre ce long métrage fort attachant.
D'abord, il y a un second degré toujours assumé dans ce film qui fait plaisir à voir. Le réalisateur comme ses acteurs ne se prennent jamais au sérieux. Ce qui donne lieu à de nombreuses scènes savoureuses. Il y a par exemple ces moments où le régisseur du théâtre, Neil, tombe immédiatement amoureux de la belle Willy. On a droit alors à des scènes de rêve de Neil qui s'imagine en train d'embrasser la belle sous les projecteurs de la scène. Histoire d'en faire des tonnes, le cinéaste Allan Arkush utilise des ralentis ce qui accroît le côté kitsch de la scène. Dans une autre scène, Neil se voit en Tarzan avec un singe sur le bras et imagine Willy telle une Jane !
Dans ce film, tout prête à rire. Les méchants arrivent en hélicoptère en pleine ville et stationnent juste à côté du théâtre, déshabillant alors les jeunes femmes qui sont autour par le tournoiement des hélices de l'hélicoptère.

On a aussi des gags plus basiques avec par exemple Sammy qui fait valdinguer un chien ou encore les gens qui sautent du balcon du théâtre dans le public qui se voient attribuer une note comme s'ils faisaient des figures acrobatiques en sport.
Jamais prévisible dans ses divers gags, Get crazy (chanson que l'on entend dans le film) est un long métrage mené tambour battant, au rythme de sa musique et qui part dans tous les sens.
Il souffle un vrai vent de liberté dans ce film qui ferait presque penser à une production Troma par son côté délirant.
La deuxième partie du film est peut-être un peu plus cadrée – encore que - car les artistes vont se mettre à chanter. Cela commence avec le roi du blues, sobrement appelé King blues. Ce dernier ouvre les hostilités avec un batteur improvisé ! C'est ça le côté fun du film tout semble justement improvisé. La suite n'est pas mal non plus avec un groupe de filles bien énervées - avec sa chanteuse qui s'appelle Nada - qui bougent dans tous les sens et pratiquent un rock bien viril ! Le clou du spectacle a lieu après avec le chanteur Reggie Wanker, sorte de mélange entre David Bowie et Iggie Pop, qui est interprété par l'acteur le plus connu du film, à savoir Andie McDowell. Ce dernier se sent comme un poisson dans l'eau dans le film et il se marie bien à l'humour de celui-ci. Il chante réellement la chanson Hot shot qu'il interprète. Il se met à moitié à poil sur scène puis, alors qu'il paraît à moitié crevé, il fait l'amour en coulisses à des filles à poil qui sont en furie se jettent autour de lui. Après voir bu de l'eau transformée, il se met à parler à son sexe !
En plus de ses scènes hilarantes, le film vaut également par des dialogues dignes des meilleurs nanars : « On ne peut pas vous baiser c'est vous qui baisez tout le monde ! » (Sammy à Colin Beverly) ; « Si j'avais été ta mère je t'aurais étranglé au berceau » (Max Wolfe à Colin Beverly) ; « l'heure est venue de parler de la plus belle chose au monde : le pognon » (Colin Beverly).
Se déroulant dans une ambiance des plus décontractées – comme le prouve la présence de hippies qui se croient encore en 1969 – Get crazy est une comédie des plus plaisantes à regarder. Voilà une excellente découverte qui mériterait d'être éditée en DVD zone 2.

17.03.11
Titre du film : Winter's bone
Réalisatrice : Debra Granik
Durée du film : 1h40
Date de sortie au cinéma : 2 mars 2011
Avec : Jennifer Lawrence (Ree Dolly), John Hawkes (Teardrop), Lauren Sweetser (Gail), Thump Milton (Ronnie Hall), etc.
Par Nicofeel

Présenté au festival de Sundance en 2010 où il a obtenu le prix du jury et le prix du meilleur scénario, Winter's bone constitue le deuxième long métrage de Debra Granik. Ce film est l'adaptation du roman éponyme de Daniel Woodrell.
L'action du film se déroule dans le Missouri, en pleine nature. On voit dès le début que c'est l'extrême misère qui prévaut. Une jeune fille de 17 ans, Ree Dolly (Jennifer Lawrence) s'occupe de son frère de 12 ans, de sa sœur de 6 ans et de sa mère qui est malade sur le plan psychologique, et ce dans des conditions pour le moins précaires. Ree Dolly n'a quasiment rien à donner à manger à sa famille. Elle doit faire avec la bonté de sa voisine et se retrouve à manger au quotidien des choses qui ne vont pas forcément à des enfants ou à des adolescents. Ainsi, au petit déjeuner, elle donne à son frère et à sa soeur de la biche et des pommes de terre. Plus tard dans le film, on pourra constater que la faim est telle que Ree en est réduite à tuer de pauvres petits écureuils pour ensuite les manger. Ce propos introductif met dans l'ambiance du film mais cela n'est pas là le pire.
L'essentiel reste que la famille Ree est menacée d'expropriation. Le père de la famille, Jessup, qui trempe dans des trafics de méthadone, a fait de la prison et a mis sa maison en caution. Sauf que s'il ne vient pas au tribunal, la maison des Ree sera saisie. Dès lors, l'interrogation est de retrouver le père et de l'inviter à aller au tribunal. Le film va consister pendant une grande partie à toute une recherche de la part de Ree qui, armée d'un grand courage, malgré son jeune âge, va tout faire pour retrouver son père. Elle décide d'aller voir son oncle avec qui elle n'entretient pas des rapports très cordiaux. Et puis surtout elle n'hésite pas à aller voir une famille avec les rapports sont tendus et qui pourrait savoir où se cache le père.

Au fur et à mesure que la quête de Ree avance, on comprend que le père a été tué. Mais dans ce cas, encore faut-il le prouver pour la justice et éviter ainsi la saisie de la maison. La dépouille (d'où le titre du film) est donc nécessaire. Véritable drame mâtiné de chronique sociale – par cette description d'un univers où les gens sont particulièrement pauvres – le film frappe par le portrait des gens qui vivent dans le Missouri, dans des coins perdus des Etats-Unis. Dans ces lieux, on est loin des Etats-Unis triomphants. Ici, même si la loi est connue de tous, les gens font un peu ce qu'ils veulent. On croise ainsi des alcooliques, des drogués (Teardrop le frère de Jessup), et puis surtout des vendeurs de drogues et autres substances illicites. Tout le monde a l'air de trouver cela normal, y compris les femmes qui acceptent cette situation et ne s'étonnent pas de ces trafics. Sans compter que le film laisse entendre qu'il y a eu des relations entre plusieurs membres de famille avec manifestement des gens à la limite de la consanguinité. On est dans une Amérique où les rednecks, qui écoutent de la musique country, sont omniprésents.
Seule Ree, qui représente le point de vue du réalisateur, et probablement par extension celui des spectateurs, est bien déterminée à ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est la raison pour laquelle elle est passée à tabac – par des femmes – et qu'elle s'attire des problèmes. L'actrice Jennifer Lawrence, âgée actuellement de seulement 19 ans, étonne par la justesse de son interprétation. Elle est d'un incroyable naturel et ses faits et gestes sont parfaitement crédibles. Elle donne une vraie profondeur à son personnage, lequel est déterminée à sauver sa famille d'une expropriation.
C'est d'ailleurs ce qui donne un intérêt supplémentaire à ce film. On voit bien que Ree est liée de façon étroite à sa famille, ne pensant qu'à la sauver coûte que coûte. Quitte même à rentrer dans l'armée s'il le faut !
L'acteur John Hawkes dans le rôle de Tedrop, l'oncle de Ree, est également à signaler pour l'excellence de sa prestation. En effet, son interprétation est très subtile. Au départ il joue un personnage assez détestable mais au final il est beaucoup plus nuancé que prévu. On comprend qu'il ne fait pas ce qu'il veut et pourtant, malgré l'opposition auquelle il doit faire face, il va être d'un secours déterminant pour Ree.
Le scénario et les acteurs sont à signaler dans ce film. Ils contribuent à la réussite de ce dernier. Mais il y a aussi la photographie avec ce choix de montrer une image constamment grisâtre, ce qui a pour effet de rendre encore plus visible la pauvreté qui sévit dans ces lieux du Missouri. On a aussi une incroyable impression de réalisme.
Film extrêmement noir, Winter's bone est un film crépusculaire (à l'image de cette scène où Ree passe dans une barque pour retrouver son père, comme si à l'image de Charon elle passait dans le royaume des morts) où l'être humain n'est pas vu sous son meilleur jour. Cela n'en reste pas moins un très bon drame, qui ne vire jamais dans le pathos. A voir.

16.03.11
Titre du film : Paul
Réalisateur : Greg Mottola
Durée du film : 1h42
Date de sortie du film : 2 mars 2011
Avec : Simon Pegg (Graeme Willy), Nick Frost (Clive Gollings), Jason Bateman (Agent spécial Lorenzo), Sigourney Weaver (le grand Manitou), Kristen Wiig (Ruth Buggs), Blythe Danner (Tara Walton, adulte), Steven Spielberg (lui-même), Paul (Seth Rogen, la voix), etc.
Par Nicofeel
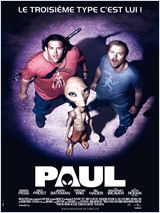
Avec le film Paul, les deux compères Simon Pegg et Nick Frost se retrouvent à nouveau dans une comédie, après l'excellent Shaun of the dead et Hot fuzz. Si le réalisateur aux manettes pour diriger notre duo de comiques n'est plus Edgar Wright, on ne perd pas forcément au change côté délire avec Greg Mottola (auteur du peu subtil mais extrêmement sympathique Supergrave en 2007).
Pour autant, si le réalisateur et les deux acteurs principaux sont connus, dans ce film c'est pourtant un autre trublion qui va leur voler la vedette : le fameux Paul ! Le personnage qui donne son nom au titre du film est un extraterrestre animé par le biais d'images de synthèse. Cela n'empêche pas que Paul donne vraiment l'impression d'être réel et que l'on prenne plaisir à suivre ses aventures. Car si Paul est un extraterrestre, il n'est absolument pas comme on l'imagine. Il n'est ni un être gentil prisé par les enfants à la manière d'E.T. (film qui est cité on ne peut plus clairement au début du film) ni un être belliqueux. En fait, Paul agit comme n'importe quel être humain. Entre autres choses il fume, il boit de l'alcool et il prend du temps pour dormir.
De plus, n'hésitant pas à raconter des bêtises, il apprécie le fait de parler en toute liberté de sexe (c'est là sans nul doute la touche Greg Mottola) : « tout le monde est bi sur ma planète. » Dans le même ordre d'idée, il s'amuse à mimer le fait que ses deux camarades humains seraient gay. Et puis il évoque à plusieurs reprises ses boules cosmiques, également appelées bijoux galactiques.

Tout cela est très bien mais quel est au juste le scénario de ce film. Deux anglais, Graeme Willy et Clive Gollings, amis d'enfance (qui se sont d'ailleurs délivrés des petits surnoms affectueux : titounet pour , se trouvent être de véritables geek passionnés par la science-fiction et la bande dessinée. Ils ont ainsi décidé d'aller à un festival dans le Nevada (clin d'oeil à Roswell), là où seraient apparus des extraterrestres. C'est en rentrant de ce festival, en traversant la zone 51 qu'ils tombent nez à nez avec un extraterrestre prénommé Paul. Ce dernier est recherché par les services secrets américains qui effectuent des tests sur lui. Le film va alors consister en un road-movie dont le but final est de permettre à Paul de rejoindre sa planète.
Avant d'en arriver là, nos trois compères vont connaître des aventures pour le moins mouvementées. Ce groupe des 3 va au demeurant passer à 4 membres avec une jeune femme catholique très cadrée qui va apprendre à se libérer et à être moins rigide dans son mode de pensée.
C'est d'ailleurs là une des grandes thématiques du film : la liberté. Paul a beau être différent des autres, il se comporte comme tout un chacun et surtout prône le fait d'être libre dans ses choix, de ne connaître aucune entrave.
Le film dispose avant tout d'un ton humoristique vraiment très drôle ainsi que l'on peut le remarquer par : les nombreuses références au cinéma avec par exemple cette séquence où Paul a au bout du film Steven Spielberg ; cette scène où Paul redonne la vie à un petit oiseau mort afin de pouvoir le manger tout cru !
Ce long métrage offre aussi des séquences sérieuses où l'émotion est présente. Paul est pour sa part un être qui n'est pas là que pour amuser la galerie. Il est aussi un être touchant qui met certains de ses pouvoirs au service des gens, à la manière de CJ7 dans le film de Stephen Chow. Il permet ainsi à la jeune catholique de recouvrer la vue et il ressuscite un de ses nouveaux amis. De manière plus générale, Paul est un être bienveillant comme le signale le final du film où notre extraterrestre choisit d'amener avec lui la petite fille qui l'a découvert en 1947, et qui est devenue depuis une vieille dame.
Film tout à la fois drôle et humaniste, Paul est une belle surprise.

15.03.11

Raison et sentiments d’Ang Lee (1995)
En réalisant Raison et sentiments, Ang Lee adapte à l’écran le second roman de Jane Austen.
Le scénario d’Emma Thompson retranscrit d’ailleurs très bien les thématiques chères à la romancière anglaise, à savoir l’importance de l’argent et du statut social dans l’Angleterre du XIXe siècle. L’histoire est la suivante : A la suite du décès de leur père, les sœurs Dashwood et leur mère doivent réduire leur train de vie et quitter leur propriété pour vivre dans une plus modeste maison à la campagne. Elles trouveront cependant chacune l’homme de leur vie…
Le film dresse le portrait très juste des sœurs Dashwood qui sont très différentes de par leur caractère : Elinor (jouée par Emma Thompson), la sœur aînée, est plutôt discrète et raisonnable, très attachée à la tradition alors que Marianne (interprétée par Kate Winslet), sa jeune sœur est impétueuse et ne se soucie guère des principes de son époque.
Raison et sentiments a ceci d’intéressant qu’il montre bien qu’il faut parfois laisser la raison de côté pour montrer au grand jour à celui qu’on aime les sentiments que l’on a envers.
Cette adaptation, servie par de très bons dialogues et de bons acteurs (le lover Alan Rickman et le guindé Hugh Grant), rend donc justice à une œuvre essentielle de la littérature romantique.

Splendor de Gregg Araki (1999)
Voilà un film qui n’était pas gagné d’avance et pouvait même faire craindre le pire aux amateurs romantiques, sachant qu’il est réalisé par Gregg Araki (Nowhere, The doom generation !!!), plutôt adepte à l’époque des comédies trash sur la jeunesse américaine.
Et pourtant, voilà une superbe comédie romantique qui bénéficie d’un scénario assez original.
L’histoire : Véronika (interprétée par la jolie Kathleen « Beverly Hills » Robertson) tombe durant la même soirée amoureuse de deux garçons, Abel, le brun ténébreux intellectuel (joué par Jonathan Schaech) et Zed, le blond viril (Matt Keeslar). Ne souhaitant pas choisir entre les deux, un ménage à trois se forme. Puis arrive un producteur de cinéma qui va changer la donne en proposant à Véronika une vie stable avec lui. Qui choisira-t-elle en définitive ?
Tous les acteurs jouent parfaitement la comédie dans Splendor. On s’attache vraiment à Véronika, Abel et Zed. Par ailleurs, le film est comme toujours chez Araki d’une grande beauté esthétique : il y a un sacré travail qui a été effectué sur les couleurs (ah, quelle belle scène le moment où Véronika et Abel se rencontrent dans un bar branché où l’on entend un remix de « Before today » d’Everything but the girl). Rythmée par plusieurs titres très connus qui ont été remixés pour l’occasion (« Before today », « Beetlebum » de Blur, « Kelly watch the stars » d’Air), l’excellente B.O. de Splendor participe au succès de ce beau film.
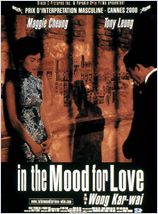
In the mood for love de Wong Kar-Wai (2000)
Voilà un autre film d’une grande beauté esthétique, le célèbre In the mood for love du dernier président du Jury de Cannes, à savoir Wong Kar-Wai.
Le film se passe à Hong-Kong en 1962. madame Chow (la ravissante Maggie Cheung) s’installe dans un appartement avec son époux. Au même moment, monsieur Chow (le très séduisant Tony Leung) s’installe dans un appartement voisin avec sa femme. Ils apprennent alors que leurs époux respectifs entretiennent une relation amoureuse. Cet événement les rapproche ; débute alors entre eux une amitié trouble, une complicité de tous les instants. Tout se joue sur l’ambiguïté, sur les non-dits. Mais à aucun moment les deux personnages ne vont se déclarer leur amour. Le temps semble pourtant progressivement les rattraper.
Tout dans ce film est majestueux. En plus des deux acteurs qui resteront à jamais comme un couple légendaire à l’écran (Tony Leung a obtenu à Cannes en 2000 le prix d’interprétation masculine, ce qu’aurait bien évidemment mérité également Maggie Cheung), on est subjugué par la mise en scène soignée et l’énorme travail sur la photo du film. Quant à la musique lancinante, elle ne fait que renforcer le côté « amour éternel » du film.

My sassy girl de Jae-Young Kwak (2001)
Voilà un film sud-coréen très rafraîchissant. Jouant sur les deux tableaux habituels de la comédie romantique, à savoir la romance et la comédie, ce film se démarque de bien d’autres par son côté outrancier dans le comique. Pourtant, on s’attache aux personnages et on croit à cette histoire d’amour (les américains comptent d’ailleurs en faire un remake, argh !).
L’histoire est très originale : Gyeon-Woo, un jeune homme étudiant fainéant et timide rencontre un soir dans le métro Jeon Ji-Hyeon, une jeune femme ivre. Il décide alors de l’aider en l’emmenant dans un hôtel. De nombreux quiproquos font que Gyeon-Woo va être victime de sa gentillesse (le responsable de l’hôtel pensant que le jeune homme a tenté d’abuser de la jeune femme, point de vue que pense également Jeon Ji-Hyeon, lorsqu’elle se réveille, etc.). Il va même devenir pendant un bon moment le souffre-douleur de Jeon Ji-Hyeon. Mais au fond, il fera tout pour elle, car il aime beaucoup cette fille.
Alternant comme je l’ai précédemment avec beaucoup de bonheur moments de pure comédie et moments d’un grand romantisme (je pense notamment à la scène sous l’arbre à la fin du film), le film réussit le tour de force de nous faire passer du rire aux larmes. Cela est dû d’une part à l’excellent montage de son réalisateur mais surtout au jeu particulièrement convaincant de ses deux acteurs principaux. Une excellente découverte.
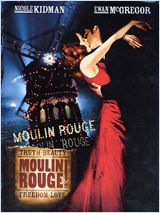
Moulin rouge de Baz Luhrmann (2001)
Quand Baz Luhrmann réalisateur du déjà très convaincant Balroom dancing, décide de remettre le couvert avec une comédie musicale, on peut s’attendre au meilleur et c’est le cas.
Le film se déroule à Paris, au début du vingtième siècle et raconte la folle relation entre Christian (joué par Ewan McGregor), jeune poète aux idées utopiques, et Satine (Nicole Kidman), courtisane et vedette du moulin Rouge, le célèbre cabaret parisien.
Peut-être est-ce là le film le plus haut en couleurs, le plus outrancier de ma sélection. Cependant il n’en est pas moins un formidable hymne à l’amour.
Réalisé de main de maître, Moulin rouge bénéficie de la présence de deux extraordinaires acteurs, Nicole Kidman et Ewan McGregor qui n’ont de cesse de se rendre la pareille dans ce cache-cache amoureux.
Le montage du film est d’une incroyable beauté visuelle, on se croirait dans un opéra-rock d’un autre temps ; à cet égard les chorégraphies sont très réussies et les chansons, qui reprennent de célèbres airs, sont on ne peut plus remarquables (ah quelle belle scène que ce medley qui a lieu entre Satine et Christian sur le toit du Moulin Rouge et qui permet d’entendre quelques-unes des plus belles chansons d’amour du siècle avec la reprise de U2, Kiss, les Beatles).
Les sentiments exacerbés du film font de cette comédie musicale tragique font qu’on s’identifie à ces personnages, à leur joie, à leur tristesse.
Comment ne pas laisser couler une larme à la fin du film lors de la magnifique scène où Christian chante « Come what may » en l’honneur de Satine, afin de la retrouver à nouveau (une dernière fois).

Punch drunk love de Paul-Thomas Anderson (2002)
Adam Sandler dans un grand film romantique ? Le réalisateur de Boogie nights et Magnolia a-t-il perdu les pédales ? Eh bien non. Car Adam Sandler est très convaincant dans cette comédie romantique décalée.
L’histoire s’intéresse à Barry Egan (Adam Sandler), un petit entrepreneur extrêmement timide et caractériel par instants, qui souffre de la présence envahissante dans sa vie de célibataire de ses 7 sœurs. Mais les choses vont radicalement changer pour lui lorsqu’il va découvrir l’amour de sa vie en la personne de Lena (jouée par Emily Watson), la collègue de travail de l’une de ses soeurs.
Bénéficiant de la mise en scène originale de Paul-Thomas Anderson (d’ailleurs récompensé en 2002 à Cannes par ce fameux pris de la mise en scène), le film se révèle être l’une des plus belles comédies romantiques que j’ai jamais vues.
Car si Barry Egan est un personnage qui souffre d’un mal-être, on voit bien que quelque chose lui manque pour la vie enfin lui sourit. Et ce manque va être comblé lorsqu’il va découvrir l’amour en la personne de Lena. Même s’il a ses défauts (il est parfois maladroit, colérique), Barry n’en demeure pas moins un personnage attachant, auquel on s’identifie ; Car sa love-story avec Lena est pure et sans limites…
De surcroît, Barry Egan représente sur bien des points le portrait actuel de l’homme célibataire.

Eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry (2004)
Voilà là encore un acteur utilisé à contre-emploi, Jim Carrey, qui donne parfaitement la réplique dans ce film romantique pour le moins original.
En effet, on apprend que Valentine (interprétée par Kate Winslet) a décidé de supprimer de sa mémoire par une nouvelle technologie toute trace des événements qu’elle a vécus avec son ex-petit ami, Joel (Jim Carrey). Ce dernier apprend par hasard la décision qu’a prise Valentine et, désespéré, il décide de faire la même chose. Mais lors du processus d’effacement de sa mémoire, il voit défiler devant lui tous les merveilleux moments qu’il a vécu avec Valentine. Il décide alors de lutter de toutes ses forces pour ne perdre ces souvenirs. A des années-lumières des rôles de comique burlesque auquel il est trop souvent identifié, Jim Carrey est dans ce film très convaincant, ceci grâce à un jeu tout en retenu. Le film qui étale progressivement les événements qu’ont vécu Joel et Valentine, est traversé de nombreuses scènes d’une grande force poétique (je pense notamment à cette scène où les deux héros, couchés sur la glace, regardent en direction du ciel).
Il montre qu’on ne doit pas tenter d’effacer les moments d’une vie. Si les événements ne sont pas toujours heureux, il faut faire avec les qualités et les défauts de l’être que l’on aime.
En cela, Eternal sunshine of the spotless mind signifie qu’il ne faut pas laisser la chance que l’on a de pouvoir découvrir la femme de sa vie.

J’me sens pas belle de Bernard Jeanjean (2004)
Le seul film français de ma sélection. Et il le mérite bien. Car J’me sens pas belle regorge de qualités.
Dans ce premier long métrage, Bernard Jeanjean a décidé de faire une comédie romantique qui se démarque des autres dans le sens où les sentiments des deux protagonistes apparaissent plus vrais que nature : Fanny (Marina Foïs) est célibataire trentenaire qui a décidé de privilégier les aventures d’un soir plutôt qu’une belle histoire d’une vie. Sa victime désignée est Paul (Julien Boisselier), l’un de ses collègues, qu’elle a invité à dîner chez elle. Oui mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu.
La grande force de ce film est de brosser le portrait fidèle de deux célibataires, de montrer les difficiles relations que peuvent connaître un homme et une femme alors que finalement ils ont tout pour être heureux ensemble.
Le personnage de Marina Foïs est particulièrement remarquable, celui d’une jeune femme qui décide de rester célibataire alors qu’elle a tant d’amour à donner. Quant au personnage de Julien Boisselier, il est également très intéressant dans le rôle de cet homme qui, lui aussi, recherche l’âme sœur en privilégiant l’honnêteté (la fin du film est à cet égard superbe, lorsqu’il revient dans l’appartement de Fanny, en lui apportant des croissants alors que celle-ci croyait qu’il l’avait quitté).
Loin de toute bluette sentimentale, J’me sens pas belle est particulièrement contemporain de l’état de notre société et des sentiments que l’on a du mal à exprimer au sexe opposé.

Orgueil et préjugés de Joe Wright (2006)
En réalisant le film Orgueil et préjugés, le Britannique Joe Wright adapte à l’écran le plus célèbre roman de Jane Austen. Le scénario du film est en apparence relativement simple : madame Bennet (interprétée par Brenda Blethyn) a cinq filles qu’elle souhaite marier afin de faire remonter sa famille sur le plan social. Car dans cette Angleterre de la fin du XVIIIème siècle, la famille Bennet est une bourgeoisie désargentée qui a bien du mal à sauver les apparences en conservant tant bien que mal des domestiques et n’a de surcroît que l’usufruit de sa modeste propriété.
Le film est centré sur le personnage de la jeune et rebelle Elizabeth dite « Lizzie » Bennet (interprétée par la jolie Keira Knightley), qui est constamment tiraillée entre sa volonté de liberté et de changement – n’hésitant pas à tenter de briser les codes sociaux de l’époque pour faire comprendre à quiconque son point de vue – et son amour secret pour le ténébreux Darcy (Matthew Mac Fadyen).
En plus de son romantisme très bien senti (ah quelle belle scène au moment où, sous une pluie battante, Darcy ouvre son cœur et déclare sa flamme à Elizabeth) ce film en costumes a le mérite de dresser un portrait très juste de la vie provinciale dans l’Angleterre de la fin du XVIIIème siècle.
En somme, une belle histoire d’amour qui bénéficie d’une mise en scène très dynamique et de très bonne composition classique de Dario Marianelli . Un film à consommer sans modération.

500 jours ensemble de Marc Webb (2009)
Premier film de Marc Webb, 500 jours ensemble est un film romantique pour le moins atypique. Le cinéaste a pris le parti de déstructurer le récit en donnant un film qui suit une logique certaine mais qui n'est pas linéaire. Pendant un bon moment on jongle au sein de ces fameux 500 jours, en passant par exemple d'une journée où les deux personnages principaux ne s'aiment plus (pas) pour revenir sur les premiers jours de la rencontre ou encore sur les moments agréables de la relation. Marc Webb réussit le tour de force de rendre son film passionnant avec non seulement ce récit non linéaire mais aussi et surtout avec une vraie réflexion derrière. Le cinéaste rappelle de façon très juste au spectateur que l'on peut soudainement passer de moments très agréables avec la personne aimée (la scène d'IKEA, la scène de la douche ou encore d'autres scènes très intimistes) à des moments beaucoup moins marrants, dans des lieux identiques, qui sont annonciateurs d'une prochaine rupture. Plus globalement, le film contient une vraie réflexion sur le couple contemporain, avec la crainte de tout un chacun que l'être aimé nous laisse tomber un jour.
Le film n'en conserve pas moins un certain optimisme. Car le propos de 500 jours ensemble est clair à ce sujet : si on perd l'être aimé, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas de la bonne personne. Voilà un beau film qui parle d'amour qui mérite largement d'être vu.
14.03.11
Je vous propose un avis sur mes 20 films romantiques préférés. J'ai classé ces films uniquement par ordre de sortie dans les salles. En effet, même si j’ai une préférence pour certains par rapport à d’autres, ces films m’ont tous plu pour des raisons diverses.

Casablanca de Michael Curtiz (1942)
Ce film qui est contemporain des événements qu’il montre des gens qui sont venus se réfugier à Casablanca (Maroc) afin de fuir le nazisme. Elles se retrouvent souvent Chez Rick, un café casablancais à la mode. Mais l’ennemi nazi n’est jamais loin…
Si Casablanca est de prime abord un superbe film sur l’idée de la nation (comment ne pas verser une larme ou avoir une pensée émue en entendant la Marseillaise dans le café alors que de nombreux nazis sont présents), son intérêt principal réside dans la romance qu’il développe. Regroupant un couple légendaire, à savoir Humphrey Bogart (qui joue Rick Blaine) et Ingrid Bergman, Casablanca est avant tout l’histoire de personnes qui se retrouvent face à leur destin. Le côté romantique du film est évident, avec une Ingrid Bergman tiraillée entre son ancien amour, Bogart et son actuel époux (interprété par Paul Henreid, un célèbre acteur allemand), un résistant venu temporairement se réfugier au Maroc. Plusieurs scènes sont à cet égard mémorables : je pense notamment au moment où Bogart déclare à Bergman : « Nous aurons toujours Paris », faisant allusion aux jours heureux passés ensemble ; il y a aussi le moment où Bogart demande à son fidèle pianiste Sam le morceau de musique qui lui rappelle sa bien-aimée (« Play it again Sam ! ») ; et puis il y a le fameux final du film avec l’acte héroïque de Bogart suivi du regard que lui lance Ingrid Bergman.

Le ciel peut attendre d’Ernst Lubitsch (1943)
Appréciant déjà particulièrement To be or not to be de Lubitsch, je lui préfère pourtant un autre film. Il s’agit donc de Le ciel peut attendre. Le film montre un américain, Henry Van Cleve, qui vient de décéder et doit se justifier de ses faits et gestes sur Terre au gardien de l’Enfer. Le film est donc continuellement en flash-backs. Il débute par la naissance d’Henry jusqu’à ses derniers jours. Si Ernst Lubitsch est comme à son habitude particulièrement cynique, il a par contre un regard tendre sur son couple vedette qui regroupe Don Ameche (Henry) et Gene Tierney (Martha). Avec son style de vie d’épicurien, Henry est d’ailleurs l’intermédiaire de Lubitsch, qui prône toujours dans ses films le plaisir de l’instant immédiat dont il convient de profiter. Véritable film testament (pour un film qui évoque la mort de surcroît !), Le ciel peut attendre est peut-être le plus grand film sur l’amour éternel. En effet, on constate tout au long du film que si Henry est un homme qui aime les femmes, il est par contre toujours resté fidèle à son épouse, Martha. D’ailleurs, lorsque cette dernière décède, son existence sur Terre devient terriblement morne. Et à la fin du film, alors qu’Henry s’attend à être envoyé en Enfer, le gardien lui signifie que c’est le paradis qui lui est promis. Et donc l’espoir de retrouver son épouse…

Sabrina de Billy Wilder (1954)
Le « fils spirituel » d’Ernst Lubitsch, le grand Billy Wilder, met en scène avec Sabrina Humphrey Bogart et la très gracieuse Audrey Hepburn. Il s’agit là d’une très belle comédie romantique qui peut paraître très classique dans sa construction. En effet, le film raconte l’histoire de Sabrina, qui se trouve être la fille du chauffeur de la famille Larrabee, une riche famille américaine. Sabrina aime le jeune David Larrabee (interprété par le grand William Holden), qui doit se marier pour apporter un contrat important dans la famille (Wilder gardant toujours son côté drôle et cynique sur la vie). David n’est pas indifférent à Sabrina et Linus Larrabee, son frère aîné, se dévoue pour distraire et écarter Sabrina de David. Comme on peut s’y attendre, Sabrina et Linus tomberont amoureux l’un de l’autre. Même si l’originalité n’est pas le maître-mot du film, il donne au spectateur ce qu’il veut voir : une belle comédie romantique, ponctuée de savoureux dialogues.

Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov (1957)
Le grand réalisateur russe de Soy Cuba est également très connu pour Quand passent les cigognes, film avec lequel il a obtenu la Palme d’Or à Cannes. L’histoire se déroule en Russie en 1941. Véronika et Boris s’aiment mais la guerre va séparer les deux tourtereaux. En effet, Boris part sur le front. N’ayant plus de nouvelles de l’être qu’elle aime, Véronika finit par épouser un cousin de Boris. Mais évidemment, son cœur est toujours pour celui-ci. Ce que ne sait pas Véronika, c’est que Boris est mort sur le front. Lorsque la guerre se termine et que les soldats rentrent chez eux, Véronika a toujours l’espoir de revoir son Boris. Elle ne pense qu’à lui. La mise en scène majestueuse de Kalatozov rend bien compte du drame de Véronika, notamment à la fin du film où, perdue au milieu d’une foule immense, elle a toujours le secret espoir de revoir Boris. Mais cet amour est à jamais perdu. Et c’est alors qu’on voit dans le ciel passer des cigognes. Symbole évident de cet amour sacrifié mais aussi symbole de paix, la fin de la guerre venant d’être proclamée.

Diamants sur canapé de Blake Edwards (1961)
Le titre original du film (Breakfast at Tiffany’s) s’explique de deux façons. Tout d’abord, Breakfast at Tiffany’s est le titre du roman de Truman Capote dont est adapté le film. Ensuite, ce titre s’explique par le fait que l’héroïne, Holly Golightly, jouée par la ravissante et très « fashionable » sur le coup Audrey Hepburn, prend son petit déjeuner en observant les vitrines remplies de diamants de la joaillerie Tiffany’s. Holly, qui provient d’un endroit paumé des Etats-Unis, s’est installée à New York dans le but de vivre la grande vie. C’est pourquoi elle a décidé de faire un mariage d’argent avec un riche brésilien. Mais cela ne sera pas le cas. Un certain Paul Varjak (interprété par George Peppard) vient d’emménager juste à côté de chez elle. Il tombe rapidement amoureux de la belle, laquelle n’a de cesse de le taquiner. Car Holly a choisi la fortune à l’amour. En tout cas le pense-t-elle. C’est à la fin du film qu’intervient cette très belle scène romantique (magnifiée par le morceau Moon river d’Henry Mancini) où Paul, assis avec Holly dans un taxi, tente de l’empêcher de se marier avec José. Il finit par lui avouer qu’il l’aime. Mais cela ne la touche pas. Il lui dit alors que les gens sont faits pour tomber amoureux l’un de l’autre car c’est la seule façon d’accéder au bonheur. Il sort alors du taxi. Emue, Holly sort ensuite et ces personnes s’embrassent sous une pluie battante après être partis à la recherche du chat de Holly. L’avenir leur appartient. Fin du film
Avec Diamants sur canapé, Blake Edwards dresse un superbe portrait de femme, toujours en déséquilibre et constamment tiraillée entre plusieurs espoirs.

Embrasse-moi idiot de Billy Wilder (1964)
Mon « Wilder » préféré. Dans ce film, Billy Wilder a notamment choisi de se moquer du mariage. C’est une des raisons pour lesquelles à l’époque, le film n’a pas plu à la critique et a été un échec commercial. Le pitch de base est qu’un chanteur de charme, Dino (le séducteur Dean Martin) tombe en panne dans une ville du Nevada. Le professeur de piano Orville Spooner (joué par Ray Waltson) l’accueille chez lui, voyant là l’occasion de lancer sa carrière de compositeur de chansons. Dino signale rapidement qu’il veut de la compagnie pour la nuit et notamment l’épouse d’Orville. Mais ce dernier est amoureux fou de sa dévouée épouse (jouée par Felicia Farr) , à tel point que cela en devient maladif. Il trouve alors un motif pour la renvoyer du domicile conjugal et la faire « remplacer » par Polly, une serveuse dans un bar, une « fille facile » (jouée par Kim Novak). Dino, véritable homme à femmes, ne voit pas le subterfuge. Mais l’histoire ne se déroule pas comme prévu…
Dans cette comédie, même si Wilder est comme à son habitude extrêmement cynique, il n’en reste pas moins vrai que son film est traversé de beaux moments de romantisme. Les acteurs sont pour beaucoup dans la réussite de ce film qui oscille habilement entre critique de la société américaine et tolérance (en matière amoureuse notamment) à l’égard d’autrui. Kim Novak interprète d’ailleurs brillamment le rôle de cette fille supposée facile qui elle aussi, au fond, ne cherche qu’une chose, le bonheur. Et donc un compagnon pour la vie. Quant à Ray Waltson, il joue très bien le rôle du mari jaloux, qui ne se rend pas compte de la chance qu’il a d’être avec son épouse qui le vénère. Ou s’il s’en rend compte, c’est quand il ne l’a plu. C’est alors qu’il comprend son erreur et va tout faire pour la reconquérir (superbe plan final). De beaux sentiments, de brillants dialogues, des acteurs épatants, une mise en scène très dynamique font d’Embrasse-moi idiot un très grand film.

Avanti! de Billy Wilder (1972)
Encore un film de Billy Wilder que j’adore. Et là encore, le réalisateur américain joue sur plusieurs degrés. En effet, son film est un hymne à la vie et à l’amour qui se construit paradoxalement à l’occasion de deux décès.
Wendell Armbruster (joué par l’excellent Jack Lemmon) se rend sur une île italienne afin d’enterrer son père mort sur son lieu de vacances. Ce businessman ne se fait absolument au rythme lent des italiens et il apprécie très modérément sa voisine d’hôtel, Mrs Piggott (jouée par Juliet Mills), qui se trouve être la fille de la maîtresse de son père ! En fait, Wendell et Pamela, que tout sépare d’un point de vue économique et culturel, sont réunis pour enterrer respectivement leur père et leur mère. Comme on peut s’y attendre avec Wilder, les deux protagonistes n’auront de cesse de s’envoyer des pics avant de finalement découvrir qu’ils sont fait l’un pour l’autre. C’est d’ailleurs presque à la fin du film que Pamela (le prénom de Mrs Piggott) déclare à Wendell Avanti c’est-à-dire en italien Avancez ! Il l’embrasse et ce que l’on pouvait pressentir arriva. Une romance qui, comme je l’ai dit au début, a comme origine deux décès ; d’ailleurs Wendell ne cesse de questionner tout au long du film Pamela pour savoir quelle relation leurs parents ont eu. En cela, cette belle comédie romantique, qui est comme d’habitude chez Wilder doublée d’un ton très drôle (et sarcastique), est ce qu’appelle l’universitaire Stanley Cavell (grand philosophe contemporain) « la comédie du remariage ». On peut penser qu’à l’instar de leurs parents, Wendell et Pamela se retrouveront l’été pour passer du bon temps ensemble. Finalement, ce qui est troublant dans Avanti, c’est que dans un premier temps Wendell Armbruster découvre la liaison adultérine de son père et la condamne, avant de la reproduire lui-même telle quelle, avec de surcroît la fille de la maîtresse de son père.

Elle de Blake Edwards (1979)
Le résultats de l’usure du temps sur l’amour. C’est ce que peut faire penser cette très belle comédie de Blake Edwards.
Le film montre un homme, George Webber, qui a tout pour être heureux : c’est un compositeur renommé, il a une compagne, Sam, qui l’aime. Ils vivent chacun de bons moments ensemble. Oui mais voilà George a 42 ans (Sam 38) et il sent qu’il lui manque quelque chose. Ou plutôt quelqu’un. C’est alors qu’il voit Jenny, « Elle » (jouée par la plantureuse Bo Derek), une femme très belle qui est sur le point de se marier. George ne va penser qu’à cette femme, la suivre partout où elle va jusqu’au moment où il va enfin réussir à lui faire l’amour (sur le Boléro de Ravel). En quelque sorte, la compagnie de cette femme est pour George une cure de jouvence. Mais cette femme n’est pas la femme de sa vie, il sait pertinemment qu’il ne pourra pas passer le reste de son existence avec « Elle ». C’est alors qu’il rentre chez lui et comprend que la femme de sa vie est bien entendu Sam. Il réussit d’ailleurs à la reconquérir en chantant cette merveilleuse chanson : « It’s easy to say I love you (c’est facile de dire je t’aime). There’s only one way to say I love you (il y a une seule façon de dire je t’aime).
Elle évoque avec une justesse de ton incroyable l’inutilité d’aller voir ailleurs quand la femme que vous aimez et qui vous aime est là, juste à côté de vous.

Princess Bride de Rob Reiner (1987)
N’ayant pas été très convaincu au départ par ce film que je trouvais au départ trop guimauve, je l’ai depuis revu et apprécié à sa juste valeur.
Avec Princess Bride, Rob Reiner réalise un film furieusement romantique en remettant au goût du jour le conte de fées.
Le scénario de base est qu’un petit garçon malade se voit raconter par son grand-père l’histoire de la princesse Bouton d’Or (la belle Robin Wright Penn) qui, au pays imaginaire de Florin, tombe amoureuse de son garçon d’écurie, Westley (Cary Elwes). Mais évidemment de nombreuses péripéties vont arriver avant que l’un et l’autre ne se retrouvent pour toujours. Le film est aussi pour Rob Reiner l’occasion de rendre hommage de manière décalée aux films de cape et d’épée ; son héros pouvant faire penser à un acteur aussi mythique qu’Erol Flynn (Les aventures de Robin des Bois de Michael Curtiz). Dans ce film d’aventures situé dans un pays imaginaire, Rob Reiner exalte les sentiments de courage, de dépassement de soi, d’Amour que l’on peut trouver dans les chansons de geste.
En somme, une belle histoire d’amour pour petits et grands.

Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner (1989)
Deux ans après The princess bride, Rob Reiner réalise Quand Harry rencontre Sally, film considéré par beaucoup (dont je fais partie) comme l’un des essentiels du film romantique.
Le film raconte les relations de deux célibataires, Harry (joué par Billy Cristal) et Sally (Meg Ryan). Ces deux personnes vont se fréquenter pendant plusieurs années. Après s’être détestés, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Ils se racontent tout de leur vie privée, pour avoir l’un et l’autre le point de vue d’un ami sur le sexe opposé.
Mais finalement Harry et Sally ont énormément de points communs. Pourtant, ils ne sortent pas ensemble.
Le film a également le mérite de poser une question intéressante : peut-on passer de l’amitié à l’amour pour quelqu’un ?
Eh bien, heureusement, pour toutes les âmes romantiques, ce film répond par l’affirmative.
En définitive, ce film frais, servi par de très bons acteurs et des dialogues brillants qui évoquent bien les rapports complexes entre hommes et femmes, mérite d’être vu et revu.
13.03.11
Titre du film : Never let me go
Réalisateur : Mark Romanek
Durée du film : 1h43
Date de sortie au cinéma : 2 mars 2011
Avec : Carey Mulligan (Kathy), Keira Knightley (Ruth), Andrew Garfield (Tommy), Charlotte Rampling (miss Emily), Sally Hawkins, etc.
Par Nicofeel

Après avoir été révélé par le thriller psychologique Photo obsession, Mark Romanek revient derrière la caméra pour adapter le roman Remains of the day de Kazuo Ishiguro, qui a lui-même écrit le scénario du film.
On apprend en préambule du film que dans les années 50 la médecine fit des progrès importants et qu'en 1967 les gens vivaient en moyenne 100 ans. Tiens, tiens, comment est-ce possible ?
Eh bien des gens peu scrupuleux en matière d'éthique – on en saura pas plus sur ce point – ont créé des clones thérapeutiques. Ainsi, toute la première partie du film se déroule dans diverses institutions où des enfants, qui n'ont jamais eu idée de ce que sont des parents, sont conditionnés dès leur plus jeune âge. Le but de l'existence de ces enfants : faire d'eux des donneurs d'organes une fois qu'ils auront atteints l'âge adulte. Le conditionnement qu'ils subissent est d'ailleurs tellement fort qu'ils ne cherchent même pas à quitter cette société quasi totalitaire, qui ne leur propose aucun avenir. A la différence des héros de films comme L'âge de cristal ou The island, ces jeunes gens prennent avec philosophie ou tout simplement avec tristesse mais sans aucune envie de révolte, l'unique choix qui leur est laissé.
Cela n'empêche pas que le sujet qui est traité dans ce film est brûlant et n'est pas sans rappeler des films de science-fiction tels que Bienvenue à Gattaca ou The island. Sauf qu'ici le propos qui est développé est encore plus prenant puisqu'il se déroule une époque qui est très proche de nous, vu qu'il se déroule durant les « 30 Glorieuses ».
Le film de Mark Romanek qui est très sobrement mis en scène fait froid dans le dos. Comment comprendre que dans nos démocraties, qui sont normalement respectueuses du genre humain, on se mette à élever des clones, comme on élève des poulets en batterie. Le degré de liberté de ces clones est d'ailleurs réduit à sa plus simple expression puisqu'ils sont pistés via un bracelet magnétique qu'ils ont sans cesse sur eux et qu'ils doivent utiliser pour badger lors de chaque journée qui passe. Le film pose de vraies questions éthiques puisque l'on voit bien que ces jeunes gens ressentent des émotions et agissent comme n'importe quel être humain. Ils ont bien une âme. C'est la raison pour laquelle on peut se demander pourquoi leur vie à eux doit s'écourter pour profiter à d'autres. On ne peut être qu'inquiet de constater que tout le monde est au courant de l'existence de ces clones et que ni les médecins ni les infirmiers ne sont choqués par le fait d'enlever la vie à des jeunes gens.
Le film est d'autant plus prenant qu'il adopte un ton sérieux de bout en bout. Si Mark Romanek greffe une histoire d'amour dans ce film entre les deux personnages principaux, Kathy qui est accompagnante (elle accompagne les donneurs d'organes) et Tommy, il n'empêche que le sursis qu'ils espèrent (obtenir plus de temps de vie avant de donner des organes) n'est qu'un espoir naïf, voire même un leurre. L'issue est inéluctable. Dès le départ, on se doute qu'il n'y aura aucune échappatoire. Si l'on a inculqué à ces donneurs d'organes le terme de terminer en parlant de la fin de leur vie au lieu de celui de mourir – comme s'ils n'étaient pas des êtres dotés d'une vie – cela ne change rien à leur situation qui est fondamentalement dramatique. Entre un et trois dons (selon la gravité de l'organe à donner) ils meurent comme si de rien n'était.
Traité de manière clinique avec des couleurs grisâtres, Never let me go est un film plutôt pessimiste sur le genre humain. C'est aussi un film qui invite à s'interroger sur les progrès de la science. Il ne faudrait pas que les progrès considérables que l'on vit chaque jour soient utilisés de façon douteuse sur le plan éthique.
Bénéficiant d'un scénario particulièrement intéressant, d'une mise en scène solide et d'une belle photographie qui accroît le côté désespéré de l'ensemble, Never let me go peut aussi s'appuyer sur une distribution de premier choix. Révélation du film Une éducation, Carey Mulligan apporte une vraie touche émotionnelle à ce film en interprétant le rôle de Kathy, une jeune fille amoureuse de son ami Tommy. Ce dernier est joué par Andrew Garfield, vu notamment dans The social network. Dans Never let me go, il rend bien la pareille à Carey Mulligan en jouant un jeune homme manquant de repères et d'assurance. Dans le rôle de la fille venue empêcher un couple naturel de se former, on retrouve Keira Knightley. La distribution du film comprend également les actrices Charlotte Rampling et Sally Hawkins qui sont là pour conditionner les jeunes clones.
Au final, Never let me go n'est certes pas le film de l'année, il n'en demeure pas moins un film très intelligent qui pose de nombreuses questions et qui n'a pas besoin d'avoir recours à de multiples effets spéciaux pour nous mettre en garde contre les dangers de la science.
Le film prend d'autant plus de résonance quand on voit ce qu'est capable de faire la science avec des embryons.

12.03.11
Titre du film : Les tueurs de l'éclipse
Réalisateur : Ed Hunt
Durée du film : 1h25
Date de sortie au cinéma : 1982 (inédit en DVD)
Avec : Lori Lethin, Melinda Cordell, Julie Brown, Joe Penny, Bert Kramer, K.C. Martel, Susan Strasberg, José Ferrer, etc.
Par Nicofeel

Deuxième et dernier d'Ed Hunt après L'invasion des soucoupes volantes (1978), Les tueurs de l'éclipse est un petit film d'horreur encore inédit en DVD à ce jour.
Est-ce que son absence des bacs à DVD serait dû à une qualité assez pauvre du film ?
Absolument pas. En effet, sans avoir l'air d'y toucher, Ed Hunt livre en 1h25 un film d'horreur très efficace.
L'histoire est tirée par les cheveux puisqu'elle raconte que trois bébés sont nés pendant une éclipse de pleine lune le 09 juin 1970 dans la même maternité, dans la petite ville de Meadowvale en Californie. L'action du film va se dérouler 10 ans plus tard, juste un peu avant que ces trois enfants ne fêtent leur dixième anniversaire.
Forcément, dit comme cela, le film n'apparaît n'est pas très crédible mais on s'en moque un peu car on est dans un film d'horreur de série B et ce n'est pas la véracité des événements qui nous intéresse mais plutôt le traitement de ce qui va se passer.
Et sur cet aspect des choses, le film est vraiment très intéressant. En effet, les trois enfants nés pendant l'éclipse – Debbie ; Curtis et Steven - sont loin d'être recommandables. Visiblement assez différents de leurs petits camarades du même âge, ils ne pensent qu'à tuer des gens.
L'une des premières scènes du film fait penser à un slasher avec ce couple de jeunes qui se bécote dans un cimetière et se fait tuer par un mystérieux tueur. Sauf qu'ici le tueur n'est pas la personne auquelle on peut penser immédiatement. Il s'agit d'un enfant.
Le film a d'ailleurs la bonne idée d'être assez sérieux sur son fond. Pas de blagues débiles qui émaillent le film. Seuls ces trois enfants font preuve parfois d'humour (Debbie en parlant de sa grande sœur : « sa cervelle est dans son soutien-gorges »), qui se révèle assez noir. C'est en tout cas le côté extrêmement froid des actes de ces enfants qui fait peur. Ainsi, ils n'hésitent pas à tuer leur professeur avec une arme, et en plus à tuer certains membres de leur famille (très belle scène de la flèche). Le film est glaçant car les gens qui sont présentés dans le film ne peuvent pas se douter que ce sont ces enfants qui sont des tueurs. D'autant que la jeune fille, Debbie, a l'air charmante. C'est pourtant elle qui, derrière son air angélique, est la plus cinglée et demande à ses deux camarades de tuer des gens. En outre, elle garde auprès d'elle un cahier rempli de coupures de journaux sur les gens qu'ils tuent, comme s'il s'agissait de trophées.
Si le scénario du film est assez astucieux et que les enfants qui jouent le rôle de ces tueurs pour le moins originaux sont crédibles dans leurs rôles, il faudra également noter l'apport de la bande son du film, signée Arlon Ober, qui donne un côté stridant et stressant à ce long métrage. Cela renforce indéniablement l'étrangeté de voir ces enfants qui n'éprouvent aucun sentiment et sont satisfaits des méfaits qu'ils commettent.
Pour autant, Les tueurs de l'éclipse n'est pas dénué de défauts. Loin s'en faut. Quelques scènes sont illogiques, comme le coup du gamin qui sait conduire et poursuit une jeune femme en voiture dans une déchetterie ou encore le coup de la mère de famille qui laisse sa fille seule pendant deux jours alors que des meurtres ont lieu dans la ville.
Et puis, même si cela n'est pas répréhensible en tant que tel, le cinéaste agrémente son film de plusieurs scènes de nudité qui ne sont pas d'une grande utilité. Mais bon, il faut voir que le film est avant tout destiné à la base à un public d'adolescents ou d'adultes fans de films d'horreur. Dès lors, l'aspect nudité correspond bien à des éléments que l'on retrouve dans certains films d'horreur.
Au final, malgré quelques petits défauts, Les tueurs de l'éclipse s'avère être une excellente surprise. Mené tambour battant avec un nombre important de scènes de meurtres et une thématique originale, le film est très appréciable. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit prochainement édité en DVD pour un éditeur français.

11.03.11
Titre du film : Carancho
Réalisateur : Pablo Trapero
Durée du film : 1h47
Date de sortie du film : 2 février 2011
Avec : Ricardo Darin (Sosa), Martina Gusman (Lujan), etc.
Par Nicofeel

Première cause de mortalité en Argentine, les accidents de la route sont l'objet d'un véritable business dans ce pays.
Le chef de file du cinéma argentin contemporain, à savoir Pablo Trapero, a choisi de partir de ce sujet pour mettre en scène son nouveau long métrage.
Proche du documentaire, comme dans nombre de ses films (El Bonaerense, Leonera), Pablo Trapero entend coller à la réalité et être au cœur de la société actuelle.
Le film va faire le portrait d'un pays, l'Argentine, qui se trouve dans un véritable chaos. En effet, de nombreuses personnes entendent passer outre les lois pour en tirer profit. C'est le cas du personnage principal du film, Sosa (Ricardo Darin), un avocat déchu, qui est un rapace (littéralement un carancho, d'où le titre du film) car il profite des accidents de la route pour en faire un business florissant. Sosa travaille au sein de la Fondation, dont le nom pourrait faire penser à une association de défense de personnes victimes d'accidents de la route. Mais cela n'est pas le cas. Bien au contraire. Au sein de cette société, Sosa, comme ses autres collègues, fait croire aux gens qu'ils sont venus les aider pour qu'ils touchent un maximum d'argent auprès des assurances. Ils oublient de dire l'essentiel : ils vont très largement se rémunérer et ne donner au final qu'une faible part de l'argent due aux victimes ou aux parents de la victime si cette dernière est décédée. C'est évidemment cette attitude qui vaut à ces gens le surnom peu flatteur de rapaces.
Mais il y a pire. Le film montre que ce marché lié aux accidents de la route profite à un nombre important de personnes, et pas forcément à ceux que l'on pense. Outre d'anciens avocats peu scrupuleux, ce système profite à des urgentistes et même des policiers. On a affaire à une véritable mafia qui est parfaitement rodée.
A tel point d'ailleurs que les rapaces sont parfois à l'origine de faux accidents de la route. C'est lors de l'un d'eux que Sosa rencontre l'autre personnage principal du film, la belle Lujan, une médecin-urgentiste.
Au sein d'une Argentine chaotique, le réalisateur Pablo Trapero réussit à nous faire croire à une histoire d'amour hautement improbable à la base entre deux personnes complètement opposées : l'une ne recherche que le profit, quitte à mettre la vie de certains citoyens en danger et l'autre n'a d'autre but que de sauver la vie des gens qu'elle est amenée à ausculter. La première fois où ces deux personnes boivent un verre ensemble est d'ailleurs caractéristique de l'ensemble du film. Sosa fait un pari avec Lujan sur le nombre de voitures qui vont griller le feu rouge sur la rue adjacente et s'il a raison, il pourra l'embrasser : dans cette scène il est tout à la fois question du danger avec ces voitures qui ne respectent pas le code de la route mais aussi de l'envie de Sosa de sortir avec cette belle femme.
Le réalisateur argentin parvient progressivement, par petites touches, à nous faire croire à cette histoire d'amour. Il faut dire que l'un et l'autre ont en commun d'être seuls et d'être sur la corde raide : Sosa commence à être fatigué par ce boulot qui ne lui plait pas – il souhaiterait pouvoir exercer à nouveau le métier d'avocat – et Lujan n'en peut plus de travailler un nombre d'heures très important. Elle en est réduite à se droguer pour tenir le coup.
Avec une mise en scène proche des personnages principaux, où les corps sont au cœur de tout, on voit d'autant plus que ces gens sont épuisés par cette société qui les broie pour des raisons diverses. Sosa a beau vouloir changer de vie pour pouvoir être pleinement avec Lujan, cela n'est pas facile car il fait partie d'un système infernal qu'on ne quitte pas comme on veut. C'est comme s'il voulait quitter une mafia. On ne part pas comme ça. C'est ce que lui font comprendre plusieurs personnages qui ne sont pas d'une fréquentation des plus recommandables. Il faut dire que dans ce film peu de personnages sont appréciables. D'autant que la plupart des scènes ont lieu de nuit, ce qui accroît le côté sombre du film.
Les personnages sont rarement dans la lumière, hormis cette belle scène où Sosa et Lujan dansent ensemble dans une fête familiale. Il faut dire que cette lumière est justifiée car c'est à ce seul moment que Sosa se « rachète » une bonne conscience en expliquant les arnaques de la fameuse Fondation.
Dès lors, le seul vrai personnage positif de bout en bout est celui de Lujan qui accepte de travailler comme une damnée à l'hôpital, mettant à jour au demeurant les faibles moyens dont disposent les hôpitaux en Argentine. C'est cette même Lujan qui accepte de tout plaquer par amour pour Sosa. Ce n'est donc absolument pas une histoire d'un jour entre ces deux-là mais bien une histoire d'amour sincère.
La crédibilité de cet amour tient d'autant plus que les deux acteurs principaux, Ricardo Marin (vu dans l'excellent film Dans ses yeux) et Martina Gusman (la femme du réalisateur, vue dans ses deux précédents longs métrages, notamment le très beau Leonera) sont parfaits dans le rôle de Sosa et de Lujan. Leur jeu toujours très juste permet au film d'être extrêmement prenant.
Au final, outre la romance très fragile qu'il arrive admirablement à instaurer entre deux personnes aux idéaux opposés à la base, Carancho demeure un film particulièrement noir et révélateur d'un chaos ambiant. Il s'achève d'ailleurs de la même façon qu'il a commencé, c'est-à-dire par un accident. Véritable choc pour le spectateur, Carancho est surtout un film qui dénonce l'attitude de certains qui profitent de la misère sociale d'une partie du peuple argentin. Avec Leonera, Carancho constitue sans nul doute le film le plus abouti de son auteur.

10.03.11
Titre du film : Le discours d'un roi
Réalisateur : Tom Hooper
Durée du film : 1h45
Date de sortie au cinéma : 2 février 2011
Avec : Colin Firth (George VI), Helena Bonham-Carter (Reine Elizabeth), Geoffrey Rush (Lionel Logue), Guy Pearce (Edouard VIII), Eve Best (Wallis Simpson), etc.
Par Nicofeel

Plutôt cantonné jusque-là à la réalisation de séries télévisées (Cold feet ; Suspect n°1 ; Elizabeth I), Tom Hooper se lance dans un de ses premiers films de cinéma avec Le discours d'un roi. Il s'agit d'un biopic qui raconte l'accession au trône d'Angleterre de George VI, père d'Elizabeth II. Si l'histoire des rois passionne toujours autant les gens, celle-ci à de quoi intéresser car initialement George VI n'aurait dû devenir roi d'Angleterre. Son frère aîné, Edouard VIII a renoncé au trône pour vivre avec une américaine en instance de divorce. Dès lors, c'est son frère cadet, le duc d'York Albert, qui devait reprendre sa place. Sauf que ce duc d'York, surnommé Bertie, est bègue. Il va donc devoir combattre son handicap pour monter sur le trône d'Angleterre.
Le réalisateur Tom Hooper montre très bien l'histoire de cet homme, devenu roi contre toute attente. Mais avant d'en arriver là, le duc d'York doit résoudre son problème de bégaiement. Car il est bien difficile d'être un homme public et de faire de nombreux discours lorsque l'on est un roi. D'ailleurs, cela n'est pas un hasard si le film débute par un discours que prononce le duc d'York. Il montre toute la difficulté pour cette homme de faire face à pression due à son rang et à la pression d'être un homme public. Son incapacité à parler distinctement révèle son problème de bégaiement et est pour lui un grand moment de solitude.
Dès lors, on comprend pourquoi il cherche le moyen de se débarrasser de son handicap. C'est le cœur même du film que la relation qui va 'établir entre un orthophoniste hors normes et ce futur roi. Le thérapeute en question est Lionel Logue, un acteur raté qui officie dans un endroit miteux, loin des fastes des rois. Malgré la différence de classe sociale qu'il y a entre ces deux hommes, dès le départ Lionel Logue tient à ce que la relation soit d'égal à égal. C'est la raison pour laquelle il appelle le duc d'York Bertie. Les méthodes employées par Lionel Logue pour « guérir » le futur George VI sont loin d'être académiques. En effet, le duc d'York se met à danser et à chanter. Et puis il se met à proférer des insultes, ce qu'il ne fait jamais en raison de son étiquette. En fait, Lionel invite Bertie à se déstresser et à faire le vide autour de lui. Le film ne tombe à aucun moment dans une sorte de niaiserie ou à tout le moins dans une évolution logique qui amènerait les deux hommes à devenir immédiatement des amis ou des complices. Non, la relation est émaillée de vrais conflits entre le thérapeute et son malade.
On appréciera dans ce film le fait que le duc d'York s'ouvre à cet homme, permettant de comprendre que son bégaiement est lié à un traumatisme dont il a été victime étant jeune : un frère aîné qui s'est moqué de lui ; l'obligation d'être droitier alors qu'il était gaucher ; une nourrice tyrannique.
Si le film est intéressant par sa capacité à mélanger avec brio petite et grande histoire, il vaut surtout par sa distribution quatre étoiles.
Ce film ne serait rien sans ses acteurs. Colin Firth est bluffant dans le rôle de cet homme qui souffre à cause de son bégaiement. L'acteur a dû faire un sacré travail au niveau de sa diction pour arriver à un tel résultat. A ce sujet, il convient bien évidemment de voir ce film en version originale sous-titrée. Colin Firth dégage un vrai charisme dans le rôle de ce roi George VI. Il est d'ailleurs très probant lors de la dernière scène du film où il doit lire le discours qui va engager l'Angleterre en guerre contre l'Allemagne. Déterminé à dépasser son handicap dû au bégaiement et à apporter tout son soutien à son peuple, le roi George VI va, avec l'aide en coulisses de Lionel Logue, lire ce discours qui est émotionnellement très fort. La chose n'est pas aisée car ce discours passe à la radio, moyen de communication qui se développe à cette époque. Voilà en tout cas une scène qui clôt de belle manière ce film.
Colin Firth, qui a obtenu l'oscar pour sa prestation dans Le discours d'un roi, n'est pas le seul à féliciter sur ce film. Geoffrey Rush est parfait dans le rôle de Lionel Logue, véritable trublion qui fait sortir de ses gonds son futur roi, mais tout cela dans le but de lui faire oublier son bégaiement. Tour à tour drôle et touchant, Geoffrey Rush rend bien la pareille à Colin Firth.
De son côté, Helena-Bonham-Carter, révèle également un personnage charismatique, en jouant l'épouse de George VI. C'est elle qui va trouver Lionel Logue et c'est elle qui pousse le père de ses deux enfants à se motiver. Elle n'est pas pour autant obnubilée par le pouvoir, comme le prouve cette scène où elle avoue à son époux que si elle l'a épousé, c'est qu'elle pensait qu'il ne serait jamais roi et qu'elle aurait donc une vie privée, ce qui n'est pas le cas des têtes couronnées et de leur famille.
Bénéficiant d'une histoire forte et d'acteurs de grande classe, Le discours d'un roi n'est pas pour autant le film incontournable. L'histoire ne comprend pas vraiment de véritables rebondissements, si ce n'est les querelles entre George VI et Lionel Logue. Surtout, la mise en scène est plus fonctionnelle qu'autre chose.
Au final, Le discours d'un roi demeure un film intéressant par son scénario où pour une fois à l'écran le bégaiement n'est pas destiné à faire rire mais il est considéré comme un handicap. Par ailleurs, ce film mélange adroitement petite et grande histoire et bénéficie d'excellents acteurs. Ce sont là des qualités suffisantes en soi permettant de recommander ce film à autrui.

Titre du film : True grit
Réalisateurs : Ethan et Joel Coen
Durée du film : 2h05
Date de sortie du film : 23 février 2011
Avec : Jeff Bridges (Rooster Cogburn), Hailee Steinfeld (Mattie Ross), Matt Damon (LaBoeuf), Josh Brolin (Tom Chaney), Barry Pepper (Ned Pepper), etc.
Par Nicofeel

Si l'on excepte l'excellent No country for old men, les frères Coen sont en sévère perte de vitesse depuis un bon moment, alternant films mauvais ou ennuyeux (Ladykillers, A serious man) et comédies vite oubliables (Intolérable cruauté, Burn after reading). C'est peut-être dès lors pour relancer leur carrière que les frères Coen ont eu l'idée de mettre en scène un western. Il faut croire aussi que le succès du remake de 3h10 to Yuma leur a donné des idées.
Car de la même manière que pour 3h 10 to Yuma, True grit n'est rien d'autre que le remake d'un western plus connu en France sous le titre de 100 dollars pour un shérif. Solidement mis en scène par Henry Hathaway, même si c'est loin d'être un western majeur, 100 dollars pour un shérif avait été réalisé dans un contexte particulier, en 1969, à un moment où le western connaît ses derniers moments. Et c'était d'ailleurs tout un symbole de voir que le rôle principal du film était interprété par un John Wayne loin de sa classe habituelle, jouant un homme vieillissant et quelque peu alcoolique. Pour autant, l'humanisme de son personnage lui avait permis de rafler son unique oscar.
Ici, dans la version 2011, il n'y a pas de contexte remarquable. Le western n'a plus de réelle existence, à tel point que les seuls westerns auxquels on a droit sont des remake. Sacré manque d'originalité !
Les frères Coen livrent en fait un film où ils reprennent quasiment plan par plan le film d'Henry Hathaway. Si le spectateur n'a pas vu le film de 1969, cela ne le choquera pas. Mais pour celui qui l'a vu, le repompage est manifeste. Les frères Coen n'ont fait aucun ou à tout le moins peu d'efforts. Le scénariste n'a pas dû être trop fatigué sur ce coup-là !
Le film raconte donc l'expédition d'un shérif alcoolique, d'un ranger et d'une adolescente pour retrouver la trace du tueur du père de cette dernière.
Le seul véritable apport des frangins Coen est un excès de violence qu'il n'y avait pas dans le matériau d'origine. C'est flagrant dans la scène où deux hommes sont tués, dont l'un se retrouve avec la main coupée en gros plan. Une sacrée tuerie qui apporte une nouvelle vision du film dans son rapport à la violence.
Pour le reste, les écarts par rapport au film de 1969 ne sont bien souvent que minimes et surtout ne sont pas forcément justifiés.
Le choix de faire séparer à plusieurs reprises le duo Rooster Cogburn, Mattie Ross et le ranger LaBoeuf n'est pas des plus judicieux. Car ce trio se révélait efficace tant dans les scènes d'action que dans les scènes plus intimes dans le film de 1969.
Mais le plus dérangeant est sans conteste la fin du film qui est vraiment bâclée. La mort héroïque du ranger dans le film d'Henry Hathaway était sans conteste une scène émotionnellement forte. Là, le choix de le faire vivre et a fortiori de ne plus en entendre parler comme s'il n'avait jamais existé n'est pas génial. Et puis la fin extrêmement nostalgique du film d'Hathaway avec cette superbe scène sur la tombe du père de Mattie Ross avec un Rooster Cogburn et une Mattie Ross qui font corps ensemble et déclarent toute l'amitié qu'ils ont l'un pour l'autre était magnifique. Elle a été remplacée par une scène ridicule où l'on apprend 25 ans après les faits qui viennent de se dérouler que Cogburn se produisait dans un cirque (!) et que, manque de pot, Mattie vient juste de le rater car il est décédé trois jours plus tôt ! Franchement, les frères Coen manquent vraiment de subtilité. Tout comme ils manquent de finesse quand ils décident de faire tuer le cheval de Mattie par Cogburn. Si ce cheval est fatigué, pourquoi ne pas tout simplement le laisser partir au lieu de l'épuiser sauvagement. Quand on sait l'importance du lien entre le cheval et l'homme dans un western, on se dit que les frères Coen n'ont décidément pas compris grand chose.
Et puis True grit est moins bon que le film orignal par son casting. Certes, Jeff Bridges est très drôle (voir par exemples le coup où il se moque de l'homme blessé dans la cabane en le traitant de cul de jatte ou encore les nombreuses fois où il harangue le ranger qui est joué par Matt Damon, notamment quand ce dernier, bien qu'ayant la langue abîmée, se mette pourtant à parler en latin !) et même parfois très humain envers Mattie. Il n'empêche. Il n'arrive pas à nous faire oublier un John Wayne particulièrement charismatique et surtout très humaniste. A l'instar du personnage joué par Jeff Bridges, John Wayne incarnait un Rooster Cogburn qui s'en prenait continuellement à LaBoeuf. Mais il y avait dans le film d'Hathaway une vraie permanence car les remarques de Cogburn concernaient souvent le fait que le ranger avait du mal à toucher sa cible (« Une autre fois vise le cheval, peut-être que t'auras Ned Pepper ! »), et visait du coup le cheval de ses adversaires. Ces éléments sont importants car il y a un lien avec une des scènes de fin où le ranger va réussir avec une chance inespérée à sauver Cogburn en tirant à très longue distance.
Mais le vrai point noir du casting est sans nul doute le personnage de Mattie. Hailee Steinfeld n'est pas mauvaise en tant que tel mais elle ne colle pas du tout au personnage. Ici, elle est certes déterminée à se venger mais elle reste très effacée aux côtés de Jeff Bridges et Matt Damon. Et puis avec ses nattes et son air juvénile on dirait vraiment une enfant. Dans le film de 1969, Henri Hathaway avait eu la bonne idée de faire de Mattie Ross une adolescente aux airs de garçonne, particulièrement motivée et qui n'avait pas pour habitude de mâcher ses mots, notamment devant Cogburn et LaBoeuf, ce qui donnait lieu par instants à des moments de franche rigolade, comme cette scène où elle déclare à LaBoeuf : « Monsieur je ne suis pas en admiration devant vous mais vous vous admirez tant que ça doit vous suffire. » Dans le film des frères Coen, Mattie Ross est plus un faire-valoir qu'autre chose.
En somme, True grit version 2011 est loin d'être une grande réussite si l'on se rappelle le film de 1969. Non seulement ce remake est parfaitement inutile, mais en plus il est truffé de défauts par rapport au matériau d'origine. En revanche, pour ceux qui ne connaissent pas le film d'Henry Hathaway, ils pourront être globalement séduits par ce long métrage des frères Coen qui est tout de même bien filmé et globalement bien joué. Mais bon, quel manque d'ambition tout de même. J'aimerais bien dire que j'attends avec impatience le prochain film des auteurs de Fargo et de The big lebowski mais ce n'est pas le cas.

09.03.11
Titre du film : Faster
Réalisateur : George Tillman Junior
Durée du film : 1h35
Date de sortie au cinéma : 2 mars 2011
Avec : Dwayne Johnson (le chauffeur), Billy Bob Thornton (le policier), Carla Gugino, Maggie Grace, Tom Berenger, etc.
Par Nicofeel

Réalisé par George Tillman Junior, Faster constitue un énième film sur la notion de vengeance.
Dans le cas présent, un homme, « le chauffeur » vient de sortir de prison après avoir passé dix ans derrière les barreaux. Il avait été incarcéré suite à un braquage qui avait bien tourné pour lui dans l'immédiat mais qui s'était révélé un gros échec par la suite, l'argent ayant été volé par un gang, ce même gang ayant tué son frère. Le film s'intéresse alors au fait que « le chauffeur » n'a qu'une idée en tête : tuer tous les hommes faisant partie de ce gang pour venger la mort de son frère.
L'originalité n'est donc pas vraiment de mise.
Et ce n'est pas la subtilité de la mise en scène qui va donner envie de prendre avec beaucoup de considération ce film. Dès le début du film, les principaux protagonistes sont présentés avec diverses indications : outre le chauffeur, il y a le policier et le tueur (un tueur à gages, engagé pour liquider le chauffeur). Les personnages apparaissent donc de manière caricatural et quasi dichotomique. Les scènes d'action du film ne sont pas non plus marquées par le seau de la subtilité : pour son premier meurtre, le chauffeur rentre dans une entreprise de télémarketing et il tue à bout portant un homme en pleine tête. On sent que la finesse n'est pas à l'ordre du jour. Surtout que pour appuyer certaines scènes, on a droit à des ralentis. Sans compter les flashbacks qui émaillent un film à l'histoire peu originale.
D'ailleurs, on peut prendre peur devant les invraisemblances du scénario. Comment penser en effet que la police n'ait jamais arrêté – ou à tout le moins tenté d'arrêter – les tueurs du frère du chauffeur du chauffeur alors qu'elle dispose d'une cassette vidéo sur ce meurtre. C'est tout de même incroyable que cela soit un bandit qui fournisse au chauffeur l'identité des tueurs. Mais il y a pire, le fait que le chauffeur ait reçu une balle en pleine tête, qu'il soit déclaré mort et que la balle soit finalement ressorti, est sacrément tirer par les cheveux ! (de même qu'un des twists finaux sur un sujet comparable).
Les acteurs ne sont pas non plus à la fête dans ce film. Autant dire que les personnalités sont loin d'être fouillées. Dwayne Johnson, qui interprète le chauffeur, use de ses gros bras et se contente d'un regard déterminé. Quant à Billy Bob Thornton, il est peut-être l'acteur le plus fin du film, avec un personnage trouble et qui dispose d'une vie compliquée sur le plan de la vie personnelle. Quant aux différentes actrices, force est de constater qu'elles sont surtout là pour se fondre dans le décor. Elles n'apportent strictement rien au récit.
On pourra également – en tout cas au début - tiquer sur la morale du film. On est complètement dans la démonstration de la loi du talion avec l'expression « oeil pour oeil, dent pour dent ». Le chauffeur tue les personnes ayant participé à la mort de son frère, se faisant lui-même justice. On est proche d'un film réactionnaire. Le personnage principal entend d'ailleurs à la radio dans le film « Qui a vécu par l'épée périra par l'épée », qu'il interprète par le fait qu'il faut tuer les gens qui se sont rendus coupables de meurtres. Heureusement, un des personnages du film est épargné, ce qui permet de limiter le côté réactionnaire du film. Le chauffeur change, ce qui permet de penser qu'à la fin il a trouvé son chemin de Damas. Partant sur des bases douteuses sur le plan moral, le film s'améliore nettement sur ce point.
Au demeurant, il n'y a pas que des éléments négatifs dans Faster. Ainsi, la musique, qui allie les moments rock et les moments plus planants, est signée Clint Mansell. Le compositeur a produit une bande son qui comporte par instants des relents de Requiem for a dream, ce qui est loin d'être désagréable à l'écoute.
Et puis une autre qualité du film est son dynamisme. Le film n'est certes pas fin, il est bien souvent complètement irréaliste (les twists et révélations à la fin en sont une preuve évidente) mais il remplit correctement son rôle en matière d'action. On ne s'ennuie jamais. De plus, certains dialogues, hautement recherchés (!), prêtent même involontairement à sourire, et permettent de passer agréablement le temps. On pense notamment à l'une des premières scènes où le directeur de prison demande au chauffeur s'il a des questions et ce dernier lui répond simplement : « Où est la sortie ? » Il y a aussi cette scène qui précède un duel et où l'adversaire du chauffeur déclare à un homme de les laisser seuls : « Surveille la porte, y en a seulement un de nous deux qui va sortir. »
Au final, Faster est un film policier bourré de défauts mais qui parvient tout de même à distraire, à défaut d'emporter l'adhésion du spectateur.

08.03.11
Suite du coup de projecteur sur 10 films ayant marqué les années 2001 à 2010.
Cette fois on traite des années 2006 à 2010 :
2006 : Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro (Etats-Unis) ;
2007 : Anna M de Michel Spinosa (France) ;
2008 : There will be blood de Paul-Thomas Anderson (Etats-Unis) ;
2009 : Morse de Tomas Alfredson (Suède) ;
2010 : Le soldat dieu de Koji Wakamatsu (Japon).

2006 : Une année prolifique sur le plan cinématographique
En cette année 2006, les chefs d’œuvre sont de sortie. Le choix a donc été draconien. Le regard aurait aussi bien pu se porter sur La vie des autres du jeune cinéaste allemand Florian von Donnersmarck que sur l'excellent Black book de Paul Verhoeven. Mais non la première place va revenir à Guillermo del Toro. Réalisateur de plusieurs films reconnus dans le genre avec Mimic (1997), L'échine du diable (2002) et Blade 2 (2002), Guillermo del Toro rentre avec Le labyrinthe de Pan dans une nouvelle dimension.
Ce film joue astucieusement sur deux aspects antinomiques : la réalité avec en 1944 la guerre d'Espagne en toile de fond et le rêve avec ce conte qu'est amené à vivre une petite fille. De manière particulièrement adroite, del Toro mélange ces deux éléments. La mise en scène est d'ailleurs d'un incroyable dynamisme, de telle sorte que l'on est emporté par cette histoire.
D'un côté, on a la petite Ofélia qui vit avec sa maman et a peur de l'homme que cette dernière fréquente, le terrible Vidal, capitaine de l'armée franquiste. D'un autre côté, la petite Ofélia vit des aventures extraordinaires par le biais du dieu Pan.
Mais ces êtres merveilleux existent-ils vraiment ou ne sont-ils pas tout simplement le fruit de l'imagination de cette jeune fille pour échapper à la réalité ? Car le quotidien est loin d'être plaisant avec un Vidal qui représente à lui seul le fascisme. Sergi Lopez est à cet égard parfait dans le rôle de Vidal ; il représente sans conteste un des « méchants » les plus impressionnants et les plus charismatiques de l'histoire du cinéma.
Film magistral où il y a une antinomie entre fascisme et merveilleux, Le labyrinthe est rempli d'images fabuleuses. Sa fin est a fortiori très réussie. Ce film marque durablement la rétine.
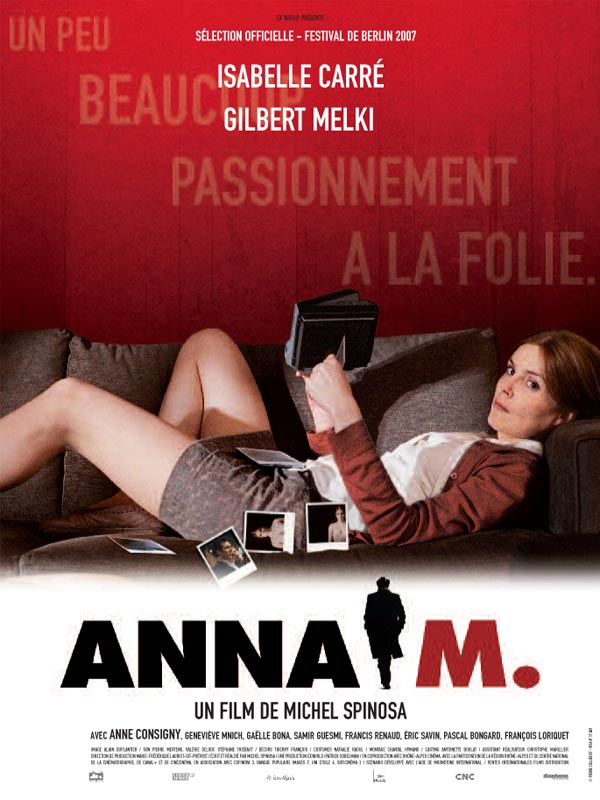
2007 : Un cinéaste français surprend son monde
Comment penser que le réalisateur de La parenthèse enchantée (2000), chronique sur les années post 1968, film certes sympathique au demeurant mais pas vraiment transcendant, serait capable de livrer un drame d'une grande intensité ? Pas grand monde.
Et pourtant, en traitant à l'écran le cas d'une érotomane amoureuse d'un médecin père de famille, le réalisateur Michel Spinosa dresse le portrait d'une femme excessive, qui n'en demeure pas moins humaine.
A cet égard, la composition d'Isabelle Carré est époustouflante dans le rôle de cette femme amoureuse à la folie. Le tour de force de Michel Spinosa est de mettre le spectateur en empathie avec ce personnage d'Anna alors que celle-ci commet des actes répréhensibles. Preuve que le personnage d'Anna a parfaitement été travaillé, évitant toute caricature.
A noter également l'excellente interprétation de Gilbert Melki dans le rôle du médecin dont est amoureux Anna. Évidemment, le film ne serait pas aussi réussi sans une mise en scène bien adapté à son sujet, où Michel Spinosa filme au plus près du corps d'Isabelle Carré.
Ce grand film est aussi la preuve que le cinéma français peut encore faire de grandes choses.

2008 : Un film de Paul-Thomas Anderson confirme tout le bien que l'on pense de ce réalisateur
Auteur de films d'excellente facture avec Magnolia (2000) et Puch drunk love (2003), Paul-Thomas Anderson a l'habitude de prendre son temps. Bien lui en a pris car avec There will be blood il donne au spectateur une fresque sociale d'une grande intensité, malgré sa durée de 2h38.
Ce film commence par la découverte d'un premier puits de pétrole au début du XXème siècle par le personnage de Daniel Plainview jusqu'à la crise de 1929. There will be blood dresse le portrait d'un incroyable self-made-man, ce Daniel Plainview, prêt à tout pour réussir. Cet homme s'avère être quelqu'un d'aussi sombre sur le plan relationnel que le pétrole qu'il chérit tant. Daniel Day-Lewis a très logiquement obtenu l'oscar du meilleur acteur pour ce rôle.
On notera également la composition de Paul Dano, excellent en prêtre radical. Pour parachever le tout, on a droit tout au long du film à une mise en scène fluide, à une superbe photo et enfin à la musique inspirée de Jonny Greenwood (guitariste du groupe de rock alternatif Radiohead).
En somme, le jeune Paul-Thomas Anderson (il est né en 1970) prouve avec ce film qu'il est un auteur américain surdoué, pétri de talent.

2009 : La Suède fait un retour fracassant sur le devant de la scène
Avec une avalanche de films sur la thématique du vampire, difficile de renouveler ce mythe. C'est pourtant ce que réussit brillamment à faire le réalisateur suédois Tomas Alfredson, qui offre une vision originale du vampire que l'on n'avait pas vu depuis l'excellent Aux frontières de l'aube (1988) de Kathryn Bigelow.
Dans Morse, le fait d'être immortel n'est pas ressenti comme une bénédiction, c'est plutôt le fait de devoir tuer des gens pour se nourrir qui est vécu comme un fardeau.
Le cinéaste Tomas Alfredson ne se contente pas de brosser un film fantastique. Au contraire, le fantastique n'est qu'un des éléments de son film.
Morse se déroule dans les années 80 dans une petite ville de Suède où le temps est particulièrement peu clément puisqu’il y fait très froid et la neige est omniprésente. Dans ce cadre où la vie semble assez rude, on va suivre la rencontre entre deux personnages qui sont rejetés, exclus par le monde qui les entoure. Dans Morse, on assiste ainsi à une belle histoire d'amitié/d'amour pur entre deux êtres très différents : Oskar, un jeune garçon blond de 12 ans qui est martyrisé par ses camarades de classe et Eli, une jeune fille brune, énigmatique, qui se révèle être un vampire.
La mise en scène de Tomas Alfredson est parfaite, privilégiant des gros plans sur les visages qui permettent ainsi de voir les beaux yeux bleus d’Eli, ce qui renforce le côté mystérieux voire envoûtant (ne pas oublier qu’elle est un vampire) de son personnage. Les rapports entre Oskar et Eli sont très forts, ce que rappelle sans équivoque l'une des très belles scènes finales du film. Chronique fantastique d’une grande sensibilité, Morse est un véritable bijou.

2010 : Le Japon retrouve les sommets
Le soldat dieu est évidemment le plus récent de cette liste puisqu'il n'est sorti sur les écrans français qu'en décembre 2010. Dans une année 2010 où les grands films se comptent sur les doigts d'une main, le cinéaste Koji Wakamatsu a su tirer son épingle du jeu avec son histoire de lieutenant de l'armée japonaise revenu de la guerre sino-japonaise en héros mais privé de ses bras et de ses jambes.
Si le film de Wakamatsu mérite de figurer en bonne place, c'est en raison de thématiques fortes qui y sont développées : le cinéaste s'en prend clairement à un nationalisme aveuglant mais aussi à un machisme ambiant.
Pour Wakamatsu, l'expression de soldat-dieu n'a rien d'honorable. Elle renvoie en fait à un nationalisme exacerbé. Dans le film, on voit par exemple qu'il y a une propagande de tous les instants qui est véhiculée par le média présent partout à l'époque, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, à savoir la radio. Du coup, tout le monde ou presque se met à la cause de l'Empire.
Ce soldat dieu est aussi le symbole du machisme ambiant de l'époque. Cet homme-tronc, le lieutenant Kurokawa, ne peut plus que manger et dormir. Pour autant, il continue d'exprimer ses envies à son épouse. Sa femme, Shigeko est sous son emprise. Seulement, le réalisateur a la bonne idée de montrer qu'en temps de guerre, les rapports de force ne sont plus les mêmes, a fortiori quand on est fortement handicapé. Shigeko en vient progressivement à se venger. Cette révolte ne peut être que salutaire.
Par ailleurs, le lieutenant Kurokawa, est in fine le symbole d'un Japon en pleine déconfiture. Son suicide coïncide d'ailleurs avec la fin de la guerre marquée par la capitulation de l'empire du Japon le 15 août 1945. Du début à la fin du film, la guerre est au demeurant vilipendée par son inutilité. Ce n'est pas anodin si la dernière image du film est celle de la bombe atomique.
Wakamatsu réalise ainsi avec Le soldat-dieu un film extrêmement abouti qui se révèle un formidable plaidoyer contre la guerre. Dans un style très sec et sans concession, le cinéaste en profite également pour s'insurger contre une société japonaise des années 40 alors rétrograde, tant par son nationalisme exacerbé que dans les relations entre hommes et femmes.
C'est la fin de cette rétrospective. On se donne rendez-vous dans dix ans pour la rétrospective des dix meilleurs films des années 2011 à 2020 !
07.03.11
Alors que l'on commence l'année 2011, un petit rappel sur des films ayant marqué les dix dernières années ne manque pas d'intérêt.
Cette rétrospective, qui se base sur mon film préféré de chaque année, est forcément subjective mais elle met tout de même en valeur dix films qui ont fait parler d'eux lors de leur sortie et qui continuent pour certains à marquer durablement le septième art.
Les films en question :
2001 : La chambre du fils de Nanni Moretti (Italie) ;
2002 : Parle avec elle de Pedro Almodovar (Espagne) ;
2003 : Le retour du roi de Peter Jackson (Etats-Unis) ;
2004 : Old boy de Park Chan-Wook (Corée du Sud) ;
2005 : The descent de Neil Marshall (Royaume-Uni) ;
Les films des années 2006 à 2010 seront dévoilés dans la partie 2 de ce dossier !

2001 : L'année de Nanni Moretti
Le renouveau du cinéma italien n'a pas encore débuté que déjà l'un de ses fers-de-lance, Nanni Moretti, se fait particulièrement remarqué en cette année 2001 où il obtient la palme d'or avec La chambre du fils.
Réalisateur italien engagé, comme le prouvent ses derniers films (Le caiman), Nanni Moretti est aussi capable de faire des longs métrages d'une grande sensibilité, à la thématique universelle. C'est le cas ici avec La chambre du fils où il interprète lui-même le rôle principal du film, celui d'un père de famille qui a bien du mal à faire le deuil de son fils.
Ce film montre très subtilement la dislocation des relations au sein d'une famille suite à la mort accidentelle d'un enfant.
Toujours situé dans un ton juste, le film de Nanni Moretti ne sombre jamais dans le pathos. Au contraire, le cinéaste italien manifeste à travers ce film une sensibilité à fleur de peau. La fin du film, vue comme une ouverture vers l'extérieur, est bien dans l'idée que la vie doit continuer malgré tout.
Voilà un très beau film, où tous les acteurs jouent parfaitement leur rôle (en plus de Nanni Moretti, l'actrice Laura Morente est remarquable), qui constitue indéniablement une des palmes d'or de Cannes les plus justifiées.

2002 : Un film de Pedro Almodovar à l'honneur
Si Pedro Almodovar n'a pas eu droit pour sa part à une récompense majeure dans un des trois festivals incontournables (Berlin, Cannes et Venise), il n'empêche que ses films sont bien souvent d'une grande qualité. Avant de tourner Parle avec elle, Pedro Almodovar est dans une excellente phase, après avoir mis en scène des films tels que En chair et en os (1997) et Tout sur ma mère (1999).
Le cinéaste espagnol réalise même avec Parle avec elle un véritable chef d’œuvre sur un sujet pourtant particulièrement casse-gueule.
En effet, le film évoque tout de même une relation sexuelle qu'a un infirmier avec une femme tombée dans le coma, ce qui a pour effet de la ramener durablement à la vie. Autour d'un sujet que certains pourraient qualifier de prime abord de scabreux, le cinéaste réussit à tisser un drame d'une grande intensité, où finalement tous les personnages ont leurs raisons propres et où personne n'est à blâmer.
Pedro Almodovar en profite pour évoquer une thématique qui lui tient à cœur : la vie et la mort, et il rend grâce une fois de plus à la beauté des femmes, ici sous les traits des superbes Leonor Watling et Paz Vega.
Mis en scène brillamment, avec un superbe travail opéré sur la photographie, Parle avec elle est un film qui laisse aussi la part belle à ses acteurs. Voilà donc un film à voir ou à revoir.

2003 : Peter Jackson termine sa trilogie du seigneur des anneaux
Capable dans ses jeunes années de films d'horreur ultra gore avec Bad taste (1988) et Braindead (1993), Peter Jackson est également l'auteur de drames intimistes, d'une grande finesse comme Heavenly creatures (1996) ou Lovely bones en cette année 2010.
En adaptant le seigneur des anneaux, Livre le plus lu du vingtième siècle derrière la Bible avec un nombre incalculable de fans, Peter Jackson était donc attendu au tournant. Le résultat est à la hauteur des espérances.
Si ce troisième volet du seigneur des anneaux (après la communauté de l'anneau, sortie au cinéma en 2001 et les deux tours, sortie en 2002) est très axé sur les combats – comme dans le livre d'ailleurs – il donne lieu à de grands moments de bravoure et à des combats titanesques.
Certains moments du film restent durablement gravés dans les mémoires, comme lorsque les Rohirrim viennent au secours de Minas Tirith (certainement la plus belle scène de charge vue au cinéma) ou lorsque Eowyn affronte le terrible seigneur des Nazguls. Sans oublier le courage de Sam aux fins de secourir Frodon et de l'amener jusqu'à la montagne du destin. La fin du film est très émouvante avec tous les personnages principaux qui regagnent chacun des horizons différents.
Ce film clôt de manière admirable cette fantastique trilogie du seigneur des anneaux en atteignant une dimension dramatique rarement vue dans un blockbuster. On attend avec impatience Peter Jackson dans deux ans, lorsqu'il va nous montrer son adaptation de Bilbo le hobbit, qui devrait sortir en décembre 2012 puis en décembre 2013.

2004 : La Corée du Sud bouscule la hiérarchie établie
Si la Corée du Sud possède un auteur reconnu mondialement avec Im Kwon Taek,le renouveau de ce pays est assuré par de nouveaux cinéastes tels qu'Im Sang Soo, Lee Chang Dong, Hong Sang Soo et donc Park Chan Wook. Avec son film Old boy qui a obtenu le grand prix du festival de Cannes en 2004, ParK Chan Wook entre dans la cour des grands.
Et il faut dire que c'est mérité. Old boy constitue le deuxième film de la trilogie de la vengeance de Park Chan-Wook après Sympathy for Mr vengeance (2003) et avant Lady vengeance (2005).
Ce long métrage part d'un postulat pour le moins original avec Oh Dae-Soo, un père de famille au dessus de tout soupçon, qui est enlevé devant chez lui et qui est placé dans une cellule isolée. Il va rester 15 ans dans cette cellule avec une télévision mise à disposition pour lui montrer l'évolution de la société.
Évidemment, le spectateur ne sait pas plus qu'Oh Dae-Soo pourquoi il a été kidnappé ni pourquoi il a été enlevé. C'est alors qu'un jeu de pistes particulièrement tordu est créé par le ravisseur d'Oh Dae-Soo, jusqu'à une révélation étonnante qui est véritablement l'apothéose de ce film. Avant d'en arriver là, le réalisateur Park Chan-Wook aura fait montre de son talent de cinéaste avec une mise en scène d'une grande fluidité et des scènes inoubliables.
A cet effet, on a droit à des scènes surréalistes avec par exemple Dae-Soo qui sort d'une malete ou encore le ravisseur muni d'un masque à gaz qui observe Dae-Soo qui est endormi. Mais sans conteste la scène la plus marquante est ce superbe plan de séquence où Dae-Soo, armé d'un marteau, combat pendant plus de 3 minutes une douzaine d'hommes dans un couloir. Culte !
Marqué par la formidable performance de l'acteur Choi Min Sik dans le rôle d'Oh Dae-Soo, Old boy est un film inoubliable. Il est aussi le symbole de la montée en puissance de la Corée du Sud sur le plan cinématographique.
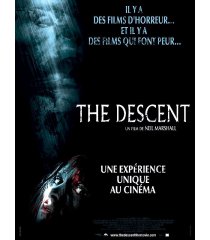
2005 : Le cinéma d'horreur revient en force
Pour les fans du genre, Neil Marshall est le cinéaste du bourrin mais inégal Dog soldiers, un film sur des militaires qui se font dégommer par des loups-garous.
Pourtant, réalisé par le même cinéaste,The descent constitue le choc de l'année 2005. Le réalisateur britannique transcende le genre (le cinéma d'horreur) pour donner lieu à un survival de grande classe.
Dans ce film, Neil Marshall met en scène six femmes – qui au demeurant se comportent comme des hommes – venues se débarrasser de leurs soucis quotidiens le temps d'un week-end en faisant de la spéléologie dans les Appalaches.
Dans un environnement hostile peuplé de monstres humanoïdes, ces femmes reviennent à une nature primitive et leur unique interrogation est de survivre. The descent est prenant de bout en bout dans un endroit obscur qui est à déconseiller aux claustrophobes.
La fin du film bénéficie d'un twist des plus intéressants qui ne laisse pas de place au happy end. Voilà un film majeur du cinéma d'horreur et même du cinéma tout court, à ranger aux côtés de films qu'il cite implicitement, Alien et Predator.
04.03.11
Titre du film : Les voyages de Gulliver
Réalisateur : Rob Letterman
Durée du film : 1h25
Date de sortie au cinéma : 23 février 2011
Avec : Jack Black (Lemuel Gulliver), Jason Segel (Horatio), Emily Blunt (la princesse Mary), Chris O'Dowd (le général Edward), Amanda Peet (Darcy Silverman), etc.
Par Nicofeel

Réalisé par Rob Letterman (Monstres contre aliens), Les voyages de Gulliver est une nouvelle adaptation du roman de Jonathan Swift, paru en 1721. En effet, ce roman avait déjà fait l'objet d'une adaptation en 1960 par Jack Sher. Sans être génial, le film tenait la route.
C'est loin d'être le cas dans ce film. Dès le début, on peut craindre – à raison – le pire. On voit Jack Black, qui joue le rôle de Lemuel Gulliver, qui mime la guerre des étoiles avec des figurines. Lemuel Gulliver est présenté comme un jeune homme sans aucune ambition qui est resté un grand adolescent. Travaillant au bureau du courrier d'une entreprise de presse située sur l'île de Manhattan, il s'amuse à faire des blagues et prend une partie de son temps professionnel pour jouer à Guitar hero. Franchement, ce moment du film fait preuve d'un humour qui n'est pas franchement très drôle et original.
Mais le pire est à venir. Parti en direction du triangle des Bermudes pour faire un reportage, il doit faire face à une tempête et se retrouve alors sur une île, où vivent les lilliputiens, des êtres minuscules.
Si dans le roman Gulliver est pour le moins surpris d'être pris pour un géant, ici Jack Black dans le rôle de Gulliver n'est nullement étonné. Il est pourtant attaché par ces lilliputiens. Mais avec son bonhomie habituelle, Jack Black ne s'embête pas la vie. Il n'est nullement étonné. Il est même plutôt amusé de la situation.
Il perd une partie de son fut (!) quand les lilliputiens et rapidement il devient un ami de ceux-ci car il les aide. Mais encore faut-il voir de quelle façon : Gulliver éteint un incendie en urinant sur les flammes ! Quelle finesse !
Et ce n'est pas fini à ce niveau-là. On assiste en fin de compte à un one-man-show de Jack Black qui ne gratifie de pitreries plus ridicules les unes que les autres. Non seulement le film est aussi subtil que le poids d'un éléphant, mais en plus il fait honte au roman original.
L'histoire se contente de combats entre les lilliputiens et leurs ennemis, avec Gulliver au milieu de tout ça. Il y a aussi une histoire d'amour entre la princesse Mary et son amoureux, Horacio, qui n'apporte rien au récit.
La réflexion sur le fait d'être différent (Gulliver et les autres) ou encore sur ces lilliputiens qui sont censés être le miroir de notre société, a complètement disparu. De manière générale, l n'y a rien au niveau de la critique du genre humain. Si le film est une adaptation du roman de Jonathan Swift, c'est uniquement par son titre et par l'idée générale du film.
Dans le même ordre d'idée, les différents personnages du film n'ont aucune identité propre. Aucun d'entre eux n'est développé. Le film est malheureusement centré uniquement sur Gulliver et donc par extension sur la personnalité de Jack Black qui l'interprète.
Le film est rempli de scènes à la gloire de Gulliver : on lui monte une résidence majestueuse en deux temps trois mouvements ; des lilliputiens sont déguisés de telle façon que l'on reconnaisse le groupe Kiss.
Les fautes de goût du réalisateur sont à la hauteur de la finesse de Jack Black que l'on retrouve à un moment donné déguisé en femme, avec une robe !
Bref, pas de besoin d'en dire plus. Le film est un désastre. Sa conclusion ridicule qui nous propose un Jack Black qui chante et danse sur le morceau « War » de Frankie goes to Hollywood, avec des lilliputiens autour de lui, est à l'image du reste du film.
Sans conteste, Les voyages de Gulliver est un film navrant tant sur le plan de l'histoire que de la distribution et même des effets spéciaux qui ne sont pas géniaux.
Il n'y a guère que des enfants qui sont éventuellement à même d'apprécier un tel navet. Évidemment je déconseille ce film.

03.03.11
Titre du film : Sanctum
Réalisateur : Alister Grierson
Durée du film : 1h45
Date de sortie au cinéma : 23 février 2011
Avec : Richard Roxburgh (Frank McGuire), Rhys Wakefield (Josh McGuire), Ioan Gruffuldd (Carl), Alice Parkinson (Victoria), Dan Wyllie (George), etc.
Par Nicofeel

Produit par James Cameron, Sanctum est un film américano-australien. Il est mis en scène par l'inconnu Alister Grierson.
Le scénario est d'une grande simplicité : un homme, Frank McGuire, passionné par la spéléologie, explore des grottes dans le Pacifique Sud. Dans cette aventure, il entraîne avec lui plusieurs personnes, dont son fils de 17 ans, Josh. En raison d'une violente tempête tropicale, l'équipe se retrouve piégée dans la grotte et va devoir trouver une issue pour s'en sortir. La seule solution est de suivre la rivière souterraine pour atteindre l'océan.
Le film nous propose au début de superbes paysages extérieures avant de nous montrer de très beaux fonds marins.
Pour autant, cela ne suffit pas à faire un film. L'exploration de fonds marins c'est sympathique mais sur 1h45 cela finit quelque peu par ennuyer.
Le réalisateur Alister Grierson ne prend pas la peine de donner une vraie profondeur (si l'on peut dire !) à ses personnages. Tous manquent cruellement d'identité propre, à tel point qu'il peut leur arriver n'importe quoi, une blessure voire la mort, on a bien du mal à s'intéresser à leur cas. On ne s'identifie pas à eux.
Ce n'est pas d'ailleurs le jeu des acteurs du film qui est assez approximatif qui va plus aider sur ce point.
Heureusement le cinéaste a eu l'idée d'émailler son film de quelques événements. Tout tourne autour des personnages qui vont devoir tout faire pour survivre. Mais plusieurs d'entre eux vont y laisser leur vie : il y a la fille qui se noie ; il y en a un autre qui est gravement blessé et qui va être noyé pour que ses souffrances soient abrégées, donnant lieu à l'une des rares scènes vraiment marquantes sur le plan émotionnel, etc.
Comme tout arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et que les quelques tensions qui ont lieu au sein du groupe sont rares (le coup du départ du personnage de Carl est assez prévisible), l'intérêt du film finit par être de deviner quel personnage va s'en sortir.
La deuxième partie du film est un peu moins ratée, notamment lorsque le groupe comprend quatre personnes : Frank McGuire et son fils Josh ; Carl et Victoria. La relation père-fils n'est pas très développée mais au moins elle permet a minima de s'intéresser à ces personnages.
Le cinéaste Alister Grierson aurait tout de même dû parsemer son film de choses inattendues, ce qu'il ne fait que très rarement. Ici, les moments « tendus » du film tiennent à la découverte d'issues et au fait de savoir si les personnages auront assez d'oxygène avec leur bouteille, assez de vivre et assez de lumière.
Pour le reste, pas vraiment de surprise et c'est bien dommage. On aurait souhaité voir, comme dans un The descent où l'aventure de femmes spéléologues avait été compliquée par l'apparition de monstres humanoïdes tueurs, des choses qui font sortir le film du carcan dans lequel il est entré. Le film est trop balisé et manque cruellement d'originalité.
Côté mise en scène, le constat est le film. Même si l'environnement où se passe l'action du film est contraint, la mise en scène, hormis quelques mouvements de caméra, comprend beaucoup de plans et notamment des champs / contre champs. Du coup, le film est complètement impersonnel. Il aurait pu être fait par n'importe qui.
Au final, malgré l'attrait supposé de la 3D qui très franchement ne bonifie pas spécialement ce film mais sert avant tout à lui donner un argument de vente auprès des spectateurs, Sanctum reste un film d'aventures parfaitement inoffensif et plutôt ennuyeux du fait du jeu moyen des acteurs et du manque de capacités du réalisateur à impliquer le spectateur. Voilà un film dont l'on peut aisément se passer, à moins d'être épris des fonds marins.

02.03.11
Titre du film : 127 heures
Réalisateur : Danny Boyle
Durée du film : 1h34
Date de sortie au cinéma : 23 février 2011
Avec : James Franco (Aron Ralston), Amber Tamblyn (Megan), Kate Mara (Kristi), etc.
Par Nicofeel

Après le film Slumdog millionnaire (2009) qui lui a valu moult récompenses, Danny Boyle revient à la charge. Avec un projet totalement différent, il a cette fois décidé d'adapter à l'écran l'histoire d'Aron Ralston, ce jeune alpiniste qui est resté coincé dans un canyon pendant 127 heures (d'où le titre du film).
Si les deux films n'ont aucun rapport, on retrouve dès le générique de début du film la « patte » de Danny Boyle avec un split screen où l'écran est divisé en trois parties. Pour ne pas faire les choses à moitié, le cinéaste britannique a fait de nombreux accélérés au niveau des images, pour évoquer l'immensité de la ville et le nombre important de personnes qui y vivent.
Ce split screen continue pendant une grande partie du générique. Cette mise en scène qui prend des allures de clip géant est à la limite de l'indigeste et d'une utilité toute relative.
Quand Aron Ralston arrive en direction du grand canyon, on le voit en train de se filmer avec une petite caméra numérique. Le support utilisé est donc différent et cela donne un aspect différent au niveau de la texture d'image pour le film. Pour information, Danny Boyle a engagé deux directeurs photo pour tourner 127 heures.
Si le risque de voir un film clippesque – comme pouvait l'être (malheureusement) par instants Slumdog millionnaire – est grand, on constate que le cinéaste se décide à calmer le jeu et à avoir une caméra plus posée une fois qu'Aron se trouve dans les grands espaces américains.
Le film comporte quelques moments humoristiques, bien détendus, avec Aron qui se crashe gentiment en vélo ou encore Aron qui fait le patron quand il croise des filles perdues dans le canyon.
Ce n'est que pour mieux insister sur le côté dramatique du film. Car au bout de 15 minutes, l'enjeu du film est fixé avec Aron qui tombe dans une faille et a son bras droit bloqué à cause d'un rocher. C'est à ce moment que l'on voit apparaître le titre du film.
Aron essaie tant bien que mal de le soulever mais le rocher est beaucoup trop lourd. Le jeune alpiniste va donc devoir faire avec ce qu'il a sous la main pour s'en sortir. Danny Boyle en profite pour nous faire un mouvement en contre-plongée -justifié pour le coup - afin de montrer qu'Aron est peu de choses au sein de cette nature, au sein de l'immensité de ce canyon et qu'il ne va pas pouvoir se dépêtrer facilement de cette situation.
Pas évident de se tirer d'affaire. Et Aron essaie tout. Il gratte le rocher avec un canif. A un autre moment il crée un système de poulie avec les cordes dont il dispose afin de bouger le rocher.
Afin de rendre son film intéressant, Danny Boyle a l'idée de l'entrecouper de diverses scènes du passé où Aron se souvient par exemple de son enfance avec son père ou encore de sa relation avec une jeune femme lorsqu'il est à l'âge adulte. Aron se rappelle également de ce qu'il a oublié quand il a soif (il pense à une bouteille de Gatorade, ce qui donne lieu à une mise en scène bien tape-à-l’œil). Aron s'imagine à un autre moment en train de faire la fête, scène où l'on entend le tube de Plastic Bertrand Ca plane pour moi, façon ironique de se détacher du cas présent.
Par ailleurs, on a droit à plusieurs scènes où Aron enregistre son histoire en vidéo et fait preuve de beaucoup d'humour, ce qui lui permet de conserver un minimum de sérénité dans une telle situation.
Tout l'intérêt du film réside alors dans le fait de savoir comment Aron va s'en sortir puisque l'on sait qu'il va s'en sortir, fait qui amoindrit peut-être quelque peu la tension dramatique. Dans tous les cas, la fatigue progressive d'Aron et sa volonté de vivre coûte que coûte sont plutôt plus rendus.
Pour autant, le film de Danny Boyle n'atteint jamais un niveau passionnant, hormis la scène où Aron décide l'inexorable pour sauver sa vie. Tout au plus on suit attentivement la périlleuse aventure d'Aron.
L'acteur James Franco, qui joue le rôle d'Aron n'est pas à mettre en cause. Il est bon dans l'ensemble.
Quant à la musique, le film comporte comme Slumdog millionaire plusieurs compositions originales signées A.R. Rahman qui se révèlent plaisantes.
Au final, 127 heures est la représentation d'une aventure humaine. Si le film est largement regardable (car le cinéaste Danny Boyle a utilisé avec parcimonie ses tics visuels habituels, principalement au début et à la fin du film), il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas pour autant passionnant. L'enjeu dramatique du film est couru d'avance et surtout comme le film, 127 heures a tendance un peu à tourner en rond.

01.03.11
Titre du film : La meute
Réalisateur : Franck Richard
Durée du film : 1h43
Date de sortie au cinéma : 29 septembre 2010 (sortie en DVD : 2 mars 2011)
Avec : Emilie Dequenne (Charlotte), Benjamin Biolay (Max), Yolande Moreau (la Spack), Philippe Nahon (Chinaski), etc.
Par Nicofeel

Présenté entre autres au dernier festival de Neuchâtel (le NIFFF), La meute constitue une nouvelle incursion dans le genre horrifique par un réalisateur français. Et comme souvent, le résultat est loin d'être satisfaisant.
Pourtant, sur le papier le casting peut faire envie : Emilie Dequenne, Yolande Moreau, Philippe Nahon. Plus curieusement l'un des rôles principaux a été attribué au musicien Benjamin Biolay.
Le synopsis du film n'est pas non plus repoussant avec une jeune femme, Charlotte, qui semble fuir quelque chose et qui prend en auto-stop le jeune Max (Benjamin Biolay). S'arrêtant dans un bar vétuste et bien paumé, Charlotte est prise en otage par le propriétaire, la Spack (Yolande Moreau), qui n'est autre que la mère de Max.
Malgré une idée de base plutôt intéressante et une distribution de qualité (en tout cas sur le papier), le cinéaste Franck Richard, dont c'est le premier film, a d'abord réussi à se saborder par le côté extrêmement vulgaire qu'il donne à son film. Emilie Dequenne, qui joue le rôle principal du film, en interprétant le rôle de Charlotte, une jeune femme qui se montre assez forte et libre dans ses choix, nous prodigue certaines des phrases les plus « fabuleuses » du film. Quelques morceaux choisis : « J'te préviens tu sors ta bite ou quoi » tu te prends un coup ; « putain il s'la touche ou quoi ». Yolande Moreau, en vieille femme psychopathe, nous gratifie également d'un sublime : « [...] sinon j'repeins mon lino avec le jus d'tes couilles ».
Plus grave, on constate que le film regorge de scènes incohérentes. Charlotte décide par exemple de passer un temps important à rechercher Max (qui a disparu dans les toilettes du bar !) alors qu'elle le connaît à peine et que des motards particulièrement loudingues rôdent dans le coin. De même, comment se fait-il que le personnage de la Spack semble increvable alors qu'elle s'est pris une balle ? Encore plus étonnant, on a du mal à comprendre que Charlotte fasse alliance avec Max alors que ce dernier l'a trahie et qu'il est le rejeton d'une femme complètement cinglée. Dans le même ordre d'idée, l'alliance avec les motards qui a lieu sans explications est des plus incongrues.
Mais il y a pire. On ne sait pas bien dans quelle direction va le film. Au début, on a l'impression qu'il s'agit d'un survival avec une Charlotte qui, réussissant à se libérer, va s'en prendre à ses agresseurs. Mais non le film dévie ensuite vers une sorte d'histoire de morts vivants. C'est là cette fameuse meute qui revit lorsqu'on lui donne du sang (les scènes où les personnages sont pris comme de véritables animaux qu'on livre à cette meute, sont peu fines). Et c'est vraiment ridicule. Le film ne prête même pas à sourire, comme pourrait le faire un film Z. C'est juste débile.
Le réalisateur Franck Richard mélange un peu tout (film de psychopathe, film de zombies, voire même film d'action à la Assaut), ce qui donne lieu à une tambouille pas vraiment passionnante.
L'interprétation elle-même ne relève pas le niveau. Emilie Dequenne a l'air de forcer son jeu en voulant jouer la rebelle alors que Benjamin Biolay, qui tient pourtant l'un des rôles principaux du film, est transparent d'un bout à l'autre de La meute, avec son air impassible qu'il garde en toute circonstance. La vulgarité du film dessert par ailleurs un peu plus le jeu peu inspiré des acteurs du film.
La fin ne permet même pas de donner une petite chance à La meute. On a droit à une scène de sérieux mauvais goût par la relation de Charlotte et des monstres. Le twist final apparaît tellement en décalage par rapport à ce que l'on vient de voir qu'on se demande s'il ne s'agit pas d'une erreur de script.
Seul point vraiment positif, la mise en scène. La meute est plutôt correctement filmé, ce qui procure donc quelques regrets eu égard à la tournure du film.
En synthèse, voilà un film d'horreur français peu convaincant, qui ne pourra plaire qu'aux fans hardcore du genre. Et encore.

| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | Courant | > >> | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Le Blog des DVDpasChériens
Les dvdpascheriens ayant la fibre journalistique peuvent participer à ce blog. Sur le thème des DVD, de la HD et de la vente en ligne. On y trouve des critiques, des dossiers, des articles sur les nouveautés ...
Rechercher
Cat�gories
- Toutes
- Box office cinéma (50)
- Dossier (34)
- Interview (42)
- Nouveautés (617)
- Point de vue (11)
- Test / Critique (1514)
- Test de commande (10)
- Top 10 (31)
Archives
- Janvier 2017 (1)
- Novembre 2016 (3)
- Octobre 2016 (3)
- Septembre 2016 (5)
- Ao�t 2016 (7)
- Juillet 2016 (3)
- Juin 2016 (4)
- Mai 2016 (6)
- Avril 2016 (3)
- Mars 2016 (4)
- F�vrier 2016 (7)
- Janvier 2016 (12)
- Suite...
Qui est en ligne?
- Visiteurs: 30
Divers
 Flux XML
Flux XML
- RSS 0.92: Articles, Commentaires
- RSS 1.0: Articles, Commentaires
- RSS 2.0: Articles, Commentaires
- ATOM 1.0: Articles, Commentaires